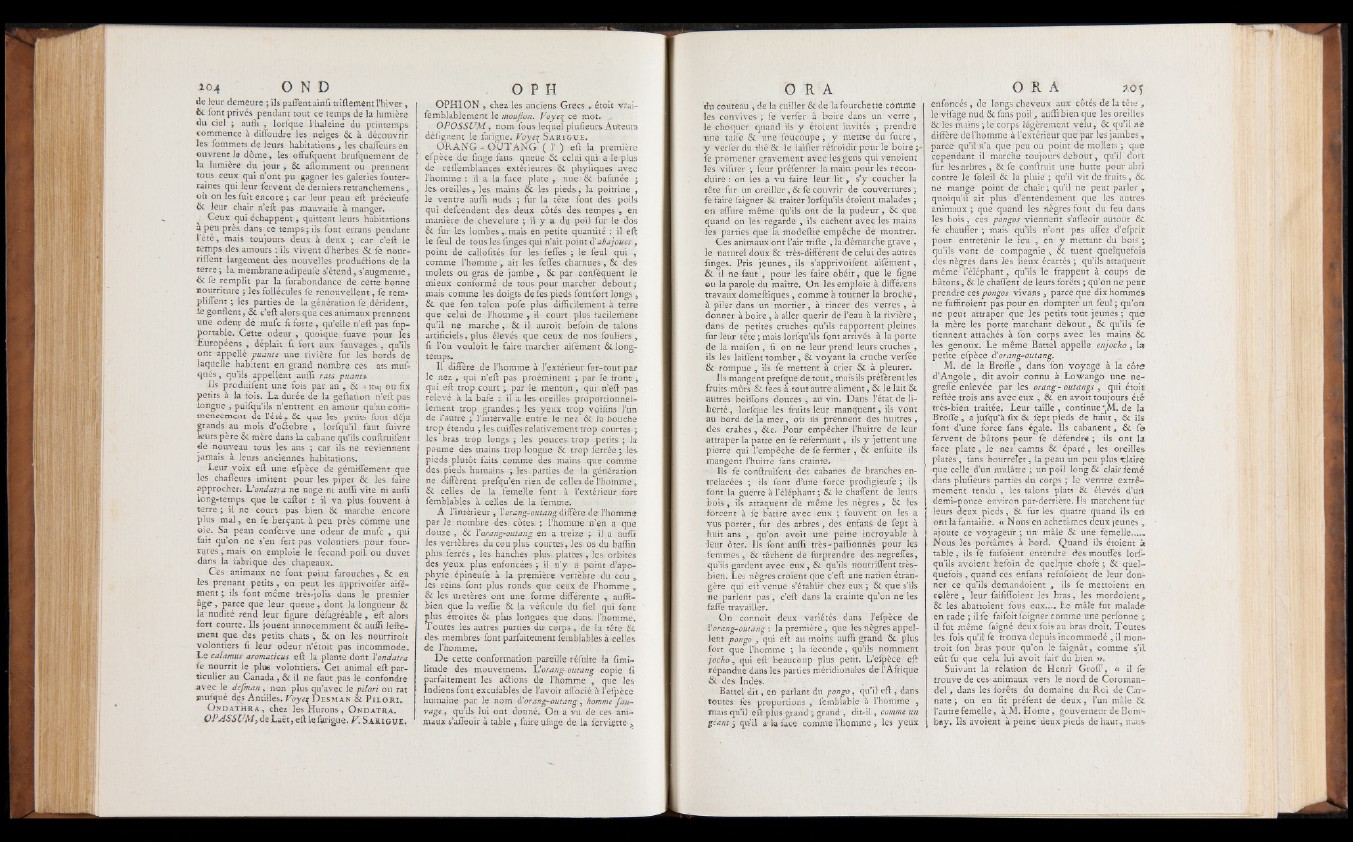
104 O N D
de leur demeure ; ils paffentainfi trîftement l’hiver,
& font privés pendant tout ce temps de la lumière
du ciel ; aufii , lorfque 1 haleine du printemps
commence à diffoudre les neiges 8c à découvrir
les fommets de leurs habitations , les chaffeurs en
ouvrent le dôme, les offùfquent brufquement de
la lumière du jour , & affomment ou prennent
tous ceux qui n’ont pu gagner les galeries fouter-
raines qui leur fervent de derniers retranchemens r
ou on les fuit encore ; car leur peau eft précieufe
& leur chair n’eft pas mauvaife à manger.
Ceux qui échappent, quittent leurs habitations
a peu près dans ce temps.; ils font errans pendant
l’été, mais toujours deux à deux ; car c’eft le
temps des amours : ils vivent d’herbes & fe nour-
riffent largement des nouvelles produâions de la
terre; la membraneadipeufe s’étend, s’augmente,
& fe remplit par la furabondance de cette bonne
nourriture ; les follécules fe renouvellent, fe rem<
pliffent ; les parties de la génération fe.dérident,
fe gonflent, & c’eft alors que ces' animaux prennent
une odeur dé mufc fi forte , qu’elle n’eft pas fup-
portable. Cette odeur , quoique fuave pour les
“Européens , déplaît fi fort aux fauvages , qu’ils
ont appelle puante une rivière fur les bords de
laquelle habitent en grand nombre ces aïs muf-
qués, qu’ils appellent aufli rats puants
Ils produifent une fois par an , & * in*.] ou ftx
petits à la lois. La durée de la geftation n’eft pas
longue ,. puifqu’ils n’entrent en amour qu’au commencement
de l’été r & que les petits font déjà
grands.au mois d’odobre , lorfqu’il faut fuivre
leurs père 8c mère dans la cabane qu’ils, conftcuifent
de nouveau tous les ans ; car ils ne reviennent
jamais, à leurs anciennes habitations.
Leur voix eft une efpèce de gémiffement que
les chaffeurs imitent pour les piper & les faire
approcher; L^ondatra ne nage ni aufli vite ni aufli
long-temps que le caftor : il va plus fouvent à
terre ; il ne court jpas bien. 8c marche encore
plus mal, en fe berçant à peu près comme, une
oie. Sa peau conferve une odeur de mufc , qui
fait qu’on ne s’en fert pas volontiers pour fourrures
, mais on emploie le fécond poil ou duvet
dans la fabrique des chapeaux..
Ces animaux ne font point, farouches ^ & en
les prenant petits, on peut les apprivoifer aifë-
ment ils font même très-jolis dans le premier
âg e, parce que leur queue, dont la longueur &
la" nudité rend leur figure défagréable, eft alors
fort courte. Ils jouent innocemment 8c aufli follement
que des petits chats , 8c on les nourriroit
volontiers fi leur odeur n’étoit pas incommode.
Le calamus aromaticus eft la plante dont Y ondatra
fe nourrit le plu6 volontiers. Cet animal eft particulier
au Canada., & il ne faut pas le confondre
avec le defman, non plus qu’avec le pilori ou rat
mufqué des Antilles. ToyeçDESMAN 8c Pilo r i.,
Ondathra, chez les Hurons, Ondatra.
OPASSUM, deLaët,eft lefarigue. V, Sarigue.
O P H
OPHION , chez les anciens Grecs * étoit vrai-
femblablement le mouflon. Voyeç ce mot. ...
OPOSSUM, nom- fous lequel plufieurs Auteurs
défignent le langue. Voyeç Sarigue.
ORANG - O (JT AN G ( 1’ ) eft la première
efpèce de finge fans queue 8c celui qui a le plus
de reffemblances extérieures & phyfiques avec
l’homme : il a la face plate ,. nue.' & bafanée ;
les oreilles, les mains 8c les pieds, la poitrine ,
le ventre aufli nuds ; fur la tête font des poils
qui defcendent des deux côtés des tempes , en
manière de chevelure ; il y a. du poil fur le dos
& fur les lombesmais en petite quantité : il eft
le feul de tous les linges qui n’ait point d'abajoues ,
point de callofités fur les. feffes. ; le feul qui ,
comme l’homme r ait les feffes charnues , 8c des
molets ou gras de jambe , & par conféquent le
mieux conformé de tous pour marcher debout ;
mais comme les doigts de fes pieds font fort longs ,
8c que fon talon pofe plus difficilement à terre
que celui de l’homme , il court plus facilement
qu’il ne marche , 8c il. auroit befoin de talons
artificiels, plus élevés que ceux de nos fouliers,
fi l’on vouloit le faire marcher aifément ÔL longtemps*
Il diffère de l’homme à l’extérieur fur-tout par
le nez , qui n’eft pas proéminent ÿ par le front;
qui eft trop court par le. menton , qui n’eft pas-
relevé à. la bafe :: il a les- oreilles proportionnellement
trop grandes.; les yeux trop voifins l’un
de l’autre ; l’intervalle entre le nez 8c la bouche
trop-étendu ; les cuiffes relativement trop courtes-;
les bras trop longs ; les pouces, trop petits ; la
paume des mains trop longue- 8c trop ferrée ; les-
pieds plutôt. faits comme des mains que comme
des. pieds, humains ;. les, parties de la- génération
ne diffèrent prefqu’en rien de celles.de l’hotnme ,
8c celles, de la femelle font à l’extérieur fort
femblables à. celles de. la femme,
A l’intérieur, Yorang-outang diffère de: Phomms
par le nombre des. côtes. : l’homme, n’en a que
douze , & Yorang-outang en a treize ;. il a aufli
les vertèhres. du cou plus courtes , les. os du baffin
plus ferrés , les hanches plus- plattes , les orbites
des yeux plus enfoncées.; il n’y a point d’àpo-
phyfe. épineufe à- la première vertèbre du cou ,
les reins font plus ronds que ceux de l’homme ,
& les uretères ont une forme différente , auffi-
bien que la veffie & la véficule du fiel qui l'ont
plus étroites &. plus longues que dans, l’homme-.
Toutes les autres parties du* corps , de la tête &
des. membres .font parfaitement femblables à celles
de. l’homme.
De cette conformation pareille réfulte la fimi-
litude des mouvemens. Û orang■ outang copie fl
parfaitement les aérions de l’homme , que les
Indiens font excufables de l’avoir affocié à l’efpèce
humaine par le nom d'orang-outang, homme fm-
vage, qu’ils lui ont donné. On a vu: de ces animaux
s’affeoir à table, faire ufage de la feryfette-j».
o R A
du couteau ; de la cuiller 8c de la fourchette comme
les convives ; fe verfer à boire dans un verre ,
le choquer quand ils y étoient invités ; prendre
une taliè & une foucoupe, y mettre du fucre ,
y verfer du thé 8c le làiffèr réfroidir pour le boire ;-
le promener gravement avec les gens qui venoient
les vifiter ;. leur préfenter la main pour les reconduire
: on les à vu faire leur l i t , s’y coucher la
tête fur un oreiller ,& fe couvrir de couvertures ;
fe faire faigner 8c traiter lorfqu’ils étorent malades ;
on affure même qu’ils ont de la pudeur, & que
quand on les regarde , ils cachent avec les mains
les parties que la modeftie empêche de montrer.
Ces animaux ont l’air trifte , la démarche grave ,
le naturel doux 8c très-différent de celui des autres
finges. Pris jeunes, ils s’apprivoifent aifément ,
&. il ne faut , pour les faire obéir, que le figne
ou la parole du maître. On les emploie à differens
travaux domeftiques , comme à tourner la broche,
à piler dans un mortier, à rincer des verres , à
donner à boire, à aller quérir de l’eau à la rivière ,
dàns de petites cruches qu’ils rapportent pleines
fur leur tête ; mais lorfqu’ils font arrivés à la porte
de la maifon, fi on ne leur prend leurs cruches ,
ils les laiffent tomber, 8c voyant la cruche verfée
& rompue , ils. fe mettent à crier & à pleurer.
Ils mangent prefque de tout, mais ils préfèrent les
fruits mûrs 8c lecs à tout autre aliment, 8c le lait 8c
autres boiffons douces , au vin. Dans l’état de liberté
, -lorfque les fruits leur manquent, ils vont
au bord de la mer, où ils prennent des huîtres ,
des crabes, &c. Pour empêcher l’huitre de leur
attraper la patte en fe refermant, ils y jettent une
pierre qui l’empêche de fe fermer , 8c enfuite ils
mangent l’huitre fans crainte.
Ils fe conftruifent- des cabanes de branches entrelacées
; ils- font d’une force prodigieufe ; ils
font la guerre à l’éléphant ; 8c le chaffent de leurs
bois , ils attaquent de même les nègres * 8c les
forcent à fe battre avec eux ; fouvent on les a
vus porter, fur des arbres, des enfans de fept à
huit ans , qu’on avoit une peine incroyable à
-leur ôter. Ils font aufli très-paffionnés pour les
femmes, & tâchent de furprendre dèsnegreffes,
qu’ils gardent avec eux, 8c qu’ils nourriffènt très-
bien. Les nègres croient que c’eft une nation étrangère
qui eft venue s’établir chez eux ; & que s’ils
me parlent pas , c’eft dans la crainte qu’on ne les
faffe travailler.
On connoît deux variétés dans Fefpèce de
Yorang-outang la première, que les nègres appellent
p on go , qui eft au moins aufli grand & plus
fort que l’homme ; la fécondé, qu’ils nomment
jocko, qui eft beaucoup plus petit. L’efpèce eft
répandue dans les parties méridionales do l’Afrique
& des Indes.
Batte! dit, en parlant du pongo, qu’il eft , dans
toutes- fes proportions , femblable à l’homme ,
mais qu’il eft plus grand ; grand , dit-il, comme un
géant ; qu’il a; la face comme l’homme, les yeux
O R A ?.ô5
enfoncés, de longs cheveux aux côtés de la tête',
le vifage nud & fans poil, auffi bien que les oreilles
& les mains ;le corps légèrement velu, & qu’il nô
diffère de l’homme à l’extérieur que par les jambes-,
parce qu’il n’a que peu ou point de mollets ; que
cependant il marche toujours debout, qu’il dort
fur les arbres , 8c fe conftruit une hutte pour abri
contre le foleil 8c la pluie ; qu’il vit de fruits, 8c
ne mange point de chair ; qu’il ne peut parler ,
quoiqu’il ait plus d’entendement que -les autres
animaux ; que quand les nègres font du fe-ü dans
lés bois, ces pongos viennent s’affeoir autour &
fe chauffer ; mais qu’ils n’ont pas affez d’efpri't
pour entretenir le feu , en y mettant du bois ;
qu’ils vont de compagnie ., 8c tuent quelquefois
des nègres dans les lieux écartés ; qu’ils attaquent
même l’éléphant, qu’ils le frappent à coups de
bâtons , & le chaffent de leurs forêts ; qu’on ne peut
prendre ces pongos vivans , parce que dix hommes
ne fuffiroient pas pour en dompter un feul ; qu’oni
ne peut attraper que les petits tout jeunes ; que
la mère les porte marchant debout, & qu’ils fe
tiennent attachés à fon corps avec les mains 8c
les genoux. Le même Battel appelle enjocko, la
petite efpèce d’orang-outang,
M. de la Broffe , dans fon voyage à la côte
d’Angole, dit avoir connu à Lotvango une ne-
greffe enlevée par les orang- outangs , qui étoit
reftée trois ans avec eux , 8c en avoit toujours été
très-bien traitée. Leur taille , continue* M. de la
Broffe, a jufqu’à fix & fept pieds de haut, & ils
font d’une force fans égale. Ils cabanent, & fa
fervent de bâtons pour fe défendre ; ils ont la
face plate, le nez camus & épaté , les oreilles
plates , fans bourrelet, la peau un peu plus claire
que celle d’un mulâtre ; un poil long & clair femé
dans plufieurs parties du corps ; le ventre extrêmement
tendu , les talons plats 8c élevés d’un
demi-pouce environ par-derrière. Ils marchent fur
leurs deux pieds, 8c fur les quatre quand ils- ert
ont la fantaifie. « Nous en achetâmes deux jeunes
ajoute ce voyageur ; un- mâle 8c une femelle....«
Nous les portâmes à bord. Quand ils étoient à
table, ils fe faifoient entendre des moufles lorfqu’ils
avorent befoin de quelque chofe ; & quelquefois
, quand ces enfans refufoient de leur donner
ce qu’ils demandoient , ils fe mettoient en
colère , leur faififfoient les bras, les mordoient,
8c les abattoient fous eux.... Le mâle fut malade
en rade ; il fe faifoit fôigner comme une perfonne *
il fut même faigné deux fois- au bras droit. Toutes
les fois qù’if fe trouva depuis incommodé , il mon*
troit fon bras pour qu’on le faignât, comme s’il
eût fu que cela lui avoit fait du bien ».
Suivant la rélatron de Henri Groff, « il fe
trouve de ces- animaux vers le nord de Coromandel
, dans les forêts du domaine du- Roi de Car-
nate ; on en fit préfent dë deux, l’un mâle &
l’autre femelle y à„M. Home, gouverneur de Bombay,
Ils avoient à peine deux pieds de haut, mais