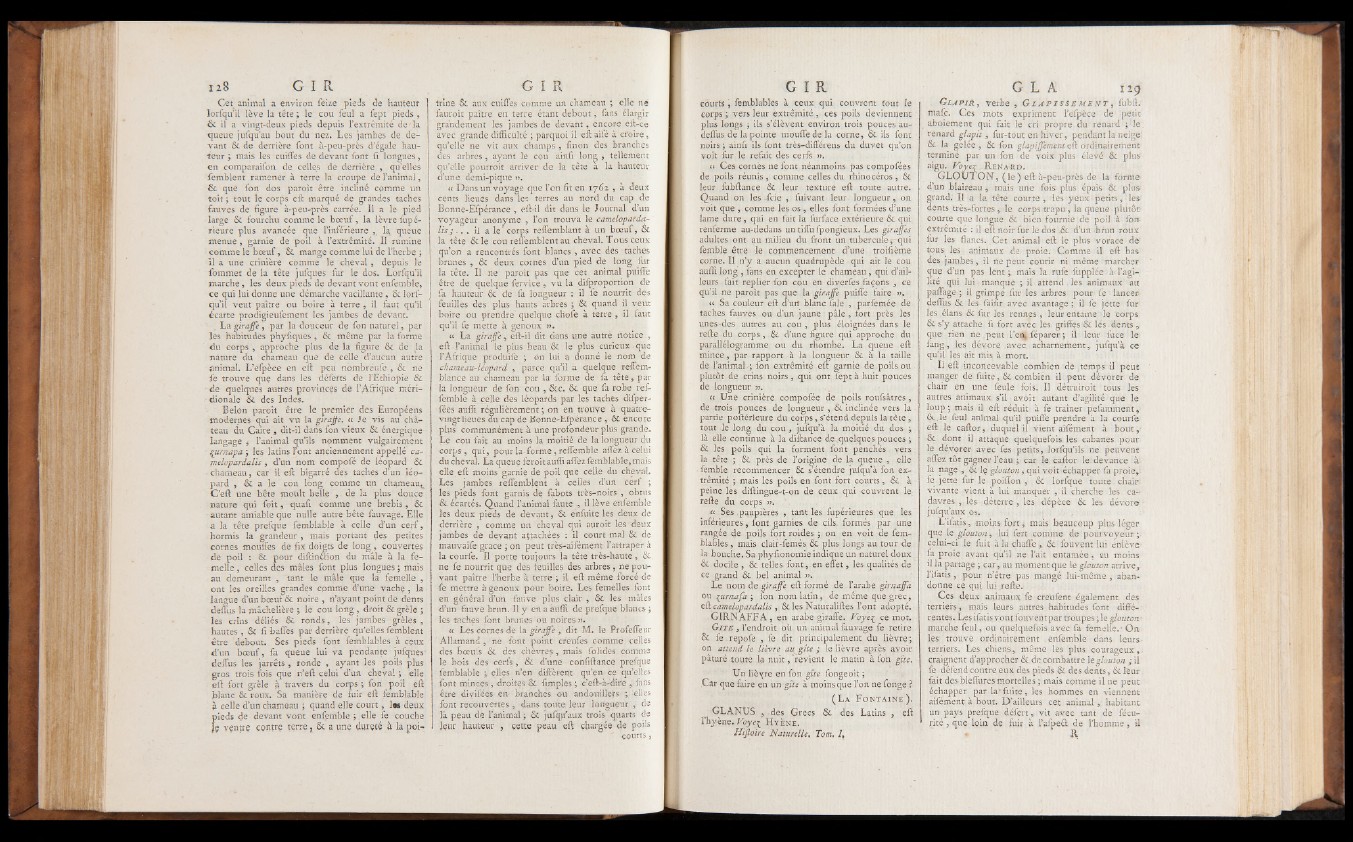
n 8 G I R
Cet animal a environ fèize pieds de hauteur
lorfqu’il lève la têtè ; le . cou feul a fept pieds ,
& il a vingt-deux pieds depuis l’extrémité de'la
queue jufqu’au bout du nez. Les jambes de devant
ôt de derrière font à-peu-près d’égale hauteur
; mais les cuiffes de devant font h longues,
en comparaifon de celles de derrière . , qu’elles
Semblent ramener à terre la croupe de l’animal,
& que fon dos paroît être incliné comme un
toit ; tout le corps eft marqué de grandes taches
fauves de figure à-peu-près carrée. Il a le pied
large ôt fourchu comme le boeuf, la lèvre fupé-
rieure plus avancée que l’inférieure ,, là queue
menue, garnie de poil à l’extrémité. Il rumine
comme le boeuf, & mange comme lui de l’herbe ;
il a une crinière comme le cheval, depuis le
fommet de la tête jufques fur le dos. Lorfqu’il
marche, les deux pieds de devant vont enfemble,
ce qui lui donne une démarche vacillante , & lorfqu’il
veut paître ou boire à terre , il faut qu’il
écarte prodigieufement les jambes de devant.
La girafe , par la douceur de fon naturel, par
les habitudes phyfiques , ôt même par la forme
du eorps , approche plus de la figure & de la
nature du chameau que de celle d’aucun autre
animal. L’efpèce en eft peu nômbréufe-, & ne
fe trouve que dans les déferts de l’Ethiopie &
de quelques autres provinces de l’Afrique méridionale
& des Indes.
Belon paroît être le premier des Européens
modernes qui ait vu la girafe. « Je vis au château
du Caire , dit-il dans fon vieux & énergique
langage , l’animal qu’ils nomment vulgairement
çurnapa ; les latins l’ont anciennement appellé ca-
jnelopardalis, d’un nom compofé de léopard &
• chameau, car il eft bigarré des taches d’un léopard
, & a le cou long comme un chameau^
C ’eft une bête moult belle de la plus douce
nature qui foit, quafi comme une brebis., &
autant amiable que nulle autre bête fauvage. Elle
a la tête prefque femblable à celle d’un cerf,
hormis la grandeur, mais portant des petites
cornes moulfes de fix doigts de long , couvertes
de poil : & pour diftincfion du mâle à la fé-
melle, celles des mâles font plus longues ; mais
au demeurant , tant le mâle que là femelle ,
ont les oreilles grandes comme d’une vache, la
langue d’un boeuf & noire , n’ayant point de dents
dèflus la mâchelière ; le cou lpng , droit & grêle ;
les crins déliés ôt ronds, les' jambes grêles ,
hautes , & fi baffes par derrière qu’elles femblent
être débout. Ses pieds font femblables à ceux
d’un boeuf, fa queue lui va pendante jufques'
deffus les jarrêts , ronde , ayant les poils plus
gros trois fois que n’eft celui d’un cheval ; elle
eft fort grêle à travers du corps ; fon poil eft
blanc & roux. Sa manière de fuir eft femblable
à celle d’un chameau ; quand elle court, les deux
pieds de devant vont enfemble ;. elle fe couche
Jç yentre contre terre ? ôt a une durçté à la poi-
G I R
trine ôt aux cuiffes comme un chameau ; elle né
fauroit paître en terre étant debout, fans élargir
grandement les jambes de devant, encore eft-ce
avec grande difficulté ; parquoi il eft ailé à cfoire,
qu’elle ne vit aux champs , finon des branches
ces arbres, ayant le cou ainfi long , tellement
qu’elle poùrroit arriver de la tête a la hauteur
d’une demi-pique ».
« Dans un voyage que l’on fit en 1.762. , à deux
cents lieues dans les terres au nord du cap de
Bonne-Efpérance , eft-il dit dans le Journal d’un
voyagèur anonyme , l’on trouva le camelopatda-
lis3 . . . il a le corps reffemblant à un boeuf, oc
la tête & le cou reffemblent au cheval. Toüs ceux
qu’on a rencontrés font blancs , avec, des taches
brunes , & deux cornes d’un pied de long fur
la tête. Il ne paroît pas que cet animal puiffe
être de quelque fervice , vu la difproportion de
fa hauteur & de fa longueur : il fe nourrit des
feuilles des plus hauts arbres ; ôt quand il veut
boire ou prendre quelque chofe à terre , il faut
qu’il fe mette à genoux ».
« La girafe, eft-il dit dans une autrè notice ,
eft l’animal le plus beau ôt le plus curieux que
l’Afrique prodüife ; pn lui a donné le nom de
chameau-leopard , parce qu’il a quelque reffem-
blance au chameau par la forme de fa tête, par
la longueur de fon cou , ôte. ôt que fa robe ref-
femble à celle des léopards par les taches difper-
fées auffi régulièrement ; on en trouve à quatre-
vingt lieues du cap de Bonne-Efpérance , ôt encore
plus communément à une profondeur plus grande.
Le cou fait au moins la moitié de la longueur du
corps , qui, pour la-forme, reffemble affez à celui
du cheval. La queue feroit auffi affez femblable * mais
elle eft moins garnie de poil que celle du cheval.
Les jambes reffemblent à celles d’un cerf ;
les pieds font garnis dé fabots très-noirs , obtus
ôt écartés. Quand l’animal faute , il lève enfemble
les deux pieds de devant, ôt enfuite les deux de
derrière , comme un cheval qui auroit les deux
jambes de devant attachées : il court mal ôt' de
mauvaife grâce ; on peut très-aifément l’attraper à
la courfe. Il porte toujours la tête très-hauteôt.
ne fe nourrit que des feuilles des arbres, ne pouvant
paître l’herbe à terre ; il eft même forcé de
fe mettre à genoux pour boire. Les femelles font
en général a?un fauve plus clair , ôt les mâles
d’pn fauve brun. Il y en a aüffi de prefque blancs ;
les taches font brunes ou noires».
« Les cornes de la girafe , dit M. le Profeffeur
Allamand, ne font point creufes comme celles
des boeufs ôt des chèvres,. mais folides comme
le bois des cerfs, ôt d’une confiftance prefque
femblable ; elles n’en diffèrent qu’en ce qu’elles
font minces1 j droites ôt fimples ; ceft-à-dire ,-fans
être divifée’s en branches ou andouillefs- -elles,
font recouvertes , dans toute leur longueur , de
là peau de l’animal ; ôt jufqjfaux trois quarts de
leur hauteur , cette peau eft chargée de poils
" courts,
G I R
courts, femblables à ceux qui couvrent fout le
corps ; vers leur extrémité , ces poils deviennent
plus longs ; ils s’élèvent environ trois pouces au-
aeffus de la pointe moufle de la corne, ôt ils font
noirs ; ainfi ils font très-différens du duvet qu’on
voit fur le refait des cerfs ».
« Ces cornés ne font néanmoins pas compofées
de poils réunis, comme celles du rhinocéros, ôt
leur fubftance ôt leur texture eft toute autre.
Quand on les -feie , fuivant leur longueur, on
voit que , comme les os, elles font formées d’une
lame dure , qui en fait la furface extérieure ôt qui
renferme au-dedans un tiffu fpongièux. Les girafes
adultes ont au milieu du front un tubercule^ qui
femble être le commencement d’une troisième
corne. Il n’y a aucun quadrupède qui ait le cou
auffi long , fans en excepter le chameau, qui d’ailleurs
fait replier fon cou en diverfes façons , ce
qu’il ne paroît pas que la girafe puiffe faire ». •
« Sa couleur eft d’un blanc la ie , parfemée de
taches fauves ou d’un jaune . pâle, fort près les
unes-des autres au cou, plus éloignées dans le
refte du corps,. ôl d’une figure qui approche du
parallélogramme,, ou du rhombe. La queue eft
mince, par rapport à la longueur ôt à la taille
de ranimai^; fon extrémité eft garnie de poils ou
plutôt de crins noirs, qui ont fept à huit pouces
de longueur ».
« Une crinière compofée de poils roufsâtres,
de trois.pouces de longueur ,.ôt inclinée vers la
partie poftérieure du corps, s’étend depuis la tête,
tout Je long du cou , jufqu’à la moitié du dos ;
là elle continue à la diftance de^quelques pouces ;
ôt les poils qui la forment font penchés vers .
la tête ; ôt près de l’origine de la queue , elle
femble recommencer ôt s’étendre jufqu’à fon extrémité
; mais les poils en font fort courts, ôt à
peine les diftingue-t-on de ceux qui couvrent le.
refte du corps ». ,v.
■« Ses .paupières , tant les fupérieures que les
inférieures, font garnies de cils, formés par une
rangée de poils fort roides ; on en voit de femblables
, mais clair-femés ôt plus longs au tour de
la bouche. Sa phyfionomie indique un naturel doux
Ôt docile , ôt telles, font , , en effet, les qualités de
ce grand ôt bel animal ».
Le nom de girafe eft formé de l’arabe girnafa
ou çurnafa ; ion nom latin, de même que grec,
eft camelopardalis , ôt les Naturaliftes l’ont adopté.
GlRNAFFA, en arabe giraffe. Voye£ ce mot.
Gîte 3 l’endroit où un animal fauvage fe retire,
ôt fe . repofe , fe dit principalement du lièvre ;
on attend le lièvre au gîte ; le lièvre après avoir
pâturé , toute la nuit, 'revient le matin à fon gîte.
Un lièyre en fon gîte fongeoit ; ‘ *.
Car que faire en un gîte à moins que l’on ne fonge ?
( L a F o n t a in e )..
GLANUS ? des Grecs ôt des Latins , eft
l’hyène. Voye^ Hy è n e .
Hïjloire Naturelle. Tom. Jx
G L A x i )
Gl a p ir , verbe , G l a p i s s e m e n t , fubft.
mafe. Ces mots expriment l’éfpèce de petit
aboiement qui fait le cri propre du renard ; le .
renard glapit, fur-tout en hiver , pendant la neige-:
ôt la gelée , ôt fon glapifenient eft ordinairement
terminé par un fon de voix plus élevé ôt plus
aigu. Voye{ R e n a -r d .
GLOUTON, (le ) eft à-peu-près de la forme
d’un blaireau, mais une fois plus épais ôt plus
grand. Il a la tête courte , les yeux petits, les
dents très-fortes ,. le corps trapu , la queue plutôt-
courte que longue ôt bien fournie de poil à fon-
extrémité : il eu noir fur le dos ,ôt d’un /brun roux
fur les flancs. .Cet animal eft le plus vorace de-
tous les animaux de proie. Comme il eft bas
des jambes, il ne peut courir ni même marcher
que d’un pas lent; mais la rufe fupplée - à- l’agi-,
lité qui lui manque ; il attend . les animaux au
paffage ; il grimpé fur les arbres pour fe lancer.-
deffus ôt les faifir avec avantage ; il fe jette fur
les élans ôt fur les rennes , leur entame le corps
ôt s’y attache fi fort avec les. griffes :ôt lés- dents 5
que rien ne .peut l’eia§ féparer ; il leur fuce le
fang., les dévore avec acharnement, jufqu’à ce
qu’il les ait mis. à mort.
Il eft inconcevable combien de temps il peut
manger de fuite, ôt combien il peut dévorer de
chair en une feule fois. Il détruiroit tous les
autres animaux s’il avoit autant d’agilité que le
loup ; mais il eft réduit à fe traîner pefamment,
ôt.le feul animal qu’il puiffe prendre à la courfe
eft le caftor, duquel il vient aifément à bout ,•
ôt dont il attaque quelquefois les cabanes pour
le dévorer avec fes petits, .lorsqu’ils ne peuvent
affez tôt gagner l’eau ; car le caftor le: devance à
la nage, ôtJe glouton, qui voit^échapper fa proie,
fe jette fur le poiffon , ôt lorfque toute - chair-
vivante vient à lui manquer , - il cherche les ca-*
davres:,,lês déterre , les, dépèce ôt les dévore
jufqu’aux os. . ., . .
L’ifatis., moins fort j mais beaucoup plus léger
que le glouton, lui fert comme de pourvoveur ;•
celui-ci le fuit àlaohaflé, ô t: fouvent lui enlève-
fa proie avant qu’il ne l’ait entamée, au moins
ilia partage ; car, au moment que le glouton arrive,
l’ifatis, pour n’être pas mangé lui-même , abandonne
ce qui lui refte.
Ces deux animaux fe creufent également des
terriers, mais leurs autres habitudes font différentes.
Les ifatis vont fouvent par troupes ; le glouton •
marche feul, ou quelquefois avec fa femelle.-On
les trouve ordinairement enfemble dans leurs-
terriers. Les chiens, même les plus courageux,.
craignent d’approcher ôt de combattre 1 qglouton ; il
fe défend contre eux des pieds ôt des dents, & leur .
fait des bleffures mortelles ;.mais comme il ne peut
échapper par la* fuite, les hommes en viennent
aifément à bout. D’ailleurs cet animal , habitant
un pays prefque défert, vit avec tant de fécu-
fité, que loin de fuir à l’afpefr de l’homme, il