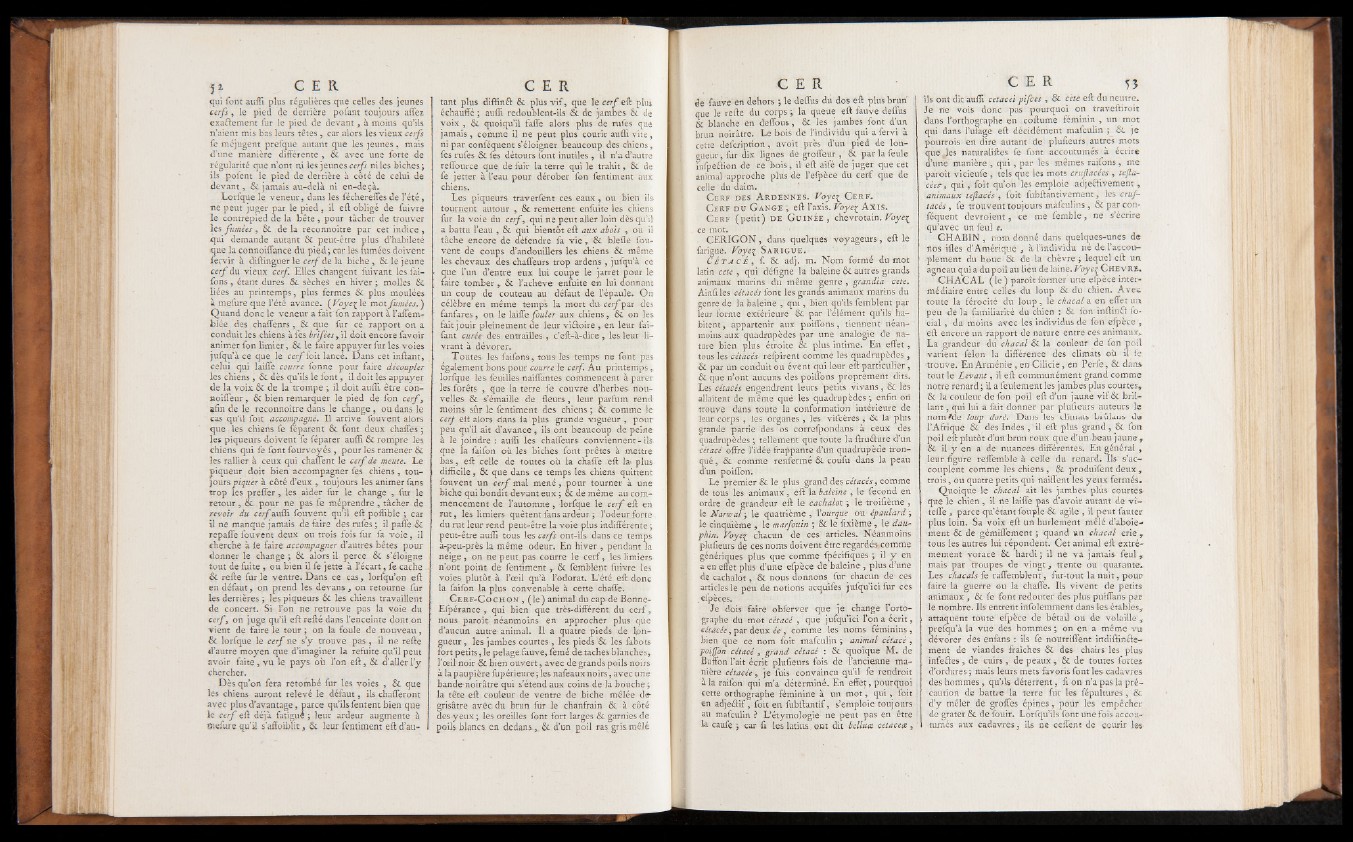
qui font auffi plus régulières que celles des jeunes
cerfs, le pied de derrière pofant toujours affez
exa&ement fur le pied de devant 3 à moins qu’ils
n’aient mis bas leurs têtes , car alors les vieux cerfs
fe méjugent prefque autant que les jeunes, mais
d’une manière différente, & avec une forte de
régularité que n’ont ni les jeunes cerfs ni les biches;
ils pofent le pied de derrière à côté de celui de
devant, & jamais au-delà ni en-deçà.
Lorfque le veneur, dans les féchereffes de l’été,
ne peut juger par le pied, il eft obligé de fuivre
le contrepied de la bête , pour tâcher de trouver
les fumées -, & de la reconnoître par cet indice ,
qui demande autant & peut-être plus d’habileté
que la connoiffance du pied ; car les. fumées doivent
fervir à diftinguer le cerf de la biche , & le jeune
cerf du vieux cerf Elles changent fuivant les faisons
, étant dures &. sècheS en hiver ; molles &
liées au printemps, plus fermes & plus moulées
à mefure que l’été avance. (Voyelle mot fumées.)
Quand donc le veneur a fait fon rapport à Faffem-
blée des chalTenrs, & que fur ce rapport on a
conduit les chiens à fes brïfées , il doit encore favoir
animer fon limier, & le faire appuyer fur les voies
jufqu’à ce que le cerf foit lancé. Dans cet inftant,
celui qui laiffe courre fonne pour faire découpîer
les chiens , & dès qu’ils le font, il doit les appuyer
de la voix & de la trompe ; il doit aufîi être con-
»oiffeur, & bien remarquer le pied de fon cerf s
afin de le reconnoître dans le change , ou dans le
cas qu’il foit accompagné. Il arrive fouvent alors I
que les chiens fe feparent & font deux chaffes ;
les piqueurs doivent fe féparer auffi & rompre les j
chiens qui fe font fourvoyés , pour les ramener &
les rallier à ceux qui chaffent le cerf de meute. Le
piqueur doit bien accompagner fes chiens , toujours
piquer à côté d’eux , toujours les animer fans
trop les preffer, les aider fur le change , fur le
retour, &. pour ne pas fe méprendre, tâcher de
revoir du cerf auffi. fouvent qu’il eft poflible ; car
il ne manque jamais de faire des rufes ; il paffe &
repaffe fouvent deux ou trois fois fur fa voie, il
cherche à fe faire accompagner d’autres bêtes pour
donner le change ; & alors il perce & s’éloigne
tout de fuite , ou bien il fe jette à l’écart, fe cache
& refte fur le ventre. Dans ce cas , lorfqu’on eft
en défaut, on prend les devans , on retourne fur
les derrières ; les piqueurs & les chiens travaillent
de concert. Si- l’on ne retrouve pas la voie du
cerf 3 on juge qu’il eft refté dans l’enceinte dont.on
vient de faire le tour ; on la foule de nouveau,
& lorfque le cerf ne s’y trouve pas, il ne refte
d’autre moyen que d’imaginer la refuite qu’il peut
avoir faite, vu le pays où. l’on eft, & d’aller l’y
chercher.
Dès qu’on fera retombé fur les voies , & que
les chiens auront relevé le défaut, ils chafferont
avec plus d’avantage, parce qu’ils fentent bien que
le cerf eft déjà fatigué ; leur ardeur augmente à J
tnefure qu’il s'affaiblit& leur fentiment eft d’au- I
tant plus diftinél & plus vif, que le cerf eft plus
échauffé ; aufîi redoublent-ils &. de jambes & de
voix , & quoiqu’il faffe alors plus de rufes que
jamais, comme il ne peut plus courir aufîi vite,
ni par conféquent s’éloigner beaucoup des chiens,
fes rufes & fes détours font inutiles , il n’a d’autre
reffource que de fuir la terre qui le trahit, &. de
fe jetter à l’eàu pour dérober fon fentiment aux
chiens.
Les piqueurs traverfent ces eaux, ou bien ils
tournent autour , & remettent enfuite les chiens
fur la voie du cerf, qui ne peut aller loin dès qu’il
. a battu l’eau , & qui bientôt eft aux abois , ou il
tâche encore de défendre fa v ie , &. blefïe fouvent
de coups d’andouillers les chiens & même
les chevaux deschaffeurs trop ardens , jufqu’à ce
que l’un d’entre eux lui coupe le jarret pour le
faire tomber, & l’acheve enfuite en lui donnant
un coup de couteau au défaut de l’épaule.. Gn
célèbre en même temps la mort du- cerf par des
fanfares , on le laiffe fouler aux- chiens, &. on les
fait jouir pleinement de leur viéloire , en leur fai-
fant curée des entrailles , c’eft-à-dire , les leur livrant
à dévorer.
Toutes les faifons, tous les temps ne- font pas
egalement bons pour courre le cerf. Au printemps,
lorfque les feuilles naiffantes commencent à parer
les forêts , que la terre fe couvre d’herbes nouvelles
& s’émaille de fleurs, leur parfum rend
moins sûr le fentiment des chiens , & comme Je
cerf eft alors dans fa plus grande vigueur , pouf
peu qu’il ait d’avance, ils ont beaucoup de peine
à le joindre : aufîi les ehaffeurs. conviennent - ils.
que la faifon où les biches font prêtes à mettre
bas, eft celle de toutes où la chaffe eft la*, plus
difficile, & que dans ce temps les chiens quittent
fouvent un cerf mal mené, pour tourner à une
biche qui bondit devant eux ; & de même au commencement
de l’automne, lorfque le cerf eft en
rut, les limiers quêtent fans ardeur. ; l’odeur forte
du rut leur rend peut-être la voie plus indifférente ;
peut-être auffi tous les cerfs ont-ils dans ce temps
à-peu-près la même odeur. En hiver , pendant la
neige, on ne peut. pas. courre le cerf, les limiers
n’ont point de fentiment r & femblent fuivre les
voies plutôt à l’oeil qu’à l’odorat. L’été, eft donc
la faifon la plus convenable à cette chaffe;
C e r f - C o c h o n , (le) animal du cap-de Bonne-
Efpérance> qui bien que très-différent, du cerf,
nous paroît néanmoins en approcher plus que
d’aucun autre- animal. Il a quatre pieds de longueur,
les jambes courtes, les pieds & les fabots
fort petits,le pelage.fauve, femé détachés blanches1,
l’oeil noir & bien ouvert, avec de grands poils noirs
à la paupière fupérieure ; les nafeaux noirs, avec une
bande noirâtre qui s’étend aux coins de la bouche ;
la tête eft couleur de ventre de biche mêlée de
grisâtre avêc du brun fur le chanfrain & à côté
des yeux; les oreilles font fort larges & garnies de
poils blancs en dedans.,.. & d’un poil ras. gris mêlé
de fauve en dehors ; le deffus du dos e ft plus bru n ,1
que le refte du co rp s ; la q ueue eft fau v e deffus
& blanche en d e ffo u s , & les jamb es font d’un
brun n o irâ tre . L e bois de l’individu qui a f e r v i à
cette d e f c r ip tio n , a v o it p rè s d’un p ied de longueur
, fur d ix lignes de g roffeur , & p a r la feule ;
înfpeftion de c e b o i s , il e f t aifé de ju g e r que c e t
animal ap p ro ch e plus de l’e fp è ce du c e r f que de
celle du daim.
C e r f d e s A r d e n n e s . Voye^ C e r f .
C e r f d u G a n g e ; eft l’a xis . Voye^ A x i s .
C e r f ( p e t i t ) d e G u i n é e , ch e v ro ta in . Voye^
ce mo t.
C E R IG O N , dans quelqües v o y a g eu r s , eft le
farigue. Voyeç S a r i g u e .
Cétacés f. & ad j. m . N om fo rm é du m o t
latin cete , qui déftgne la baleine & au tre s grands
animaux marins du m êm e g en re , grandia cete.
Ainfi les cétacés font les grands an im au x marins du
genre de la baleine , q u i , bien qu’ils femblent par
leur fo rm e e x fé rieu re & p ar l’é lém en t qu’ils habitent
, appartenir au x p o iffo n s , tien n en t néanmoins
au x quadrupèdes p a r une analogie de nature
bien plus é tro ite & plus in tim e . E n e f f e t ,
tous l e s cétacés/ refp iren t com m e lés quadrupèdes ,
& par Ain con d u it ou év en t qui leur eft p a rticu lie r ,
& que n’o n t aucuns des poiffons p ro p rem en t dits.
Les cétacés en g en d ren t leurs ^petits v iv a n s , & les
allaitent de m em e qué les quadrupèdes ; enfin ori
trouve dans to u te la co n fo rma tio n in té rieu re de
leur co rp s , les o rgan e s , le s v i f c è r e s , & la plus
grande p artie des o s co rre fp on d an s à c e u x des
quadrupèdes ; te llem en t que to u te la ftruéhire d ’un
cètacé offre l’idée frap p an te d’un quadrupède tro n qué
& com m e ren fe rm é &. coufu dans la p eau
d’un poiffon'.
L e p rem ie r & le plus gran d des cétacés, com m e
de tous les a n im a u x , e ft la baleine , le fé co n d en
ordre de gran deur e ft le cachalot ; le tro ifièm e ,
le Narwal ; le q u atrième , Yourquè ou èpaulard ;
le cinquième , le marfouin ; & le fix ième , le dauphin.
Voye£ ch a cu n de c e s a rtic le s . N é anm o in s
plufieurs de ce s noms d o iv en t ê tre regardés^comme
génériques plus que com m e fpécifiques ; il y en
a en effet plus d’une e fp è ce de baleine , plus d’une
de c a c h a lo t, & nous donnons fur ch a cu n de ce s
articles le p eu de n o tion s acquifes jufqu’ie i fur ce s
.efpèées.
J e dois faire obferveir q u e j e ch an ge F o r to -
graphe du m o t cètacé , que jufqu’ic i l’o n a é c r i t ,
eétacée, p a r d eu x ée , com m e les n om s féminins ,
bien que c e n om foit mafculin ; animal cètacé ,
poiffon céiacè 3 grand cètacé : & quoique M . de
Buffon l’a it é c rit plufieurs fois de l’an cien n e m an
ière célacée, je fuis co n v a in cu qu’il fe ren d ro it
à la raifon qui m ’a d é termin é. E n e f fe t, p ourquoi
ce tte ortho graphe féminine à un m o t , q u i , fo it
en a d je& if, fo it en fu b ftan tif, s’emploie to u jo u r s ;
au mafculin ? L ’é tym o lo g ie ne p eu t pas en ê tre
la caufe ; ca r fi le s latins , o n t d it bellucc cetaceoe ,
ils ont dit auffi cetacei pifces , & cete eft du neutre.
Je ne vois donc pas pourquoi on traveftiroit
dans l’orthographe en <coftume féminin , un mot
qui dans l’ulage eft décidément mafculin ; & je
pourrois en dire autant de plufieurs autres mots
quejes haturaliftes fe font accoutumés à écrire
d’une manière , qui, par les mêmes raifons , me
paroît vicieufe , tels que les mots cruflacées , tefla-
cèes'-3 qui,< foit qu’on les emploie adjeâivement,
animaux tejlacés j foit fubftantivement, les cruf-
tacés, fe trouvent toujours mafculins , & par conféquent
devroient, ce me femble, ne s’écrire
qu’avec un feul e.
CHABIN , nom donné dans quelques-unes de
nos ifles d’Amérique , à l’individu né de l’accouplement
du bouc ■ Ô£ de la chèvre ; lequel eft un
agneau qui a du poil au lieu de laine. V?y<?£ C h e v r e .
CHACAL (le ) paroît former une efpèce intermédiaire
entre celles du loup & du chien. Avec
toute la férocité du loup, le chacal a en effet un
peu de la familiarité du chien : & fon inftinâ: fo-
cial , du moins avec les individus de fon efpèce ,
eft encore un rapport de nature entre ces animaux.
La grandeur du chacal & la couleur de fon poil
varient félon la différence des climats où il fe
trouve. En Arménie., en Cilicie, en Perfe, & dans-
tout le Levant, il eft communément grand comme
notre renard; U a feulement les jambes plus courtes,
& la couleur de fon poil eft d’un jaune vif & brillant,
qui lui a fait donner par plufieurs auteurs le
nomade loup doré. Dans les climats brûlans de
l’Afrique 8t des Indes , il eft plus grand, & fort
poil eft plutôt d’un brun roüx que d’un beau jaune ,
& il y en a de nuancés différentes. En général ,
leur figure reffemble à celle du renard. Ils s’accouplent
comme les chiens , & produifent deux ,
trois, ou quatre petits qui naiffent les yeux fermés.
Quoique le chacal ait les jambes plus courtes-
que le chien, il ne laiffe pas d’avoir autant de v î-
teffe, parce qu’étant fouple &. agile , il peut fauter
plus loin. Sa voix eft un hurlement mêlé d’aboiement
& de gémiffement ; quand un chacal crie,
tous les autres lui répondent. Cet animal eft extrêmement
vorace & hardi; il ne va jamais- feul,
mais par Troupes de vingt, trente ou quarante.
Les chacals fe raffemblent, fur-tout la nuit, pour
faire la guerre ou la chaffe. Ils vivent de petits
animaux & fe font redouter des plus puiffans par
le nombre. Ils entrent infolemment dans leaétables,
attaquent toute èfpëce de bétail ou de volaille ,
prefqu’à la -vue des hommes ; on en a même vu
dévorer des enfans : ils fe nourriffent indiftinéle—
ment de viandes fraîches & des chairs les plus
in'feéles, de cuirs , de peaux, & de toutes fortes
d’ordures ; mais leurs mets favoris font les cadavres
des hommes , qu’îls déterrent, fi on n’a pas la précaution
de battue la terre fur les fépultures, &
d’y mêler de groffes épines, pour les empêcher
de grater & de fouir. Lorfqu’ils font une fois aceou-
i tumés aux cadavres , ils ne ceffent de courir les