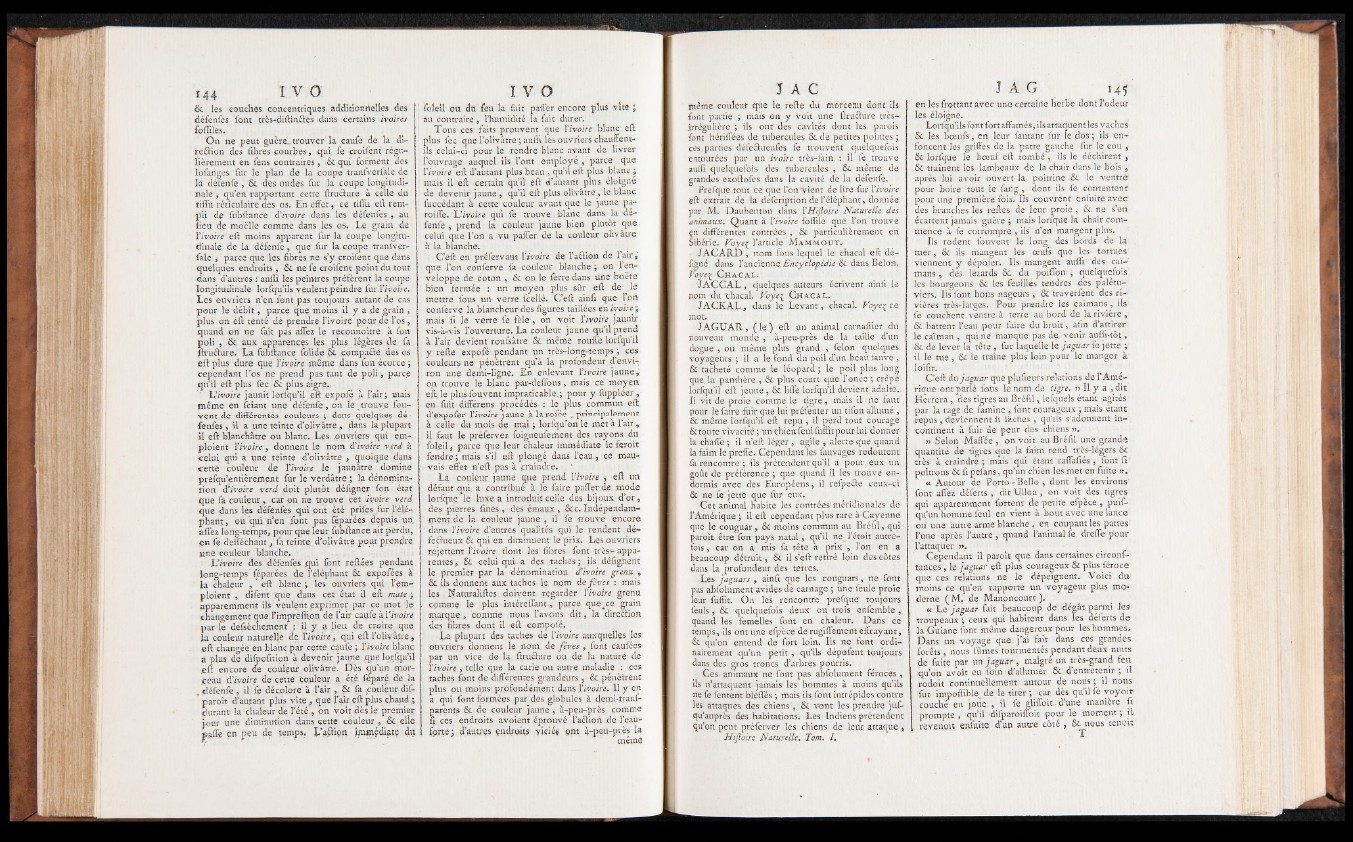
1 4 4 I V O
& les couches concentriques additionnelles des
défenfes font très-diftinûes dans certains ivoires
foffiles.
On ne peut guèreL. trouver la caufe de la direction
des fibres courbes, qui fe croifent régulièrement
èn fens contraires, & qui forment des
lofanges fur le plan de la coupe tranfverfale de
la défenfe , & des ondes fur la coupe longitudinale
, qu’en rapportant cette ftruéture à celle du
tiflu réticulaire des os. En effet, ce tiflu eft rempli
de fubftance d'ivoire dans les défenfes , au
lieu de moëlle comme dans les os. Le grain de
Y ivoire eft moins apparent fur la coupe longitudinale
de la défenfe, que fur la coupe tranlver-
fale , parce que les fibres ne s’y croifent que dans
quelques endroits, & ne fe croifent point du tout
dans d’autres : auffi les peintres préfèrent la coupe
longitudinale lorfqu’ils veulent peindre fur Y ivoire.
Les ouvriers n’en font pas toujours autant de cas
pour le débit, parce que moins il y a de grain ,
plus on eft tenté de prendre l’ivoire pour de l’os,
quand on ne fait pas allez le recpnnoîtrç à fpn
poli , & aux apparences les plus légères de
/tru&ure. La fubftance folide &. compafte des os
eft plus dure que Yivoïre même dans fon écorce ;
cependant l’os ne prend pas tant de poli , parce
qu il eft plus fec & plus aigre.
L’ivoire jaunit lorlqu’ij eft expofé à /’air; mais
même en fciant une défenfe, on le trouve fou-
vent .de différentes couleurs ; dans quelques défenfes
, il a une teinte d’olivâtre, dans la plupart
il eft blanchâtre ou blanc. Les ouvriers qui emploient
Y ivoire , donnent le nom d’ivoire verd à
celui qui a une teinte d’olivâtre , quoique dans
cette couleur de Y ivoire Je jaunâtre domine
prefqu’entièrement fur le verdâtre ; la dénomination
d’ivoire verd doit plutôt défignpf fon état
que fa couleur, car on ne trouve cet ivoire verd
que dans les défenfes qui ont été prifes fur /’éléphant,
ou qjii n’en /ont pas féparée? depuis un;
allez long-temps, pour que leur fubftance ait perdu,
en fe deffechant, fa teinte d’olivâtre pour prendre
jine couleur blanche.
L’ivoire des défenfes .qui lpnt reliées pendant
long-temps féparées de l’éléphant & expofées à
la chaleur , * eft blanc ; les ouvriers qui l’emploient
J difent que dans cçt état il eft mate ;
apparemment ils veulent exprimer par ce mot le
changement que l’impreffi.on de l’air caufe à l’ivoire
par le dessèchement : il y a heu de croire que
la couleur naturelle de Yiyoire , qui eft l’olivâtre,
eft changée en blanc par cette caufé ; Y ivoire blanc
a plus de difpofitipn à devenir jaune que loçfqu’il
eft encore de couleur olivâtre. Dès qu’qn morceau
d’ivoire de cette couleur a été feparé de la
. défenfe , il fe décolore à l’air 3S f fa couleur dif-
paroît d’autant plus vite ? que j’air eft plus chaud ;
durant la chaleur de l’été , on voit dès le premier
jour une diminution dans cette couleur , 6ç elle
paffe en peu de temps. L’a^lipn immédiate du
i v o
foleil ou du feu la fait pâfier encore plus vite ;
au contraire , l’humidité la fait durer.
Tous ces faits prouvent'que Y ivoire blanc eft
plus fec que l’olivâtre ; auffi. les ouvriers chauffent-
ils celui-ci pour le rendre blanc avant de livrer
l’ouvrage auquel ils l’ont employé , parce que
Y ivoire eft d’autant plus beau , qu’il eft plus blanc. ;
mais il eft certain qu’il eft d’autant plus éloigné
de devenir jaune , qu’il eft plus olivâtre, le blanc
fuccédant a cette couleur avant que le jaune pa-
roiffe. L'ivoire qui fe trouve blanc dans la de-
fenfe , prend la couleur jaune bien plutôt que
celui que l’on a vu pafier de la couleur olivâtre
à la blanche.
C’eft en préfervant Y ivoire de l’a&ion de l’air
que l’on conferve fa couleur blanche ; on l’enveloppe
de coton , & on le ferre dans une boëte
bien fermée : un moyen plus sûr eft de le
mettre fous un verre fcellé. C’eft ainfi que l’on
conferve la blancheur des figures taillées en ivoire ;
mais fi le verre fe fêle, on voit Y ivoire jaunir
vis-à-vis l’ouverture. La couleur jaune qu’il prend
à l’air devient roufsâtre & même rouffe lorfqu’il
y refte expofé pendant un très-long-tcmps ; ces
couleurs ne pénètrent qu’à la profondeur d’environ
une demi-ligne. En enlevant Yivoïre jaune,'
on trouve le blanc par-deflous, mais ce moyen
eft le plus fouyent impraticable,; pour y fuppléer,
en fuit différens procédés : le plus commun eft
d’expofer Y ivoire jaune à la rofée , principalement
à celle du mois d? mai ; lorfqp’on le met à l’air ,
il faut le préferver foigneufement des rayons du
foleil, parce que leur chaleur immédiate le feroit
fendre ; mais s’il eft plongé dans l’eau, ce mauvais
effet n’eft pas à praindre. v
La couleur jaune que prend Yivoïre eft un
défaut qui a contribué à le faire pafl’er de mode
lorfque le luxe a introduit celle des bijoux d’o r ,
des pierres fines , des émaux , &c. Indépendamment
de la couleur jaune , il fe trouve encore
dans Y ivoire d’autres qualités qui le rendent dé-
feéraeux & qui en diminuent le'prix. Les ouvriers
rejettent l’ivoire dont les'fibres font très ^apparentes,
ÔC celui qui-a des taches; ils défignçnt
, le premier par la dénomination d’ivoire grenu ,
& ils donnent aux taches le nom de fèves : mais
les Naturalises doivent regarder l’ivoire grenu
, comme le plus intéreffant, parce que mce grain
marque, comme nous l’avons d i t , la direction
des fibres dont il eft compofé.
La plupart des taches de l’ivoire auxquelles les
ouvriers donnent le nom de fèves, font caufées
par un vice de la ftruéture ou de la nature de
Yivoirç, telle que la carie ou autre maladie : ces
taches font de différentes grandeurs , & pénètrent
plus ou moins profondément dans Yivoïre. Il y en
a qui font formées par des globules à demirtranf-
! parents & de couleur jaune, à-peu-près comme
j ft ces endroits avoient éprouvé l’a&ion de l’eau-
fprte; d’autrçs endroit? vicié? ont à-peu-près la
m êm e
T A C
même couleur que le refte dii mofceau dont ils 1
font partie ; mais on y voit une ftruéture très-
irrégulière ; ils ont des cavités dont les parois
font hériffées de tubercules & de petites pointes ;
ces parties défeétueufes fe trouvent quelquefois
entourées par un ivoire très-fain : il fe trouvé
auffi quelquefois des tubercules , & même de
grandes exoftofes dans la cavité de la défenfe.
Prefque tout ce que l’on “vient de lire fur Y ivoire
eft extrait de la defcription de l’éléphant, donnée
par M. Daubenton dans YHifloire Naturelle des
animaux. Quant à l’ivoire foffile que l’on trouve
çn différentes contrées , & particulièrement en
Sibérie. Vo'ye£ l’article M a m m o u t .
JACARD , nom fous lequel le chacal eft dé-
figné dans l’ancienne Encyclopédie &. dans Belon.
Voye^ C h a c a l .
JACCAL , quelques auteurs écrivent ainfi le
nom du chacal. Voyeç C h a c a l .
JAGKAL, dans le Levant, chacal. Foye^ ce
mot..
JAGUAR, ( le ) eft un animal carnaffier du
nouveau monde , à-peu-près de la taille d’un
dogue , ou même plus grand , félon quelques
voyageurs ; il a le fond du poil d’un beau fauve ,
& tacheté comme le léopard ; le poil plus long
que la panthère , & plus court que l’once ; crêpe
lorfqu’il eft jeune , & lifte lorfqu’il devient adùlte.
Il vit de proie comme le tigre, mais il ne faut
pour le faire fuir que lui préfenter un tifon allumé ,
& même lorfqu’il eft repu , il perd tout courage
& toute vivacité ; un chien feul fuffit pour lui donner
la ch'afle ; il n’eft léger , agile , alerte que quand
la faim le prefle. Cependant les fauvages redoutent
fa rencontre ; ils prétendent qu’il a pour eux un
goût de préférence ; que quand il les trouve endormis
avec des Européens, il refpe&e ceux-ci
& ne fe jette que fur eux.
Cet animal habite les contrées méridionales de
l’Amérique ; il eft cependant plus rare à Cayenne
que le couguar, & moins commun au Bréfil, qui
paroît être fon pays natal, qu’il ne l’étoit autrefois,
car on a mis fa tête à prix , l’on en a
beaucoup détruit, & il s’eft retiré loin des côtes
dans la profondeur des terres.
Les jaguars , ainfi que les couguars, ne font
pas ablolument avides dé carnage ; une feule proie
leur fuffit. On les rencontre prefque toujours
feuls, & quelquefois deux ou trois enfemble ,
quand les femelles font en chaleur. Dans ce
temps , ils ont une efpèce de rugiflement effrayant,
& qu’on entend de fort loin. Ils ne font ordinairement
qu’un petit , qu’ils dépofent toujours
dans des gros troncs d’arbres pourris.'
Ces animaux ne-font pas abfolument féroces ,
ils n’attaquent jamais les-hommes à moins qu’ils
ne fe fentent bleffés ; mais ils font intrépides contre
les attaques des chiens , & vont les prendre juf—
qu’auprès des habitations. Les Indiens prétendent
qu’on peut préferver les chiens de leur attaque ,
Hijloire Naturelle. Tom. /.
J A G 14$
en les frottant avec une certaine herbe dont l’odeur
les éloigne.
Lorfqu’ils font fort affamés, ils attaquent les vaches
& les boeufs, en leur fautant fur le dos ; ils enfoncent
les griffes de la patte gauche fur le cou ,
& lorfque le boeuf eft tombé, ils le déchirent ,
& traînent les lambeaux de la chair dans le bois ,
après lui avoir ouvert la poitrine & le ventre
pour boire tout le fang, dont ils fe contentent
pour une première fois. Ils couvrent enfuite avec
des branches les reftes de leur proie, & ne s’en
écartent jamais guère ; mais lorfque la chair commence
à fe corrompre , ils n’en mangent plus.
Ils rodent fouvent le long des bords de là
mer, & ils mangent les oeufs que les tortues
viennent y dépoter. Ils mangent auffi des cai-1
mans, des lézards &. du poiffon J quelquefois
les bourgeons & les feuilles tendres des palétuviers.
Iis font bons nageurs , & traverfent des rivières
très-larges. Pour prendre les caïmans, ils
fe couchent ventre à terre au bord de la rivière,
& battent l’eau pour faire du bruit, afin d’attirer
le caïman , qui ne manque pas de venir auffi-tôt,
& dë lever la tête , fur laquelle le jaguar fe jette ;
il le tue, & le traîne plus loin pour le manger à
loifir. ' : - 1 r
C’eft du jaguar que plufieurs relations de l’Amérique
ont parlé fous le nom de tigre. » Il y a ,dit
Herrera , des tigres au Bréfil, lefquels étant agités
par la rage de lamine , font courageux ; mais étant
repus, deviennent fi lâches , qu’ils s’adonnent in-'
continent à fuir de peur des chiens' »?.
>? Selon Maffée, on voit au Bréfil une grande
quantité de tigres que la faim rend très-légers ÔC
très à craindre ; mais qui étant raflafiés , font fi
poltrons & fi pefans, qu’un chien les met en fuite ??.
« Autour de Porto - Bello , dont les environs'
font affe'îz déferts, dit Ulloa , on voit des tigres
qui apparemment fortent de petite efpèce, puif-
qu’un homme feul en vient à bout avec une lance
ou une autre arme blanche , en coupant les pattes
l’une après l’autre, quand l’animal fe dreffe pour
l’attaquer ??.
Cependant il paroît que dans certaines circonf-
tances, le jaguar eft plus courageux & plus féroce
que ces relations ne le dépeignent. Voici du
moins ce qu’en rapporte un voyageur plus moderne
( M. de Manoncourt ).
« Le jaguar fait beaucoup de dégât parmi le£
troupeaux ; ceux qui habitent dans les déferts de
la Guiane font même dangereux pour les hommes.
Dans un voyage que j’ai fait dans ces grandes
forêts , nous fûmes tourmentés pendant deux nuits
de fuite par un jaguar , malgré un très-grand feu
qu’on avoit eu foin d’allumer & d’entretenir ; il
rodoit continuellement autour de nous ; il nous
fut impoffible^ de le tirer ; car dès qu’il fe voyoit
couché en joue , il fe gliffoit d’une manière fi
prompte, qu’il' difparoiffoit pour le moment; il
revenoit enfuite d’un autre côté , &. nous tenoit