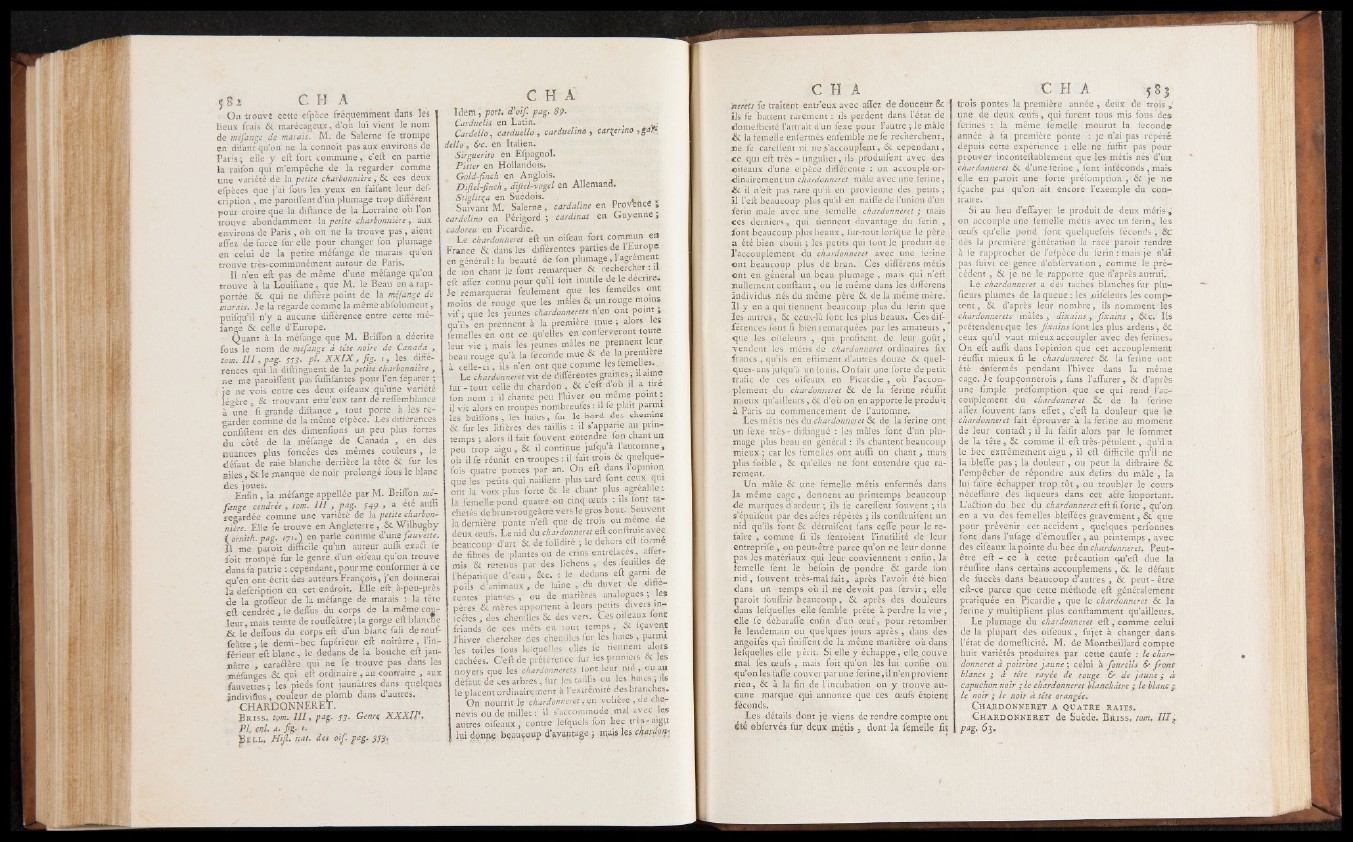
5 S i C H A
. On trouve cette efpèce fréquemment dans les
lieux frais & marécageux, d’où lui vient le nom
de méfange de marais. M. de Salerne fe trompe
en dil'ant qu’on ne la connoit pas aux environs de
Paris ; elle y eil fort commune, c’eil en partie
la raifon qui m’empêche de la regarder comme
une variété de la petite charbonnière, & ces deux
efpèces que j’ai fous les yeux en faifant leur def-
cription , me paroiifent d’un plumage trop différent
pour croire que la diftance de la Lorraine où l’on
trouve abondamment la petiti charbonnière, aux
environs de Paris , où on ne la trouve pas, aient
affez de force fur elle pour changer fon plumage
en celui de la petite méfange de . marais qu’on
trouve très-communément autour de Paris.
Il n’en eft pas de même d’une méfange qu’on
trouve à la Louifiane , que M. le Beau en a rapportée
& qui ne diffère point de la méfange de
marais. Je la regarde comme la même abfolument,
puifqu’il n’y a aucune différence entre cette mélangé
& celle d’Europe.
Quant à la méfange que M. Briffon a décrite
fous le nom de méfange à tête noire de Canada ,
tom. I I l , pag. SS3- pl• X X IX , fig. i , les différences
qui la diftinguent de la petite charbonnière ,
ne me paroiffent pas fuffifantes pour l’en féparer ;
i je ne vois entre ces deux oifeairx qu’une variété
légère & trouvant entr’eux tant de reffemblance
à une fi grande diftance , tout porte, à les regarder
comme de la même efpèce. Les différences -
confiftent en des dimenfions un peu plus fortes
du côté de la méfange de Canada , en des
nuances plus foncées des mêmes couleurs, le
défaut de raie blanche derrière la tête & fur les
ailes , & le manque de noir prolongé fous le blanc
des joues. '
Enfin , la méfange appellée par M. Brillon me-
fange cendrée , tom. III 3 pag. 549-, a été âufli
regardée comme une variété de la petite charbonnière.
Elle fe trouve en Angleterre , & Wilhugby
{ ornith. pag. 171.) en parle comme d’une fauvette. 11 me paroît difficile qu’un auteur suffi exaél fe
foit trompé fur le genre d’un oifeau qu’on trouve
dans fa patrie : cependant, pour me conformer à ce
qu’en ont écrit des auteurs François, j’en donnerai
la defcription en cet endroit. Elle eft à-peu-près
de la gr.offeur de la méfange de marais : la tête
eft cendrée , le deffus du corps de la même couleur
, mais teinte de rouffeâtre ; la gorge eft blanche
& le deffous du corps eft d’un blanc fali. de rouffeâtre
; le demi-bec fupérieur eft noirâtre, l’in-
iférieur eft blanc, le dedans de la bouche, eft jaunâtre
, caraâère qui ne fe trouve pas dans les
méfanges & qui eu ordinaire , au contraire „ aux
fauvettes ; les pieds font jaunâtres dans quelque'
individus , couleur de plomb dans d’autres.
CHARDONNERET.
Briss. tom. I I I , paß. 53, Genr( XXXII',
. Pl, m l H. fig- ’ ■
B ell. Hijl. nat. des oif. pag. gft.
C H À
Idem, port, d'oif. pag. 89-
Carduelis en Latin. . w
Cardeilo, carducllo , carduelino , car{_enno ,ga>*
dello, &c. en Italien.
Sirguerito en Efpagnol.
Pitter en Hollandois.
Gold-finch en Angloîs.
Difiel-finch, dijlel-vogel en Allemand.
Stiglitra en Suédois. ^ ,
Suivant M. Salerne, cardaline en Provence ,
cardelino en Périgord ; cardinal en Guyenne;
cadoreu en Picardie.
Le chardonneret eft un oifeau fort commun en
France & dans les différentes parties de 1 Europe
en général : la beauté de fon plumage, l’agrément
de ton chant le font remarquer & rechercher : il
eft affez connu pour qu’il foit inutile de le décrire.
Je remarquerai feulement que les femelles ont
moins de rouge que les mâles 8c un rouge moins
vif ; que les jeunes chardonnerets n’en ont point ;
qu’ils en prennent à la première mue ; alors les
femelles en ont ce qu’ellès en conferveront toute
leur vie ; mais les jeunes mâles ne prennent leur
j beau rouge qu’à la fécondé mue & de la première
à celle-ci, ils n’en ont que comme les femelles..
L e chardonneret vit de différentes graines ; il aime
fur-tout celle du chardon , §c ç’eft d Qu il a tue
fon nom : il chante peu l’h iv e r ou meme point :
il v i t alors en troupes n om b r eu fe s : il fe plaît parmi
les buiffons , les haies., fur le bord des chemins
Sc fur les lilière.s des taillis : il s’apparie au printemps
; alors il fait fo u v e n t entendre^ fon chant un
peu trop aigu , Sc il continue jufqu a 1 automne 9
où il fe réunit eu troupes : il fait trois & quelquefois
quatre pontes par an. On eft dans l'opinion
que les petits qui naiffent plus tard font ceux qui
ont la voix plus forte & le chant plus agréable :
la fem.elle pond quatre ou cinq oeufs : ils font tachetés
de brun-rougeâtre vers le gros bout. Souvent
la dernière ponte n’eft que de trois ou meme de
deux oeufs. Le nid du chardonneret eft confirait avèe
beaucoup- d’art &, de folidite ; le dehors eft forme
de fibres de plantes ou de crins entrelaces, affermis
& retenus par des lichens , des feuilles de
l’hépatique d’eau, &c. : le dedans eft garni de
poils d’animaux, de laine , du duvet de differentes
plantes , ou - de matières analogues; les
pères & mères apportent à leurs petits divers m-
leéles j des chenilles Sc des vers. Ces oifeaux lont
friands de ces mets en tout temps , Sc fçavent
l’hiver chercher des chenilles fur les haies , parmi
les toiles fous lesquelles elles fe tiennent alors
cachées. C’eft de préférence fur les pruniers oç les
noyers que les chardonnerets font leur nia , ou au
défaut de ces arbres , fur les taillis ou les haies;", ils
le placent ordinairement à l’extremite des brandies»
On nourrit le chardonneret, en volrere , de che-
I iievis ou de millet : il s’accommode.mal avec le,s
autres oifeaux, contre lefquels fon bec très - aigi?
lui donne be^uçoup d’ayantage ; les cnardpffr
r
C H A
ne rets fe traitent entr’eux avec allez de douceur Sc 1
ils fe battent rarement : ils perdent dans l’état de
domefticité l’attrait d’un fexe pour l’autre ; le mâle
Sc la femelle enfermés enfemble nefe recherchent,
ne fe carellent ni ne s’accouplent, & cependant,
ce qui eft très - fingulier, ils produifent avec des
©ileaux d’une efpèce différente : on accouple ordinairement
un chardonneret mâle avec une lerine,
Sc il n’eft pas rare qu’il en provienne des petits ;
il l’eft beaucoup plus qu’il en naiffe de l’union d’un
ferin mâle avec une femelle chardonneret ; mais
ces derniers, qui tiennent davantage du ferin ,
font beaucoup plus beaux , fur-tout lorfque le père
a été bien choili ; les petits qui font le produit de
l’accouplement du chardonneret avec une lerine
ont beaucoup plus de brun. Ces différèns métis
ont en général un beau plumage , mais qui n’eft
nullement confiant, ou le même dans les différèns
individus nés du même père Sc de la même mère. 11 y en a qui tiennent beaucoup plus du .1erin que
les autres, Sc ceux4à font les plus beaux. Çes différences
font fi bien remarquées par les amateurs ,
que les oîfeleurs , qui profitent de leur goût,
vendent les métis de chardonneret ordinaires fix
francsqu’ils en eftiment- d’autres douze & quelques
uns jufqu’à un louis. Gnfait une forte de petit
trafic de ces oifeaux en Picardie , où l’accou-
.plement du chardonneret Sc de la ferine réuflit
mieux qu’ailleurs, & d’où on en apporte le produit
à Paris au commencement de l’automne.
Les métis nés du chardonneret Sc de là ferine ont
un fexe très - diftingué : les mâles font d’un plumage
plus beau en général : ils chantent beaucoup
mieux ; car les femelles ont aulîi un chant, mais
plus foible, Sc qu’elles ne font entendre que rarement.
Un mâle Sc une* femelle métis enfermés dans
la même cage , donnent au printemps beaucoup
de marques d’ardeur ; ils fe careffènt fouvent ; ils
s’épuifent par des açles répétés ; ils conftruifent un
nid qu’ils font & détruifent fans ceffe pour le refaire
, comme fi ils fentoient l’inutilité de lèur
entreprife , ou peut-être parce qu’on ne leur donne
pas les matériaux qui leur conviennent : enfin, la
femelle fent le befoin de pondre Sc garde fon
nid, fouvent très-mal fait, -après l’avoir été bien
dans un - temps où il ne devoit pas fervir ; elle
paroît fouffrir beaucoup, Sc après des douleurs
dans lefqueïles elle femble prête à perdre la vie ;
elle fe débaraffe enfin d’un oeuf, pour retomber
le lendemain ou quelques jours après, dans des
angoifes qui finiffent de la même manière où dans
lefqueïles elle périt. Si elle y échappe, elle, couve
mal fes oeufs , mais foit qu’on les lui confie , ou
qu’on les faffe couver par une ferine, il n’en provient
rien, & à la fin de l’incubation on y trouve aucune
marque qui annonce que ces oeufs étoient
féconds.
L e s détails d o n t je v ien s de ren d re com p te o n t
é té ob fervés fur d eu x métis , don t la fem e lle fit
C H A 5 § î
trois pontes la première année , deux de trois
une de deux oeufs, qui furent tous mis fous de»
fermes : la même femelle mourut la fécondé
année à fa première ponte : je n’ai pas répété
depuis cette expérience : elle ne fuffit pas pour
prouver inconteftablement que les métis nés d’un
chardonneret Sc d’une lerine , font inféconds , mais
elle en paroît une forte préfomption , & je ne
fçache pas qu’on ait encore l’exemple du contraire.
Si au lieu d’effayer le produit de deux métis-,'
on accouple une femelle métis avec un ferin, les
oeufs qu’elle pond font quelquefois féconds , StC
dès la première génération la race paroît tendre
à fe rapprocher de l’efpèce du ferin : mais-je n’ai
pas fuivi ce genre d’obfervation, comme le précédent
, Sc je ne le rapporte que d’après.autrui.
Le chardonneret a des taches blanches fur plu-
fieurs plumes de la queue : les .oifeleurs les comptent
, Sc d’après leur nombre, ils nomment les
chardonnerets mâles , dixains, Jixains , &e. Us
prétendent que les J ixa in s font les plus ardens , Sc
ceux qu’il vaut mieux accoupler avec des fermes.
On eft aufli dans l’opinion que cet accouplement
réuflit mieux fi le chardonneret' Sc la ferine ont
été efcnfermés pendant l’hiver dans la même
cage. Je foupçonnerois , fans l’affurer, Sc d’après
une fimple préfomption que ce qui rend l’accouplement
du chardonneret Sc de la ferine
affez fouvent fans effet, ç’eft la douleur que le
chardonneret fait éprouver à la ferine au moment
de leur contaéf ; il la faifir alors par le fommet
de la tête , Sc comme il eft très-pétulent, qu’il a
le bec extrêmement aigu , .il eft difficile qu’il ne
la bleffe pas ; la douleur , ou peut la diftraire &
l’empêcher de répondre aux defirs du mâle , la
lui faire échapper trop tô t, ou troubler le cours
néceffaire des liqueurs dans cet aéfe important.
L’aéfion du bec du chardonneret eft fi forte , qu’on
en a vu des femelles bleffées gravement, & que
pour prévenir cet accident, quelques perfonnes
font , dans l’ufage d’émouffer , au printemps , avec
des cifeaux la pointe du bec du chardonneret. P.eut-
ê.tre eft - ce à cette précaution qu’eft due la
réuflite dans certains accouplemens, & le défaut
de fuccès dans beaucoup d’autres , & peut - être
eft-ce parce que cette méthode eft généralement
pratiquée en Picardie, que le chardonneret Sc la
lerine y multiplient plus conftamment qu’ailleurs.
Le plumage du chardonneret eft, comme celui
de la plupart des oifeaux, fujet à changer dans
l’état de domefticité. M. de Mdntbeillard compte
huit variétés produites par cette caufe : le char~
donneret à poitrine jaune ; celui à fourcUs & front
blancs ; à tète rayée de rouge & de jaune ; à
capuchon noir ; le chardonneret blanchâtre j le blanc
le noir ; le noir à tête orangée.
Chardonneret a quatre raies.
Chardonneret de Suède, Briss, tom, 111%
pag. 63.