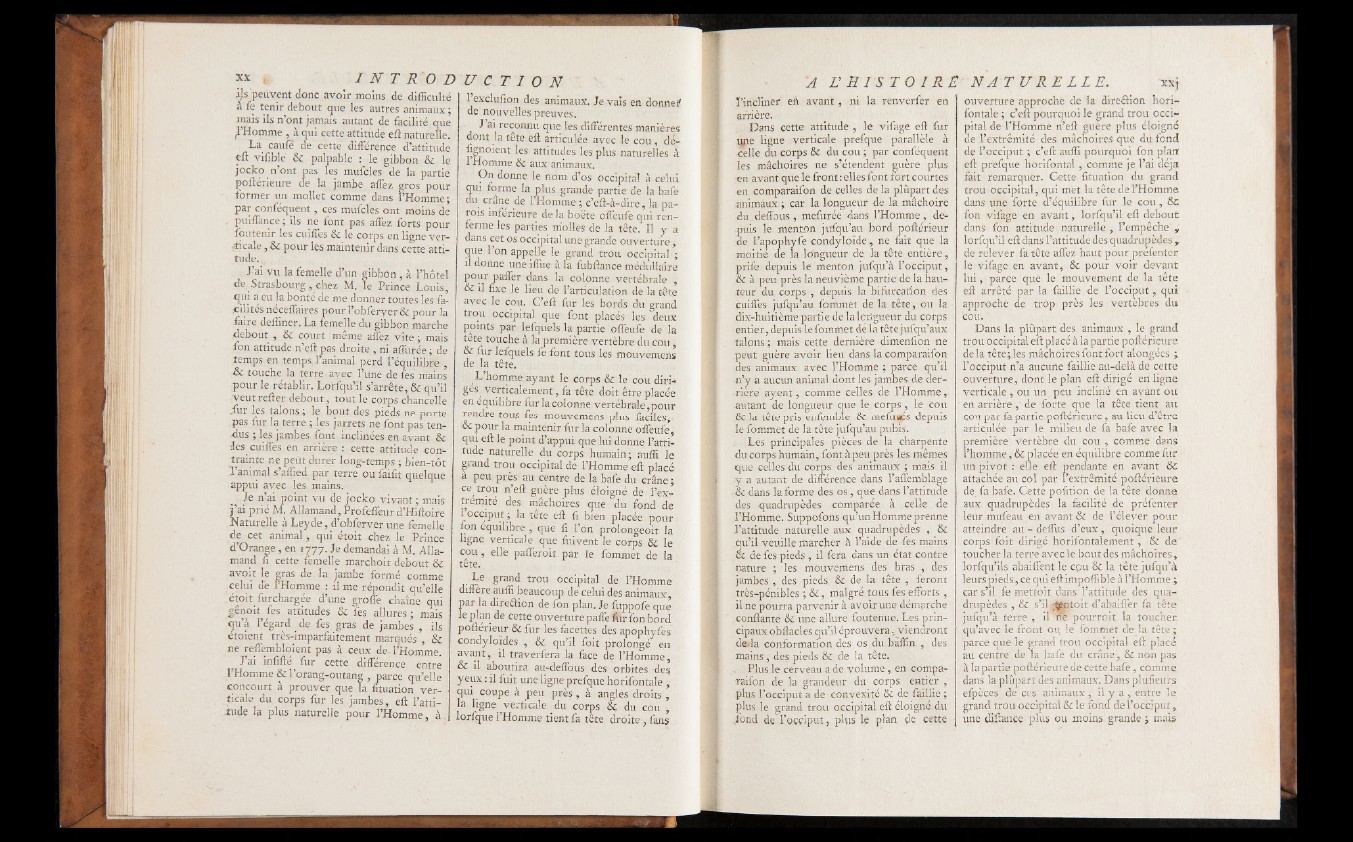
i/s peuvent donc avoir moins de difficulté
à fe tenir debout que les autres animaux ;
mais ils n’ont jamais autant de facilité , que
jl’Homme , à qui cette attitude eft naturelle.
La caufë de cette différence d’attitude
eft vifiblë 8c palpable : le gibbon & le
jocko n’ont pas les mufcles de la partie
poflérieure de la jambe alfez gros pour
• former un mollet comme dans l’Homme;
par conféquent, ces mufcles ont moins de
, puiffance ; ils ne font pas affez forts pour
foutenir les cuiffes & le corps en ligne yer-
fic a le , & pour les maintenir dans cette attitude.,.
J’ai vu la femelle d’un gibbon , à l’hôtel
dé Strasbourg , chez M. le Prince Louis,
qui a eu la bonté de me donner toutes les facilités
néceffaires pour l’obferyer 8c pour la
faire deffiner. La femelle du gibbon marche
debout , 8c court même affez vite ; mais
fon attitude n’eft pas droite , ni affurée ; de
temps en temps, l’animal perd l’équilibre ,
& touche la terre ayec l’une de les mains
pour le rétablir. Lorfqu’il s’arrête, & qu’il
veut relier debout, tout le corps chancelle
iiir les talons ; le bout des pieds ne porte
pas fur la terre ; les jarrets ne font pas tendus
; les jambes font inclinées en avant 8c
les cuiffes en arrière : cette attitude contrainte
ne petit durer long-temps ; bien-tôt
l ’animal s’affied par terre ou faifit quelque
appui avec les mains.
Je n’ai point vu de jocko vivant ; mais
j ’ai prié M. Allamand, Profeffeur d’Hiftoire
Naturelle à Leyde, d’obferver une femelle
de cet animal, qui étoit chez le Prince
d’Orange, en 1777. Je demandai à M. Allamand
fi cette femelle marchoit debout 8c
avoit le gras de la. jambe formé comme
.celui de l’Homme : il me répondit qu’elle
étoit furchargée d’une groffe chaîne qui
gênait {es attitudes & fes allures ; mais
qu a l’egard de fes gras de jambes , ils
etoient très-imparfaitement marqués , &
ne reffemblqient pas à ceux de- l’Homme.
J ai infifte fur cette différence entre
l ’Homme 8c l ’orang-outang , parce qu’elle
concourt à prouver que la fituation verticale
du corps fur les jambes, eft l’atti-
iude la plus naturelle pour l’Homme, à
l ’exclufion des animaux. Je vais en donne*
de nouvelles preuves.
J ai reconnu que les différentes manières
dont la tête eft articulée avec le cou , dé-
fignoient les attitudes les plus naturelles à
1 Homme & aux animaux.
On donne le nom d’os occipital à celui
qui forme la plus grande partie de ia baie
du crâne de l’Homme ; c’eft-à-dire, la parois
inférieure de la boëte offeufe qui renferme
les parties molles de la tête. Il y a
dans cet os occipital une grande ouverture,
que 1 on appelle le grand trou occipital ;
il donne une iffue à la fubftance médullaire P°Pr paffer dans la colonne vertébrale ,
& il fixe le lieu de l’articulation de la tête
avec le cou. Ç’eft fur les bords du grand
trou occipital que font placés les deux
points par lefquels la partie offeufe de la
tete touche à la première vertèbre du cou,
& fur lefquels fe font tous les mouyemens
de la tête.
L’homme ayant le corps & le cou diriges^
verticalement, fa tete doit être placée
en équilibré fur la colonne vertébrale, pour
rendre tous fes mouvemens plus faciles,
de pour la maintenir fur la colonne offeufe,
qui eft le point d’appui que lui donne l’attitude
naturelle du corps humain; auffi le
grand trou occipital de l’Homme eft placé
à peu près au centre de la bafe du crâne ;
ce trou n’eft guère plus éloigné de l’ex-
tremité des mâchoires que du fond de
1 occiput ; la tête eft fi bien placée pour
fon équilibré , que fi l’on prolongeoit la
ligne verticale que fuivent le corps & le
co u , elle pafferoit par le fommet de la
tete.
Le grand trou occipital de l’Homme
diffère auffi beaucoup de celui des animaux,
par la direftion de fon plan. Je fuppofe que
le plan de cette ouverture paffe fur fon bord
poftérieur & fur les facettes des apophyfes
condyloïdes , 8c qu’il foit prolongé en
avant, il traverfera la face de l’Homme,
& il aboutira au-deffous des orbites des
yeux : il fuit une ligne prefque horifontale ,
qui coupe à peu près, à angles droits ,
la ligne verticale du corps 8c du cou ,
lorfque l’Homme tient fa tete droite, fans
l ’incliner eft a van t, ni la renverfer en
arrière.
Dans cette attitude , le vifage eft fur
line ligne verticale prefque parallèle à
celle du corps 8c du cou ; par conféquent
les mâchoires ne s’étendent guère plus
en avant que le front: elles font fort courtes
en comparaifon de celles de la plupart des
animaux ; car la longueur de la mâchoire
du deffous , mefurée dans l’Homme , depuis
le menton jufqu’au bord poftérieur
de l’apophyfe condyloïde, ne fait que la
moitié de la longueur de la tête entière,
prife depuis le menton jufqu’à l’occiput,
& à peu près la neuvième partie de la hauteur
du corps , depuis la bifurcation des
cuiffes jijfqu’au fommet de la tête, ou la
dix-huitième partie de la longueur du corps
entier, depuis le fommet de la tête jufqu’aux
talons; mais cette dernière dimenfion ne
peut guère avoir lieu dans la comparaifon
des animaux avec l’Homme ; parce qu’il
•n’y a aucun animal dont les jambes de derrière
a yen t, comme celles de l’Homme,
autant de longueur que le corps, le cou
8c la tête pris enfemble & mefuaés depuis
le fommet de la tête jufqu’au pubis.
Les principales pièces de la charpente
du corps humain, fontàpeuprès les mêmes
que celles du corps des animaux ; mais il
y a autant de différence dans l’affemblage
& dans la forme des o s , que dans l’attitude
des quadrupèdes comparée à celle de
l ’Homme. Suppofons qu’un Homme prenne
l ’attitude naturelle aux quadrupèdes , 8c
qu’il veuille marcher à l’aide de fes mains
& de fes pieds, il fera dans un état contre
nature ; les mouvemens des bras , des
jambes , des pieds 8c de la tête , feront
très-pénibles ; 8c, malgré tous fes efforts ,
il ne pourra parvenir à avoir une démarche
confiante 8c une allure foutenue. Les principaux
obftacles qu’il éprouvera, viendront
deda conformation des os du bàffin , des
mains, des pieds 8t de la tête.
Plus le cerveau a de volume, en comparaifon
de la grandeur du corps entier ,
plus l ’occiput a de convexité 8c de faillie ;
plus le grand trou occipital eft éloigné, du
.tond de l’occiput, plus le plan de cette
ouverture approche de la diredion horifontale
; c’eft pourquoi le grand trou occipital
de l’Homme n’eft guère plus éloigné
de l’extrémité des mâchoires que du fond
de l’occiput ; c’eft auffi pourquoi fon plan
eft prefque horifontal, comme je l’ai déjà
fait remarquer. Cette fituation du grand
trou occipital, qui met la tête de l’Homme
dans une forte d’équilibre fur le c o u , 8c
fon vifage en avant, lorfqu’il eft debout
dans fon attitude naturelle , l’empêche v
lorfqu’il eft dans l’attitude des quadrupèdes y
de relever fa tête affez haut pour prefenter
le vifage en avant, 8c pour voir devant
lu i , parce que le mouvement de la tête
eft arrêté par la faillie de l’occiput, qui
approche de trop près les vertèbres du
cou. '
Dans la plupart des animaux , le grand
trou occipital eft placé à la partie poflérieure
de la tête; les mâchoires font fort alongées ;
l’occiput n’a aucune faillie au-delà de cette
ouverture, dont le plan eft dirigé en ligne
verticale, ou un peu incliné en avant ou
en arrière ,' de forte que la tête tient au
cou par fa partie poflérieure, au lieu d’être
articulée par le milieu de fa bafe avec la
première vertèbre du cou , comme dans
l’homme, 8c placée en équilibre comme fur
un pivot : elle eft pendante en avant &
attachée au col par l ’extrémité poflérieure
de fa bafe. Cette pofition de la tête donne
aux quadrupèdes la facilité de prefenter
leur mufeau en avant 8c de l’élever pour
atteindre au - deffus d’eu x , quoique leur
corps foit dirigé horifontalement , 8c de
toucher la terre avec le bout des mâchoires,
lorfqu’ils abaiffent le epu 8c la tête jufqu’à
leurs pieds, ce qui eftimpoffible à l’Homme ;
car s’il fe mettoit dans l’attitude des quadrupèdes
, 8c s’il jÇpntoit d’abaiffer fa tête,
jufqu’à terre , il ne pourroit la toucher,
qu’avec le front ou le fommet de la tête ;
parce que le grand trou occipital eft placé
au centre ,de la bafe du crâne,, 8c non pas
à la partie poflérieure de cette bafe, comme
dans la plupart des animaux. Dans plufieurs
efpèces de ces animaux , il y a , entre le
grand trou occipital 8c le fond de l’occiput,
une diftance plus ou moins grande ; mais