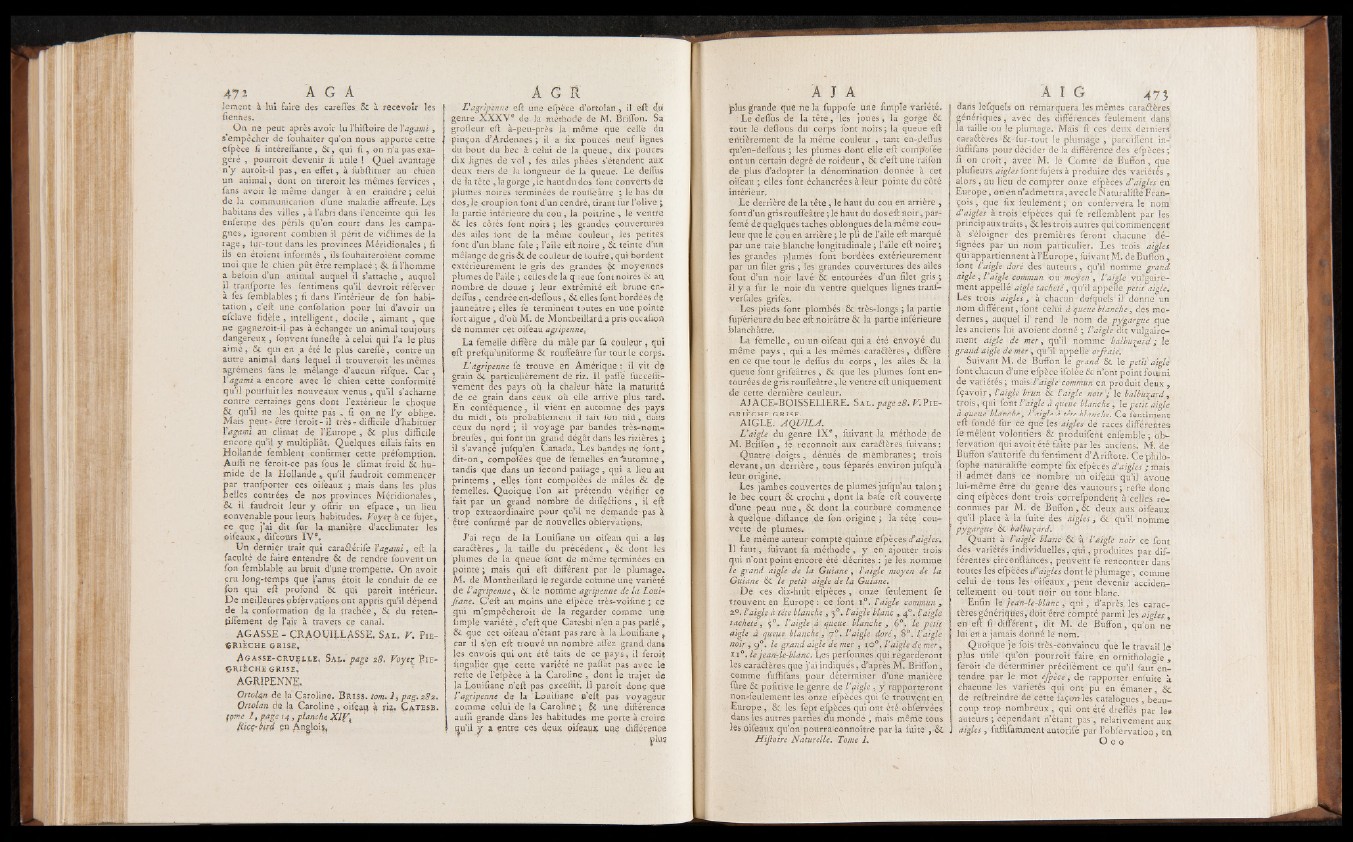
lerhent à lui faire des careffes_ & à recevoir les
fienhes.
On ne peut après avoir lu l’hiftoire de Yagami ,
s’empêcher de fouhaiter qu’on nous apporte cette,
efpèce fi intéreffante , & , qui fi , on n’a pas exagéré
, pourroit devenir fi utile ! Quel avantage
n’y auroiç-il pas, en effet., à fubftituer au chien
un animal, dont on tireroit les mêmes fervices ,
fans avpir le même danger à en craindre ; celui
de la communication d’une maladie affreufe. Les
habitans des villes , à l’abri dans l’enceinte qui les
enferme des périls qu’on court dans les campagnes,
ignorent combien il périt de viftimes de la
rage , fur-tout dans les provinces Méridionales ; fi
ils en étoient informés , ils fouhaiteroienr comme
moi que le chien pût être remplacé ; & fi l’homme
a bel'oin d’un animal auquel il s’attache , auquel
il tranfporte les fentimens qu’il devroit réferver
à fes femblables ; fi dans l’intérieur de fon habitation
, c’eft une çonfolation pour lui d’avoir un
efclave fidèle , intelligent, docile , aimant , que
ne gagneroit-il pas à échanger un animal toujours
dangereux , fouvent funefte à celui qui l’a le plus
a»mé, & qui en a été le plus careffé, contre un
autre animal dans lequel il trouyeroit les mêmes
agrémens fans le mélange d’aucun rifque. Car ,
Xagami a encore avec le chien cette conformité
qu’il pourl'uit les nouveaux venus , qu’il s’acharne
contre certaines gens dont l’extérieur le choque
& qu’il ne les quitte pas , fi on ne l’y oblige.
Mais peut-être ieroit-il trèsr difficile d’habituer
Yagami au climat de l’Europe , & plus difficile
encore qu’il y multipliât. Quelques effais faits en
Hollande femblent confirmer cette préfomptiofi.
Auffi ne feroit-ce pas fpus le climat froid & humide
de la Hollande, qu’il faudroit- commencer
Ear tranfporter ces oifeaux ; mais dans les plus
elles contrées de nos provinces Méridionales,
6c. il faudrqit leur y offrir un efpace, un lieu
convenable pour leurs habitudes. Voye[ à ce fujet,
ce que j’ai dit fur la. manière d’acclimater les
oifeaux, difçours IVe»
Un dernier trait qui çaraâérife Xagami, eft la
faculté de faire entendre & de rendre fouvent un
fon femblable au bruit d’pne trompette. On avoit
cru long-temps que l’anus étpit le conduit de ce
fon qui eft profond & qui paroît intérieur.
De meilleures obfervâtions ont appris qu’il dépend
de la cpnformation de la .trachée, & du retenr
tiffement de l’air à traveçs ce canal.
AGASSÉ - Ç R A Q U ILLASSE. Sa l . V. PieÇR1ÈCHE
GRISE,
A gasse-c r u ç l l e , Sax- p # g e 28. V o y e^ P ieÇRIÈCHE
GRISE,
AGRiPÇNNg.
Ortolan de Ja Caroline, B r i$s. tom . J , pag.282.
Qrtolan de la Caroline , oifçaq à riî. Ç ate sb .
fçtne 1 , page 14, planche
püçe-ljpd pn Ânglois,
' IY agripenne eft une efpèce d’ortolan, il eft dif
genre XXXVe de. la méthode de M. Briffon. Sa
grofleur eft à-peu-près la même que celle du
pinçon d’Ardennes ; il a fix pouces neuf lignés
du bput du bec à celui de la queue, dix pouces
dix lignes de vol ; fes ailes pliées s’étendent aux
deux tiers de la longueur de la queue. Le deffus
de la tête , la gorge , le haut du dos font couverts de
plumes noires terminées de roulfeâtre ; le bas du
dos, le croupion font d'un cendré, tirant fur l’olive ;
; la partie intérieure du cou , la poitrine , le ventre
& les côtés font noirs ; lès grandes couvertures
des ailes l'ont de la même couleur, les petites
font d’un blanc fale ; l’aile eft noire , &. teinte d’un
mélange de gris & de couleur de foufre, qui bordent
extérieurement le gris des grandes & moyennes
plumes de l’aile ; celles de la queue font noires & au
nombre de douze | leur extrémité eft brune en-
deffus , cendrée en-deffous, & elles font bordées de
jauneâtre ; elles fe terminent toutes en une pointe
fort aigue , d’où M. de Montbeillard a pris occafioiî
de nommer cet oifeau agripenne;
La femelle diffère du mâle par fa couleur, qui
çft prefqu’uniformp ôç rouffeâtre fur tout le corps.
Vagripenne fe trouve en Amérique : il vit de
grain &. particulièrement de riz. Il parte fucçefii-
vement des pays ou la chaleur hâte la maturité
de ce grain dans ceux où elle arrive plus tard.
En conféquencç, il vient en automne des pays
du midi, où probablement il fait ion nid , dans
cçux du nord ; il voyage par bandes très-nom-
breufes, qui font un grand dégât dans les rizières ;
il s’avancé jufqu’en Canada. Les bandes ne font,
dit-on, compofées que de femelles en^autoninp.
tandis que dans un fécond partage, qui a lieu au
printems , elles fpnt coinpofées de mâles & de
femelles. Quoique l’on ait prétendu vérifier ce
fait par un grand nombre de diffeçlions , il eft
trop extraordinaire pour qu’il ne demandé'pas à
' être' confirmé par de nouvelles obférvatiçns.
J’ai reçu de la Louifiane un oifeau qui a les
caractères, la taille du précédent, & dont ies
plumes de la queue fdnt de même terminées en
pointe ; mais qui eft différent par le plumage.
M. de Montbeillaçd le regarde co'mme une variété
de Vagripenne, & le nomme agripenne de la Loui-
fane. C’eft au moins une efpèce très-voi.fine ; ce
qui m’empêcheroit de la regarder comme une
fimple variété , c’eft que Cateshi n’en a pas parlé,
& que cet oifeau n’étant pas rare à la Louifiane ?
car il s’en eft trouvé un nombre affez grand dans
les envois qui ont été faits de ce pays > il feroit
fingulier qqe cette variété ne paffât pas avec le
relie de l’efpèce à la Caroline , dont le trajet de
la Louifiane 11’eft pas excelfif. Il paroît donc que
l'agripenne de la Louifiane n’eff pas yoyagèur
comme celui 'de la Caroline ; $£ line différence
Sauffi grande dans les habitudes me porte à croire
gu’il y a entre ces deux oifeaux une différence
plus
^plus grande que ne la fiippofe une fimple v a rié té .
Le deffus de la tête, les joues, la gorge &
tout le deflous du corps font noirs; la queue eft
entièrement de la même couleur , tant en-.deffus
qu’en-deffous ; les plumes dont elle eft com^ofée
ont un certain degré de roideur , & c’eft une rtfifon
de plus d’adopter la dénomination donnée à cet
oifeau ; elles font échancrées à leur pointe du côté
intérieur.
Le derrière de la tête, le haut du cou en arrière ,
font d’un gris rouffeâtre ; le haut du dos eft noir, par-
femé de quelques taches oblongues de la même couleur
que le cou en arrière ; le pli de l’aîle eft marqué
par une raie blanche longitudinale ; l’aîle eft noire ;
les grandes plumes font bordées extérieurement
par un filet gris ; les grandes couvertures des ailes
font d’un noir lavé & entourées d’un filet gris ;
il y a fur le noir du ventre quelques lignes tranf-
verfales grifes.
Les pieds font plombés & très-longs ; la partie
fup’érieure du bec eft noirâtre & la partie inférieure
blanchâtre.
La femelle, ou un oifeau qui a été envoyé du
même pays , qui a les mêmes caractères, diffère
en ce que tout le deffus du corps, les ailes & la
queue font grifeâtres , & que les plumes font entourées
de gris rouffeâtre, le Ventre eft uniquement
de cette dernière couleur.
AJÀCE-BOISSELIERE. Sa l .page 28. V. Pie-
g r ièch e GRISE.
AIGLE. AQU1LA.
U aigle du genre IXe, fuivant la méthode; de
M. Briffon , fe reconnoît aux caraûères fuivans :
Quatre doigts, dénués de membranes-; trois
devant,un derrière, tous féparés-environ j.ufqu’à
leur origine.
Les jambes couvertes de plumes jufqu’au talon ;
le bec court & crochu, dont la baie eft couverte
d’une peau nue, ,& dont la, courbure commence
à quelque diftance de fon origine ; la têtq couverte
de plumes.
Le même auteur compte quinze efpèces dY aigles.
Il faut, fuivant fa méthode , y en ajouter trois
qui n’ont point encore été décrites : je les nomme
le grand aigle de la Guiane, Vaigle moyen de la
Guiane & le petit aigle de la Guiane.
De ces dix-huit efpèces, onze feulement fe
trouvent en Europe: ce font i.°. l'aigle commun,
20. l'aigle à tête blanche , 30. l'aigle -blanc , 40. taigle
tacheté, 5 °. Vaigle à queue blanche , 6°. le petit
aigle à queue blanche-, 7®. Saigle doré, 8°. Il aigle
noix 9 9°. le grand aigle de mer , io°. l'aigle de mer,
11°. le jean-le-blanc. Les perfonnes .qui regarderont
les caraélères que j’ai indiqués, d’après M. Briffon^
comme fuffifans pour déterminer d’une manière
fûre & pofitive le genre de l ’aigle j y rapporteront
non-feulement les onze efpèces qui fe trouvent en
Europe , & les fept efpèces qui ont été obfetvées
dans les autres parties'1 du mondé , mais mêrùe tous
les oifeaux qu’on pourra connoître pat* la fuite , ôc
Hifioire Naturelle. Tome 1.
dans lefquels on remarquera les mêmes cara&ères
génériques, avec des différences feulement dans
la taille ou le plumage. Mais fi ces deux derniers
caraâères & ' fur-tout le plumage , parôiffént in-
fuffifans pour décider de la différence dès efpèces ;
fi on croit , avec'M. le Comte de Buffon, que
plufieurs, fontfujets à produire des variétés ,
alors , au lieu de compter onze efpèces d'aigles en
Europe, on en n*admettra, avèele Naturalifte François
, que fix feulement ; on confervêra le nom
d'aigles à trois efpèces qui fe reffemblent par les
principaux traits, & les trois autres qui commencent
à s’éloigner des premières feront chacune dé-
fignées par un nom particulier. Les trois aigles
qui'appartiennent à l’Europe , fuiyant M. de Buffon ,
font Vaigle- doré des auteurs , qu’il nomme grand
aiglel'aigle commun ow mofen , l'aigle vulgairement
appelle ■ aig/e tacheté, qu’il appelle petit aigle.
Les trois aigles, à chacun ‘ dëfquéls il donne un
nom différent, font celui à queue blanche, des modernes,
auquel il rend le nom de pygoergue .que
les anciens lui avoient donné ; l'aigle dit vulgairement
aigle de mer, qu’il nomme balbuzard; le
grand aigle de mer qu’il appéllë orfraie1
Suivant M. de Buffon le grand & le petit' aigle
font chacun d’une efpèce ifolée & n’oht point fourni
de variétés ; ma.\sd'aigle commun en produit deux ,
fçavoir, l'aigle brun & P aigle n o i r le balbuzard ,
trois, qui font l'aigle à queue blanche , le petit aigle
à queue blanche, Vaigle a tête blanche. Ce fèntiment
eft fondé fur ce que les aigles de races différentes
fe mêlent volontiers & pfoduifent enfemble; ob-
fervâtion qui avoit été faite par les anciens. M. de
Buffon s’aütorife du fentiment d’Ariftote. Ce'phiio-
fophe naturalifte compte fix efpèces d'aigles '; mais
il admet- dans ce nombre un oifeau qu’il avoue
lui-même être du genre des vautours; refte donc
cinq efpèces dont trois correfpondent à celles reconnues
par M. de Buffon, & deux aux oifeaux
qu’il place à la fuite des aigles , & qu’il 'noinme
pygargue & balbuzard. -
Quant à l'aigle blanc- & 'à l'aigle noir ce font
des variétés individuelles, qui , produites par différentes
circorfftàiïcés;, peuvent fe rencontrer dans'
toutes les efpè’ces d'aigles dont lé plumage:, comme
celui de tous lesWifeaux, peut devenir accidén^
tëllement ou tout noir ou tout blanc.
Enfin 1 &' jea'n-le-blàhc, qui, d’après, les caractères
génériques, doit être compté parmi les aigles ,
en eft fi’différent, dit M. de Buffon, qu’on ne
lui en a jamais donné 1e' nom.
Quoique jë fois’très-conVaincu que le travail le
plus utile quoi! pourfoit faire en ornithologie „
feroit de déterminer précifément ce . qu’il faut entendre
par le-mot efpèce | de rapporter enfuite à
chacune lès variétés qui ont pu en émaner &
dé reftreindre de cette façortles catalogues , beaucoup
trop nombreux, qui ont été dreffés par les
auteurs ; cependant n’étant pas, relativement aux
aigles j fuffifamment autorifé par l’obfervation, en
O o o