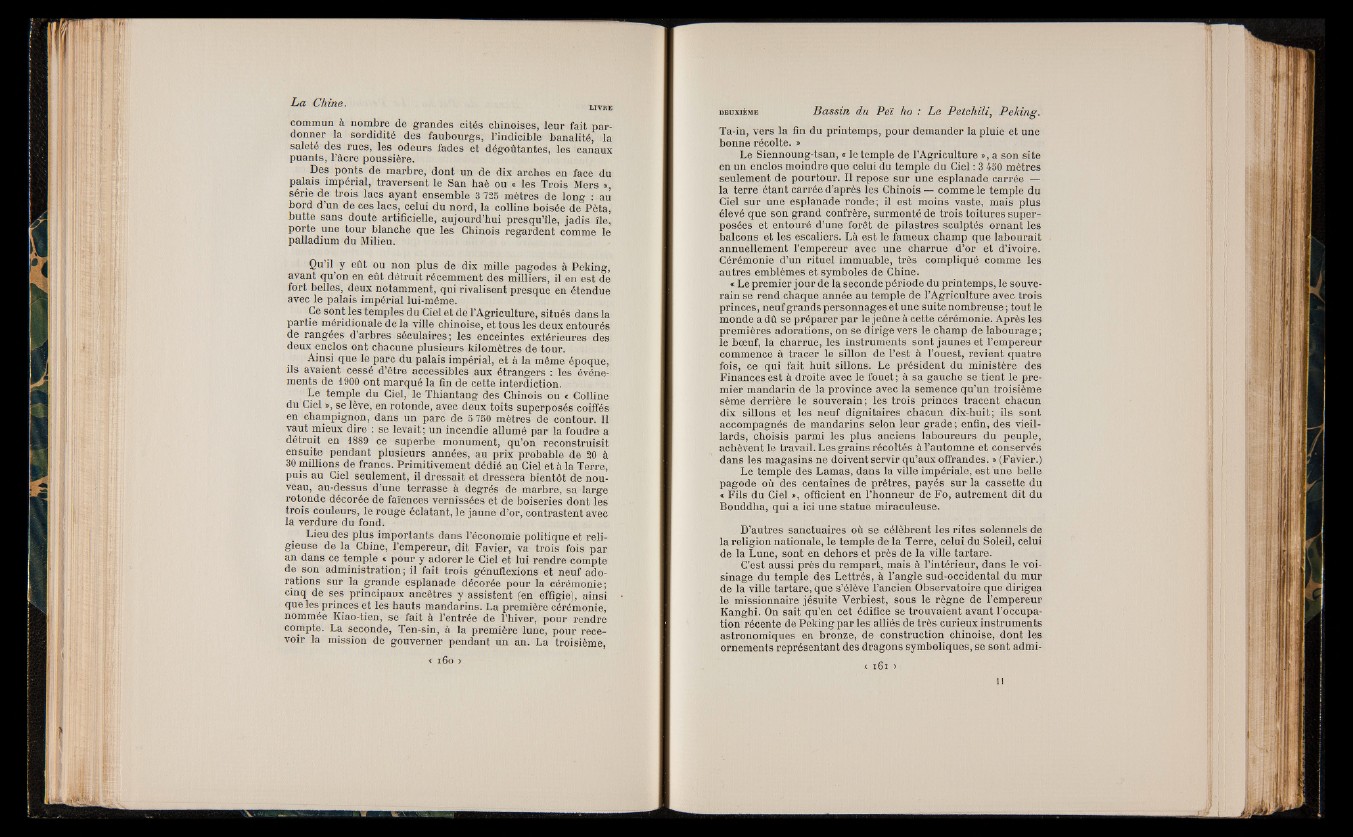
commun à nombre de grandes cités chinoises, leur fait pardonner
la sordidité des faubourgs, l’indicible banalité, la
saleté des rues, les odeurs fades et dégoûtantes, les canaux
puants, l’âcre poussière.
Des ponts de marbre, dont un de dix arches en face du
palais impérial, traversent le San haè ou « les Trois Mers »,
série de trois lacs ayant ensemble 3 725 mètres de long : au
bord d’un de ces lacs, celui du nord, la colline boisée de Pèta,
butte sans doute artificielle, aujourd’hui presqu’île, jadis île,
porte une tour blanche que les Chinois regardent comme le
palladium du Milieu.
Qu’il y eût ou non plus de dix mille pagodes à Peking,
avant qu’on en eût détruit récemment des milliers, il en est de
fort belles, deux notamment, qui rivalisent presque en étendue
avec le palais impérial lui-même.
Ce sont les temples du Ciel et de l’Agriculture, situés dans la
partie méridionale de la ville chinoise, et tous les deux entourés
de rangées d’arbres séculaires; les enceintes extérieures des
deux enclos ont chacune plusieurs kilomètres de tour.
Ainsi que le parc du palais impérial, et à la même époque,
ils avaient cessé d’être accessibles aux étrangers : les événements
de 1900 ont marqué la fin de cette interdiction.
Le temple du Ciel, le Thiantang des Chinois ou « Colline
du Ciel », se lève, en rotonde, avec deux toits superposés coiffés
en champignon, dans un parc de 5 750 mètres de contour. II
vaut mieux dire : se levait; un incendie allumé par la foudre a
détruit en 1889 ce superbe monument, qu’on reconstruisit
ensuite pendant plusieurs années, au prix probable de 20 à
30 millions de francs. Primitivement dédié au Ciel et à la Terre,
puis au Ciel seulement, il dressait et dressera bientôt de nouveau,
au-dessus d’une terrasse à degrés de marbre, sa large
rotonde décorée de faïences vernissées et de boiseries dont les
trois couleurs, le rouge éclatant, le jaune d’or, contrastent avec
la verdure du fond.
Lieu des plus importants dans l’économie politique et religieuse
de la Chine, l’empereur, dit Favier, va trois fois par
an dans ce temple « pour y adorer le Ciel et lui rendre compte
de son administration ; il fait trois génuflexions et neuf adorations
sur la grande esplanade décorée pour la cérémonie;
cinq de ses principaux ancêtres y assistent (en effigie), ainsi
que les princes et les hauts mandarins. La première cérémonie,
nommée Kiao-tien, se fait à l’entrée de l’hiver, pour rendre
compte. La seconde, Ten-sin, à la première lune, pour recevoir
la mission de gouverner pendant un an. La troisième,
Bassin du Peï ho : Le Petchili,' PekinOg.
Ta-in, vers la fin du printemps, pour demander la pluie et une
bonne récolte. »
Le Siennoung-tsan, « le temple de l’Agriculture », a son site
en un enclos moindre que celui du temple du Ciel : 3 450 mètres
seulement de pourtour. Il repose sur une esplanade carrée —
la terre étant carrée d’après les Chinois — comme le temple du
Ciel sur une esplanade ronde; il est moins vaste, mais plus
élevé que son grand confrère, surmonté de trois toitures superposées
et entouré d’une forêt de pilastres sculptés ornant les
balcons et les escaliers. Là est le fameux champ que labourait
annuellement l’empereur avec une charrue d’or et d’ivoire.
Cérémonie d’un rituel immuable, très compliqué comme les
autres emblèmes et symboles de Chine.
* Le premier jour de la seconde période du printemps, le souverain
se rend chaque année au temple de l’Agriculture avec trois
princes, neuf grands personnages et une suite nombreuse ; tout le
monde a dû se préparer par le jeûne à cette cérémonie. Après les
premières adorations, on se dirige vers le champ de labourage;
le boeuf, la charrue, les instruments sont jaunes et l’empereur
commence à tracer le sillon de l’est à l’ouest, revient quatre
fois, ce qui fait huit sillons. Le président du ministère des
Finances est à droite avec le fouet ; à sa gauche se tient le premier
mandarin de la province avec la semence qu’un troisième
sème derrière le souverain; les trois princes tracent chacun
dix sillons et les neuf dignitaires chacun dix-huit; ils sont
accompagnés de mandarins selon leur grade ; enfin, des vieillards,
choisis parmi les plus anciens laboureurs du peuple,
achèvent le travail. Les grains récoltés à l’automne et conservés
dans les magasins ne doiventservir qu’aux offrandes. » (FàVier.)
Le temple des Lamas, dans la ville impériale, est une belle
pagode où des centaines de prêtres, payés sur la cassette du
* Fils du Ciel », officient en l’honneur de Fo, autrement dit du
Bouddha, qui a ici une statue miraculeuse.
D’autres sanctuaires où se célèbrent les rites solennels de
la religion nationale, le temple de la Terre, celui du Soleil, celui
de la Lune, sont en dehors et près de la ville tartare.
C’est aussi près du rempart, mais à l’intérieur, dans le voisinage
du temple des Lettrés, à l’angle sud-occidental du mur
de la ville tartare, que s’élève l’ancien Observatoire que dirigea
le missionnaire jésuite Yerbiest, sous le règne de l’empereur
Kanghi. On sait qu’en cet édifice se trouvaient avant l’occupation
récente de Peking par les alliés de très curieux instruments
astronomiques en bronze, de construction chinoise, dont les
ornements représentant des dragons symboliques, se sont admi