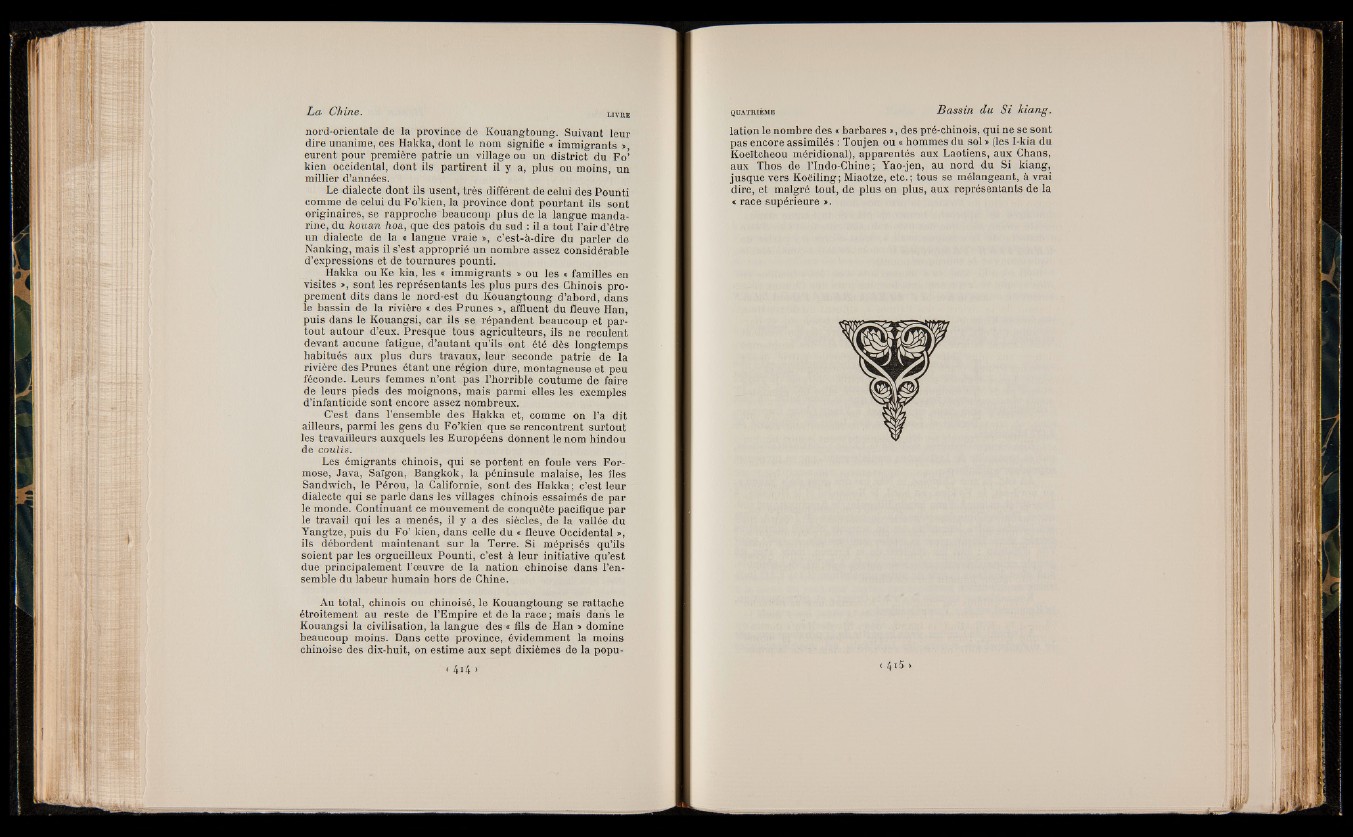
nord-orientale de la province de Kouangtoung. Suivant leur
dire unanime, ces Hakka, dont le nom signifie « immigrants »
eurent pour première patrie un village ou un district du Fo’
kien occidental, dont ils partirent il y a, plus ou moins, un
millier d’années.
Le dialecte dont ils usent, très différent de celui des Pounti
comme de celui du Fo’kien, la province dont pourtant ils sont
originaires, se rapproche beaucoup plus de la langue mandarine,
du kouan hoa, que des patois du sud : il a tout l’air d’être
un dialecte de la c langue vraie », c’est-à-dire du parler de
Nanking, mais il s’est approprié un nombre assez considérable
d’expressions et de tournures pounti.
Hakka ou Ke kia, les « immigrants » ou les « familles en
visites », sont les représentants les plus purs des Chinois proprement
dits dans le nord-est du Kouangtoung d’abord, dans
le bassin de la rivière « des Prunes », affluent du fleuve Han,
puis dans le Kouangsi, car ils se répandent beaucoup et partout
autour d’eux. Presque tous agriculteurs, ils ne reculent
devant aucune fatigue, d’autant qu’ils ont été dès longtemps
habitués aux plus durs travaux, leur/ seconde patrie de la
rivière des Prunes étant une région dure, montagneuse et peu
féconde. Leurs femmes n’ont pas l’horrible coutume de faire
de leurs pieds des moignons, mais parmi elles les exemples
d’infanticide sont encore assez nombreux.
C’est dans l’ensemble des Hakka et, comme on l’a dit
ailleurs, parmi les gens du Fo’kien que se rencontrent surtout
les travailleurs auxquels les Européens donnent le nom hindou
de coulis.
Les émigrants chinois, qui se portent en foule vers For-
mose, Java, Saigon, Bangkok, la péninsule malaise, les îles
Sandwich, le Pérou, la Californie, sont des Hakka; c’est leur
dialecte qui se parle dans les villages chinois essaimés de par
le monde. Continuant ce mouvement de conquête pacifique par
le travail qui les a menés, il y a des siècles, de la vallée du
Yangtze, puis du Fo’ kien, dans celle du « fleuve Occidental »,
ils débordent maintenant sur la Terre. Si méprisés qu’ils
soient par les orgueilleux Pounti, c’est à leur initiative qu’est
due principalement l’oeuvre de la nation chinoise dans l’ensemble
du labeur humain hors de Chine. ,
Au total, chinois ou chinoisé, le Kouangtoung se rattache
étroitement au reste de l’Empire et de la race ; mais dans le
Kouangsi la civilisation, la langue des « fils de Han » domine
beaucoup moins. Dans cette province, évidemment la moins
chinoise des dix-huit, on estime aux sept dixièmes de la population
le nombre des « barbares », des pré-chinois, qui ne se sont
pas encore assimilés : Toujen ou « hommes du sol » (les I-kia du
Koeïtcheou méridional), apparentés aux Laotiens, aux Chans,
aux Thos de l’Indo-Chine; Yao-jen, au nord du Si kiang,
jusque vers Koëiling; Miaotze, etc.; tous se mélangeant, à vrai
dire, et malgré tout, de plus en plus, aux représentants de la
« race supérieure ».