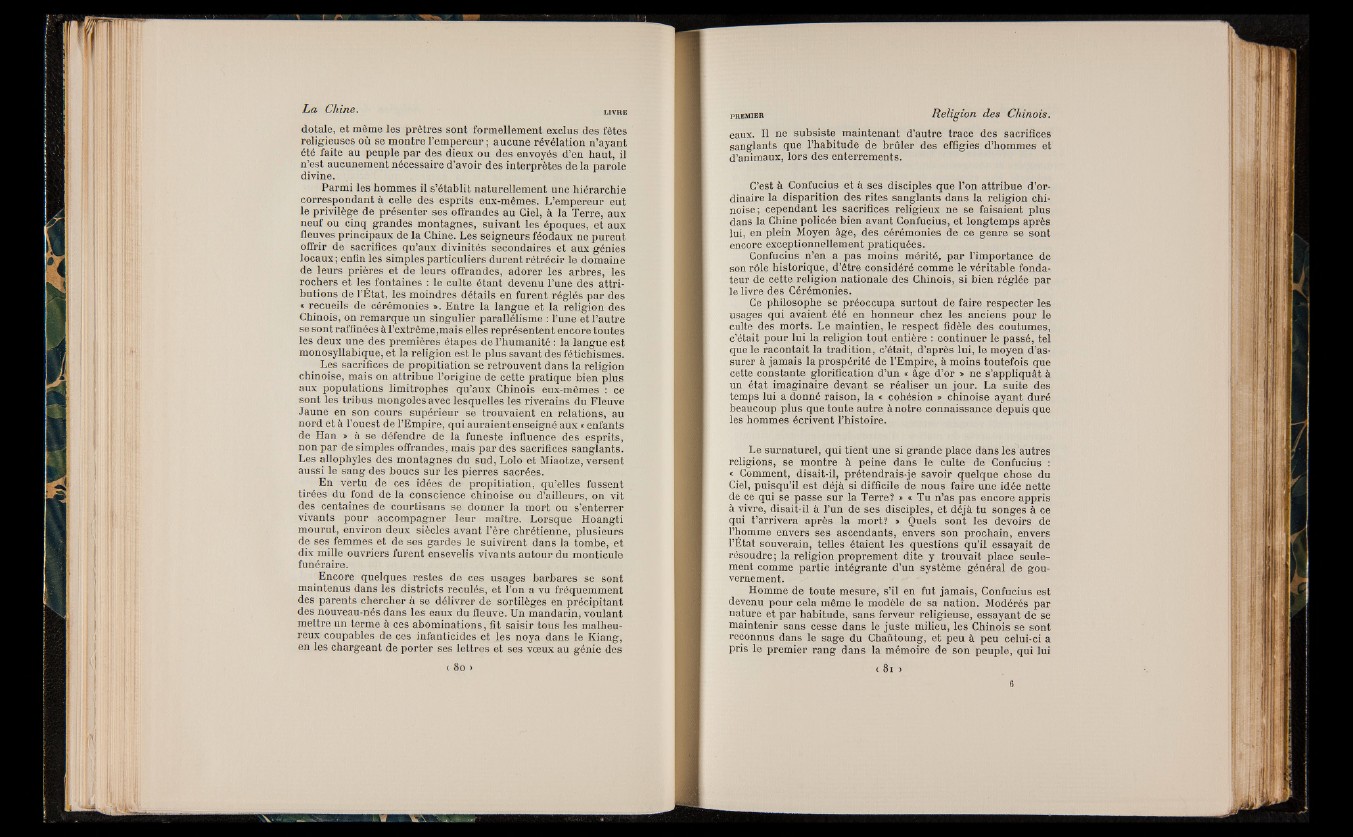
dotale, et même les prêtres sont formellement exclus des fêtes
religieuses où se montre l’empereur ; aucune révélation n’ayant
été faite au peuple par des dieux ou des envoyés d’en haut, il
n’est aucunement nécessaire d’avoir des interprètes de la parole
divine.
Parmi les hommes il s’établit naturellement une hiérarchie
correspondant à celle des esprits eux-mêmes. L’empereur eut
le privilège de présenter ses offrandes au Ciel, à la Terre, aux
neuf ou cinq grandes montagnes, suivant les époques, et aux
fleuves principaux de la Chine. Les seigneurs féodaux ne purent
offrir de sacrifices qu’aux divinités secondaires et aux génies
locaux; enfin les simples particuliers durent rétrécir le domaine
de leurs prières et de leurs offrandes, adorer les arbres, les
rochers et les fontaines : le culte étant devenu l’une des a ttributions
de l’État, les moindres détails en furent réglés par des
i recueils de cérémonies ». Entre la langue et la religion des
Chinois, on remarque un singulier parallélisme : l’une et l’autre
se sont raffinées à l’extrême,mais elles représentent encore toutes
les deux une des premières étapes de l’humanité : la langue est
monosyllabique, et la religion est le plus savant des fétichismes.
Les sacrifices de propitiation se retrouvent dans la religion
chinoise, mais on attribue l’origine de cette pratique bien plus
aux populations limitrophes qu’aux Chinois eux-mêmes : ce
sont les tribus mongoles avec lesquelles les riverains du Fleuve
Jaune en son cours supérieur se trouvaient en relations, au
nord et à l’ouest de l’Empire, qui auraient enseigné aux i enfants
de Han » à se défendre de la funeste influence des esprits,
non par de simples offrandes, mais p ar des sacrifices sanglants.
Les allophyles des montagnes du sud, Lolo et Miaotze, versent
aussi le sang des boucs sur les pierres sacrées.
En vertu de ces idées de propitiation, qu’elles fussent
tirées du fond de la conscience chinoise ou d’ailleurs, on vit
des centaines de courtisans se donner la mort ou s’enterrer
vivants pour accompagner leur maître. Lorsque Hoangti
mourut, environ deux siècles avant l’ère chrétienne, plusieurs
de ses femmes et de ses gardes le suivirent dans la tombe, et
dix mille ouvriers furent ensevelis vivants autour du monticule
funéraire.
Encore quelques restes de ces usages barbares se sont
maintenus dans les districts reculés, et Ton a vu fréquemment
des parents chercher à se délivrer de sortilèges en précipitant
des nouveau-nés dans les eaux du fleuve. Un mandarin, voulant
mettre un terme à ces abominations, fit saisir tous les malheureux
coupables de ces infanticides et les noya dans le Kiang,
en les chargeant de porter ses lettres et ses voeux au génie des
eaux. Il ne subsiste maintenant d’autre trace des sacrifices
sanglants que l’habitude de brûler des effigies d’hommes et
d’animaux, lors des enterrements.
C’est à Confucius et à ses disciples que l’on attribue d’ordinaire
la disparition des rites sanglants dans la religion chinoise;
cependant les sacrifices religieux ne se faisaient plus
dans la Chine policée bien avant Confucius, et longtemps après
lui, en plein Moyen âge, des cérémonies de ce genre se sont
encore exceptionnellement pratiquées.
Confucius n’en a pas moins mérité, par l’importance de
son rôle historique, d’être considéré comme le véritable fondateur
de cette religion nationale des Chinois, si bien réglée par
le livre des Cérémonies.
Ce philosophe se préoccupa surtout de faire respecter les
usages qui avaient été en honneur chez les anciens pour le
culte des morts. Le maintien, le respect fidèle des coutumes,
c’était pour lui la religion tout entière : continuer le passé, tel
que le racontait la tradition, c’était, d’après lui, le moyen d’assurer
à jamais la prospérité de l’Empire, à moins toutefois que
cette constante glorification d’un « âge d’or » ne s’appliquât à
un état imaginaire devant se réaliser un jour. La suite des
temps lui a donné raison, la « cohésion » chinoise ayant duré
beaucoup plus que toute autre à notre connaissance depuis que
les hommes écrivent l’histoire.
Le surnaturel, qui tient une si grande place dans les autres
religions, se montre à peine dans le culte de Confucius :
« Comment, disait-il, prétendrais-je savoir quelque chose du
Ciel, puisqu’il est déjà si difficile de nous faire une idée nette
de ce qui se passe sur la Terre? > <Tu n’as pas encore appris
à vivre, disait-il à l’un de ses disciples, et déjà tu songes à ce
qui t’arrivera après la mort? » Quels sont les devoirs de
l’homme envers ses ascendants, envers son prochain, envers
l’État souverain, telles étaient les questions qu’il essayait de
résoudre; la religion proprement dite y trouvait place seulement
comme partie intégrante d’un système général de gouvernement.
Homme de toute mesure, s’il en fut jamais, Confucius est
devenu pour cela même le modèle de sa nation. Modérés par
nature et par habitude, sans ferveur religieuse, essayant de se
maintenir sans cesse dans le juste milieu, les Chinois se sont
reconnus dans le sage du Chantoung, et peu à peu celui-ci a
pris le premier rang dans la mémoire de son peuple, qui lui