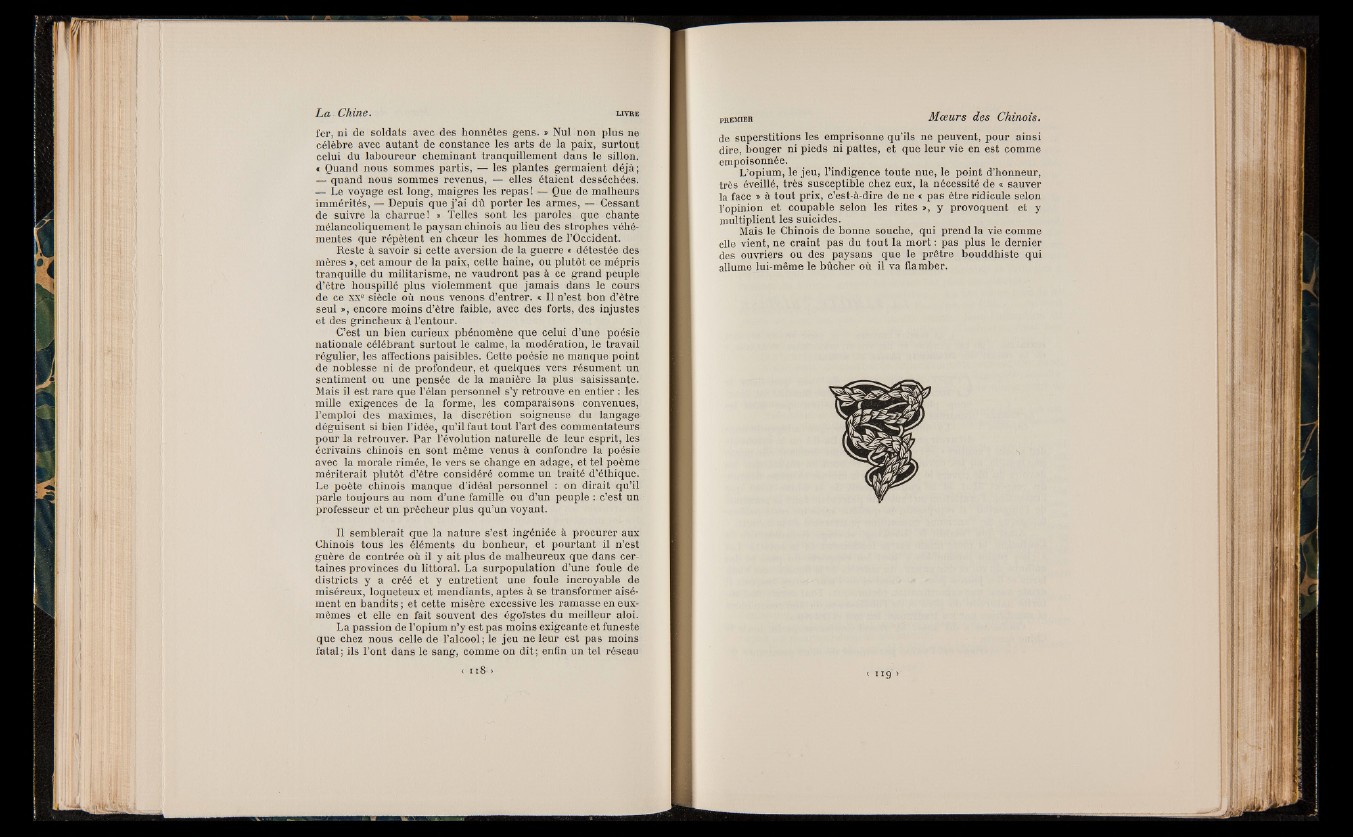
fer, ni de soldats avec des honnêtes gens. » Nul non plus ne
célèbre avec autant de constance les arts de la paix, surtout
celui du laboureur cheminant tranquillement dans le sillon.
« Quand nous sommes partis, — les plantes germaient déjà;
— quand nous sommes revenus,^Helles étaient desséchées.
— Le voyage est long, maigres les repas! — Que de malheurs
immérités, — Depuis que j ’ai dû porter les armes, s i Cessant
dé suivre la charrue! » Telles sont les paroles que chante
mélancoliquement le paysan chinois au lieu des strophes véhémentes
que répètent en choeur les hommes de l’Occident.
Reste à savoir si cette aversion de la guerre « détestée des
mères », cet amour de la paix, cette haine, ou plutôt ce mépris
tranquille du militarisme, ne vaudront pas à ce grand peuple
d’ètre houspillé plus violemment que jamais dans le cours
de ce xxe siècle où nous venons d’entrer. » Il n ’est bon d’ètre
seul », encore moins d’être faible, avec des forts, des injustes
et des grincheux à l’entour.
C’est un bien curieux phénomène que celui d’une poésie
nationale célébrant surtout le calme, la modération, le travail
régulier, les affections paisibles. Cette poésie ne manque point
de noblesse ni de profondeur, et quelques vers résument un
sentiment ou une pensée de la manière la plus saisissante.
Mais il est rare que l’élan personnel s’y retrouve en entier : les
mille exigences de la forme, les comparaisons convenues,
l’emploi des maximes, la discrétion soigneuse du langage
déguisent si bien l’idée, qu’il faut tout l’a rt des commentateurs
pour la retrouver. Par l’évolution naturelle de leur esprit, les
écrivains chinois en sont même venus à confondre la poésie
avec la morale rimée, le vers se change en adage, et tel poème
mériterait plutôt d’être considéré comme un traité d’éthique.
Le poète chinois manque d’idéal personnel : on dirait qu’il
parle toujours au nom d’une famille ou d’un peuple ; c’est un
professeur et un prêcheur plus qu’un voyant.
Il semblerait que la nature s’est ingéniée à procurer aux
Chinois tous les éléments du bonheur, et pourtant il n’est
guère de contrée où il y ait plus de malheureux que dans certaines
provinces du littoral. La surpopulation d’une foule de
districts y a créé et y entretient une foule incroyable de
miséreux, loqueteux et mendiants, aptes à se transformer aisément
en bandits ; et cette misère excessive les ramasse en eux-
mêmes et elle en fait souvent des égoïstes du meilleur aloi.
La passion de l’opium n’y est pas moins exigeante et funeste
que chez nous celle de l’alcool; le jeu ne leur est pas moins
fatal; ils l’ont dans le sang, comme on dit; enfin un tel réseau
de superstitions les emprisonne qu’ils ne peuvent, pour ainsi
dire, bouger ni pieds ni pattes, et que leur vie en est comme
empoisonnée.
L’opium, le jeu, l’indigence toute nue, le point d’honneur,
très éveillé, très susceptible chez eux, la nécessité de i sauver
la face » à tout prix, c’est-à-dire de ne « pas être ridicule selon
l’opinion et coupable selon les rites », y provoquent et y
multiplient les suicides.
Mais le Chinois de bonne souche, qui prend la vie comme
elle vient, ne craint pas du tout la mort : pas plus le dernier
des ouvriers ou des paysans que le prêtre bouddhiste qui
allume lui-même le bûcher où il va flamber.