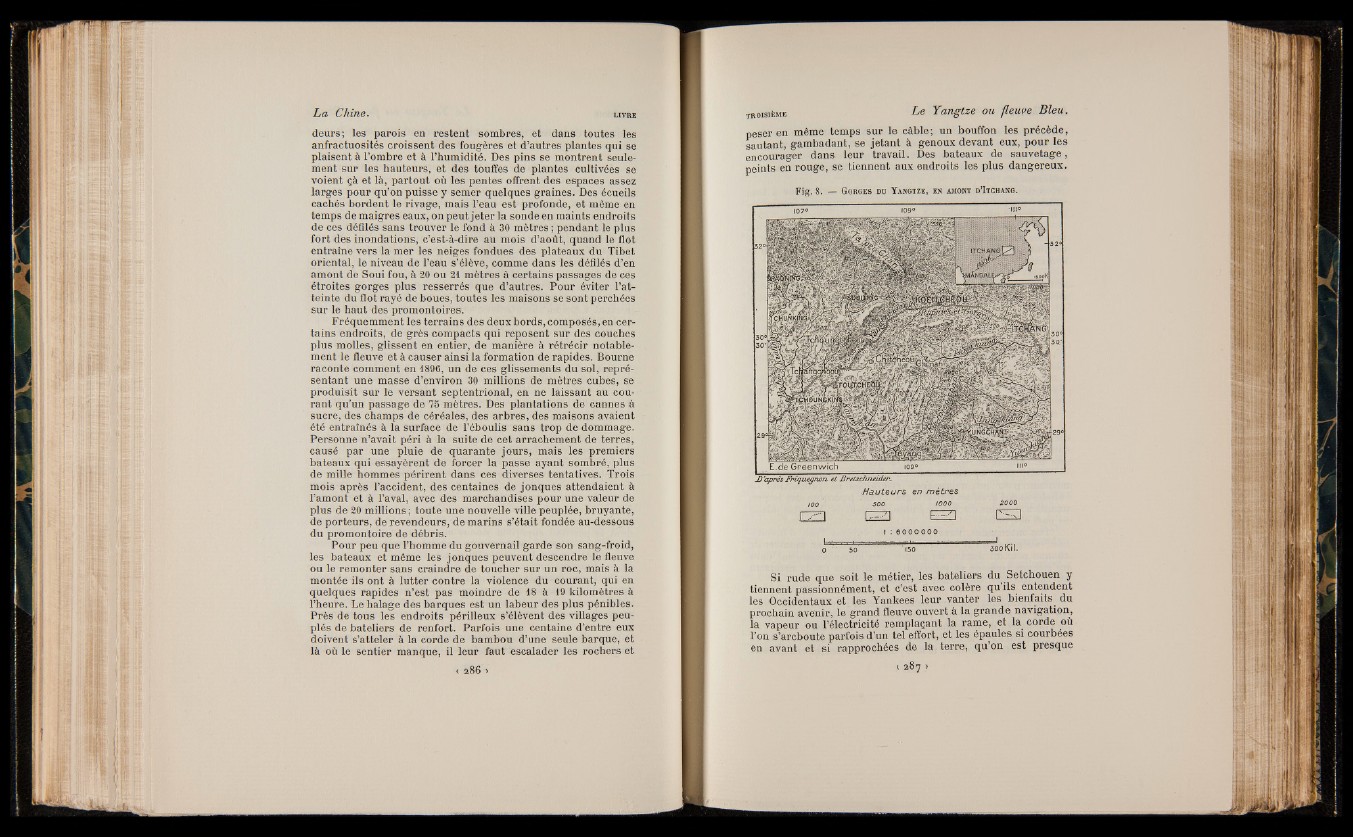
deurs; les parois en restent sombres, et dans toutes les
anfractuosités croissent des fougères et d’autres plantes qui se
plaisent à l’ombre et à l’humidité. Des pins se montrent seulement
sur les hauteurs, et des touffes de plantes cultivées se
voient çà et là, partout où les pentes offrent des espaces assez
larges pour qu’on puisse y semer quelques graines. Des écueils
cachés bordent le rivage, mais l’eau est profonde, et même en
temps de maigres eaux, on peut jeter la sonde en maints endroits
de ces défilés sans trouver le fond à 30 mètres ; pendant le plus
fort des inondations, c’est-à-dire au mois d’août, quand le flot
entraîne vers la mer les neiges fondues des plateaux du Tibet
oriental, le niveau de l’eau s’élève, comme dans les défilés d’en
amont de Soui fou, à 20 ou 21 mètres à certains passages de ces
étroites gorges plus resserrés que d’autres. Pour éviter l’atteinte
du flot rayé de boues, toutes les maisons se sont perchées
sur le haut des promontoires.
Fréquemment les terrains des deux bords, composés, en certains
endroits, de grès compacts qui reposent sur des couches
plus molles, glissent en entier, de manière à rétrécir notablement
le fleuve et à causer ainsi la formation de rapides. Bourne
raconte comment en 1896, un de ces glissements du sol, représentant
une masse d’environ 30 millions de mètres cubes, se
produisit sur le versant septentrional, en ne laissant au courant
qu’un passage de 75 mètres. Des plantations de cannes à
sucre, des champs de céréales, des arbres, des maisons avaient
été entraînés à la surface de l’éboulis sans trop de dommage.
Personne n’avait péri à la suite de cet arrachement de terres,
causé par une pluie de quarante jours, mais les premiers
bateaux qui essayèrent de forcer la passe ayant sombré, plus
de mille hommes périrent dans ces diverses tentatives. Trois
mois après l’accident, des centaines de jonques attendaient à
l’amont et à l’aval, avec des marchandises pour une valeur de
plus de 20 millions ; toute une nouvelle ville peuplée, bruyante,
de porteurs, de revendeurs, de marins s’était fondée au-dessous
du promontoire de débris.
Pour peu que l’homme du gouvernail garde son sang-froid,
les bateaux et même les jonques peuvent descendre le fleuve
ou le remonter sans craindre de toucher sur un roc, mais à la
montée ils ont à lutter contre la violence du courant, qui en
quelques rapides n’est pas moindre de 18 à 19 kilomètres à
l’heure. Lehalage des barques est un labeur des plus pénibles.
Près de tous les endroits périlleux s’élèvent des villages peuplés
de bateliers de renfort. Parfois une centaine d’entre eux
doivent s’atteler à la corde de bambou d’une seule barque, et
là où le sentier manque, il leur faut escalader les rochers et
peser en même temps sur le câble ; un bouffon les précède,
sautant, gambadant, se jetant à genoux devant eux, pour les
encourager dans leur travail. Des bateaux de sauvetage,
peints en rouge, se tiennent aux endroits les plus dangereux.
F i g . 8 . — G o r g e s du Y an gt z e , en amont d’It ch a n g .
■Hauteurs en mètres
zoo soo 1000 200Ò
.□ 3 (3 3 EE3 3 3
1 : 6 0 0 0 0 0 0
I ; r " ...— ------------ 1 m 0 ' ■ 5 0 ISO 3 0 0 m l .
Si rude que soit le métier, les bateliers du Setchouen y
tiennent passionnément, et c’est avec colère qu ils entendent
les Occidentaux et les Yankees leur vanter les bienfaits du
prochain avenir, le grand fleuve ouvert à la grande navigation,
la vapeur ou l’électricité remplaçant la rame, et la corde où
l’on s’arcboute parfois d’un tel effort, et les épaules si courbées
en avant et si rapprochées de la terre, qu’on est presque