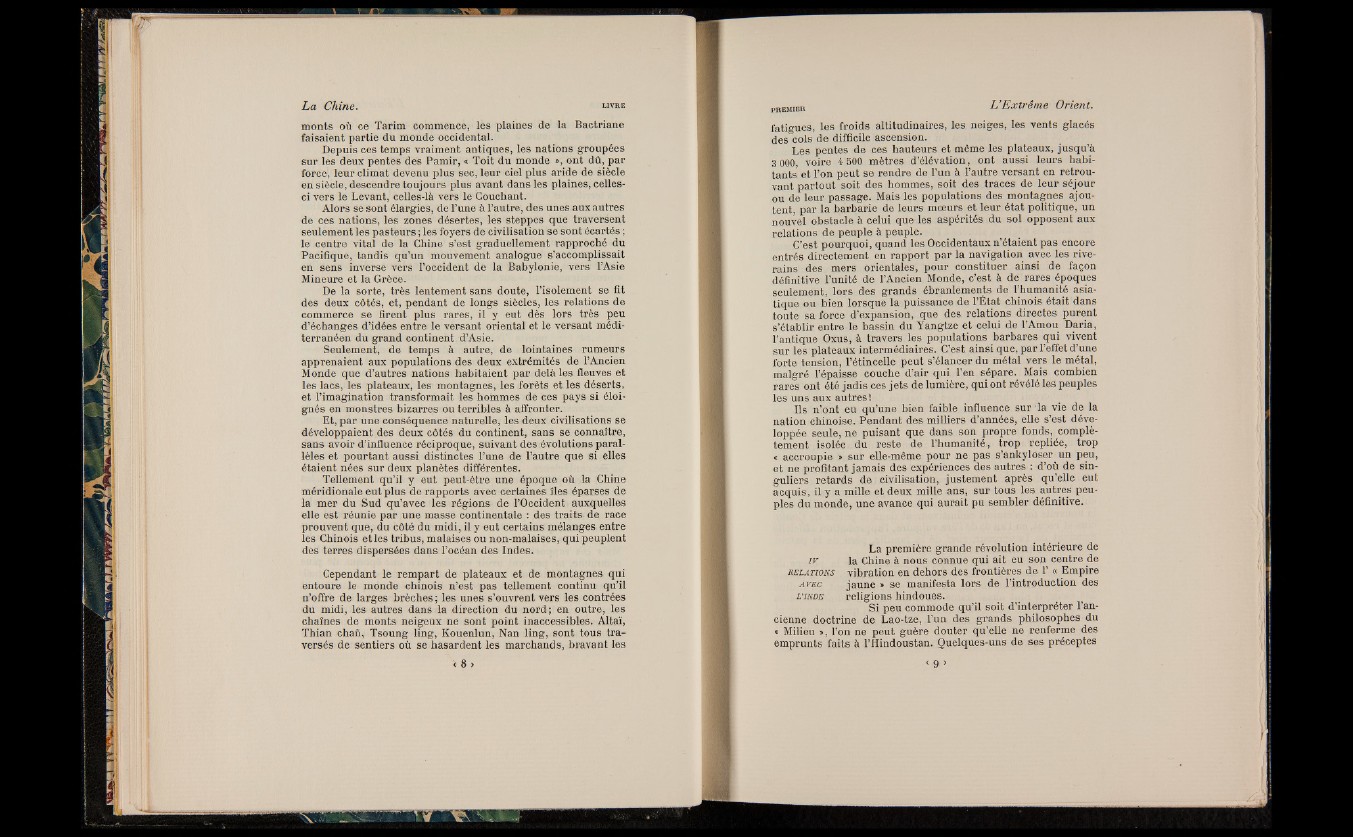
monts où ce Tarim commence, les plaines de la Bactriane
faisaient partie du monde occidental.
Depuis ces temps vraiment antiques, les nations groupées
sur les deux pentes des Pamir, « Toit du monde », ont dû, par
force, leur climat devenu plus sec, leur ciel plus aride de siècle
en siècle, descendre toujours plus avant dans les plaines, celles-
ci vers le Levant, celles-là vers le Couchant.
Alors se sont élargies, de l’une à l’autre, des unes aux autres
de ces nations, les zones désertes, les steppes que traversent
seulement les pasteurs ; les foyers de civilisation se sont écartés ;
le centre vital de la Chine s’est graduellement rapproché du
Pacifique, tandis qu’un mouvement analogue s’accomplissait
en sens inverse vers l’occident de la Babylonie, vers l’Asie
Mineure et la Grèce.
De la sorte, très lentement sans doute, l’isolement se fit
des deux côtés, et, pendant de longs siècles, les relations de
commerce se firent plus rares, il y eut dès lors très peu
d’échanges d’idées entre le versant oriental et le versant méditerranéen
du grand continent d’Asie.
Seulement, de temps à autre, de lointaines rumeurs
apprenaient aux populations des deux extrémités de l’Ancien
Monde que d’autres nations habitaient par delà les fleuves et
les lacs, les plateaux, les montagnes, les forêts et les déserts,
et l’imagination transformait les hommes de ces pays si éloignés
en monstres bizarres ou terribles à affronter.
Et, par une conséquence naturelle, les deux civilisations se
développaient des deux côtés du continent, sans se connaître,
sans avoir d’influence réciproque, suivant des évolutions parallèles
et pourtant aussi distinctes l’une de l’autre que si elles
étaient nées sur deux planètes différentes.
Tellement qu’il y eut peut-être une époque où la Chine
méridionale eut plus de rapports avec certaines îles éparses de
la mer du Sud qu’avec les régions de l’Occident auxquelles
elle est réunie par une masse continentale : des traits de race
prouvent que, du côté du midi, il y eut certains mélanges entre
les Chinois et les tribus, malaises ou non-malaises, qui peuplent
des terres dispersées dans l’océan des Indes.
Cependant le rempart de plateaux et de montagnes qui
entoure le monde chinois n ’est pas tellement continu qu’il
n’offre de larges brèches ; les unes s’ouvrent vers les contrées
du midi, les autres dans la direction du nord; en outre, les
chaînes de monts neigeux ne sont point inaccessibles. Altaï,
Thian chañ, Tsoung ling, Kouenlun, Nan ling, sont tous traversés
de sentiers où se hasardent les marchands, bravant les
fatigues, les froids altitudinaires, les neiges, les vents glacés
des cols de difficile ascension.
Les pentes de ces hauteurs et même les plateaux, jusqu’à
3 000, voire 4 500 mètres d’élévation, ont aussi leurs habitants
et l’on peut se rendre de l’un à l’autre versant en retrouvant
partout soit des hommes, soit des traces de leur séjour
ou de leur passage. Mais les populations des montagnes ajoutent,
par la barbarie de leurs moeurs et leur état politique, un
nouvel obstacle à celui que les aspérités du sol opposent aux
relations de peuple à peuple.
C’est pourquoi, quand les Occidentaux n’étaient pas encore
entrés directement en rapport par la navigation avec les riverains
des mers orientales, pour constituer ainsi de façon
définitive l’unité de l’Ancien Monde, c’est à de rares époques
seulement, lors des grands ébranlements de l’humanité asiatique
ou bien lorsque la puissance de l’État chinois était dans
toute sa force d’expansion, que des relations directes purent
s’établir entre le bassin du Yangtze et celui de l’Amou Daria,
l’antique Oxus, à travers les populations barbares qui vivent
sur les plateaux intermédiaires. C’est ainsi que, par l’effet d’une
forte tension, l’étincelle peut s’élancer du métal vers le métal,
malgré l’épaisse couche d’air qui l’en sépare. Mais combien
rares ont été jadis ces jets de lumière, qui ont révélé les peuples
les uns aux autres !
Ils n’ont eu qu’une bien faible influence sur la vie de la
nation chinoise. Pendant des milliers d’années, elle s’est développée
seule, ne puisant que dans son propre fonds, complètement
isolée du reste de l’humanité, trop repliée, trop
i accroupie » sur elle-même pour ne pas s’ankyloser un peu,
et ne profitant jamais des expériences des autres : d’où de singuliers
retards de civilisation, justement après qu’elle eut
acquis, il y a mille et deux mille ans, sur tous les autres peuples
du monde, une avance qui aurait pu sembler définitive.
La première grande révolution intérieure de
iv la Chine à nous connue qui ait eu son centre de
r e l a t io n s vibration en dehors des frontières de 1’ « Empire
a v e c jaune » se manifesta lors de l’introduction des
l 'in d e religions hindoues.
Si peu commode qu’il soit d’interpréter l’ancienne
doctrine de Lao-tze, l’un des grands philosophes du
« Milieu », l’on ne peut guère douter qu’elle ne renferme des
emprunts faits à l’Hindoustan. Quelques-uns de ses préceptes