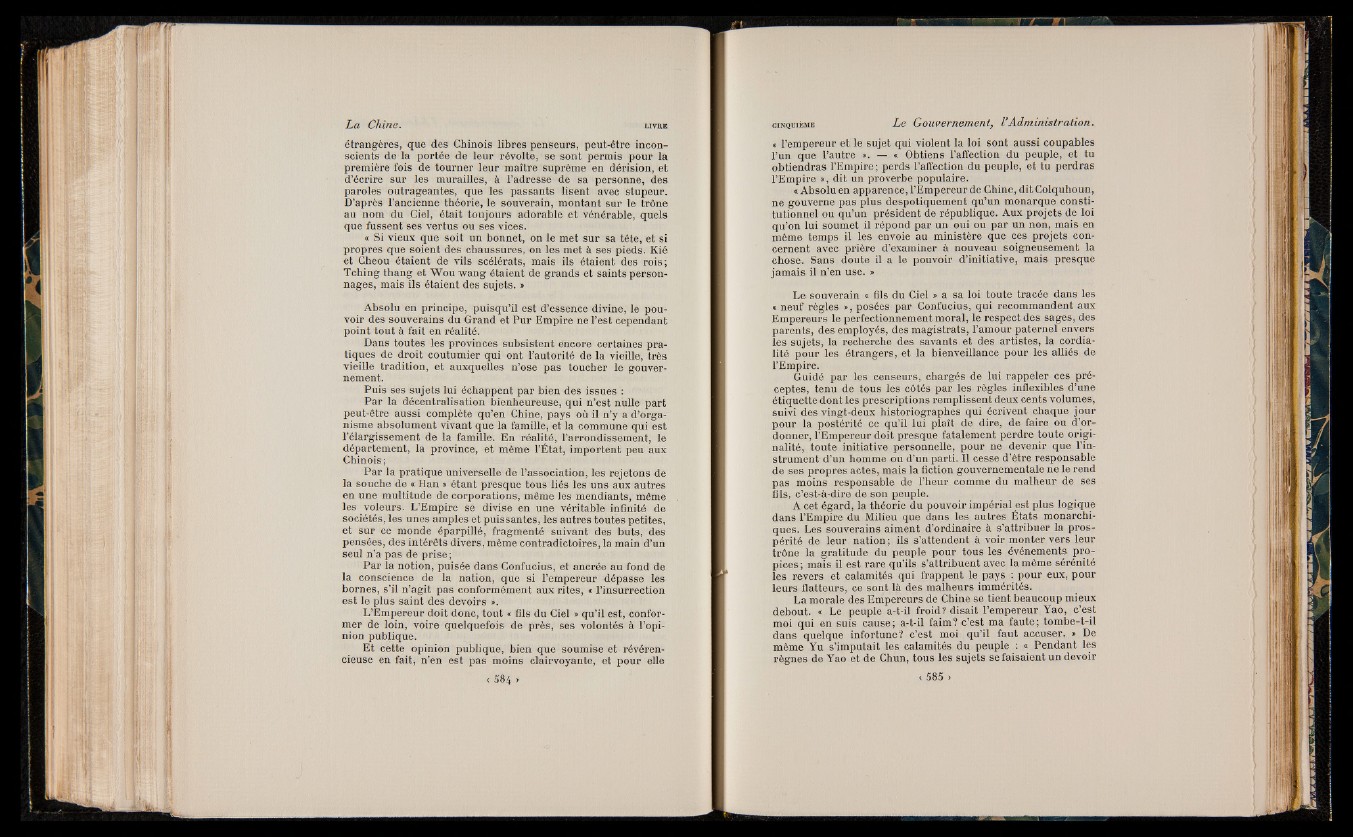
étrangères, que des Chinois libres penseurs, peut-être inconscients
de la portée de leur révolte, se sont permis pour la
première fois de tourner leur maître suprême en dérision, et
d’écrire sur les murailles, à l’adresse de sa personne, des
paroles outrageantes, que les passants lisent avec stupeur.
D’après l’ancienne théorie, le souverain, montant sur le trône
au nom du Ciel, était toujours adorable et vénérable, quels
que fussent ses vertus ou ses vices.
« Si vieux que soit un bonnet, on le met sur sa tête, et si
propres que soient des chaussures, on les met à ses pieds. Kié
et Cheou étaient de vils scélérats, mais ils étaient des rois;
Tching thang et Wou wang étaient de grands et saints personnages,
mais ils étaient des sujets. »
Absolu en principe, puisqu’il est d’essence divine, le pouvoir
des souverains du Grand et Pur Empire ne l’est cependant
point tout à fait en réalité.
Dans toutes les provinces subsistent encore certaines pratiques
de droit coutumier qui ont l’autorité de la vieille, très
vieille tradition, et auxquelles n’ose pas toucher le gouvernement.
Puis ses sujets lui échappent par bien des issues :
Par la décentralisation bienheureuse, qui n’est nulle part
peut-être aussi complète qu’en Chine, pays où il n’y a d’organisme
absolument vivant que la famille, et la commune qui est
l’élargissement de la famille. En réalité, l’arrondissement, le
département, la province, et même l’État, importent peu aux
Chinois;
Par la pratique universelle de l’association, les rejetons de
la souche de « Han » étant presque tous liés les uns aux autres
en une multitude de corporations, même les mendiants, même
les voleurs. L’Empire se divise en une véritable infinité de
sociétés, les unes amples et puissantes, les autres toutes petites,
et sur ce monde éparpillé, fragmenté suivant des buts, des
pensées, des intérêts divers, même contradictoires, la main d’un
seul n’a pas de prise ;
Par la notion, puisée dans Confucius, et ancrée au fond de
la conscience de la nation, que si l’empereur dépasse les
bornes, s’il n’agit pas conformément aux rites, * l’insurrection
est le plus saint des devoirs ».
L’Empereur doit donc, tout « fils du Ciel » qu’il est, conformer
de loin, voire quelquefois de près, ses volontés à l’opinion
publique.
Et cette opinion publique, bien que soumise et révérencieuse
en fait, n’en est pas moins clairvoyante, et pour elle
t l’empereur et le sujet qui violent la loi sont aussi coupables
l’un que l’autre ». — « Obtiens l’affection du peuple, et tu
obtiendras l’Empire ; perds l’affection du peuple, et tu perdras
l’Empire », dit un proverbe populaire.
« Absolu en apparence, l’Empereur de Chine, dit Colquhoun,
ne gouverne pas plus despotiquement qu’un monarque constitutionnel
ou qu’un président de république. Aux projets de loi
qu’on lui soumet il répond par un oui ou par un non, mais en
même temps il les envoie au ministère que ces projets concernent
avec prière d’examiner à nouveau soigneusement la
chose. Sans doute il a le pouvoir d’initiative, mais presque
jamais il n’en use. »
Le souverain « fils du Ciel » a sa loi toute tracée dans les
» neuf règles », posées par Confucius, qui recommandent aux
Empereurs le perfectionnement moral, le respect des sages, des
parents, des employés, des magistrats, l’amour paternel envers
les sujets, la recherche des savants et des artistes, la cordialité
pour les étrangers, et la bienveillance pour les alliés de
l’Empire.
Guidé par les censeurs, chargés de lui rappeler ces préceptes,
tenu de tous les côtés par les règles inflexibles d’une
étiquette dont les prescriptions remplissent deux cents volumes,
suivi des vingt-deux historiographes qui écrivent chaque jour
pour la postérité ce qu’il lui plaît de dire, de faire ou d’ordonner,
l’Empereur doit presque fatalement perdre toute originalité,
toute initiative personnelle, pour ne devenir que l’instrument
d’un homme ou d’un parti. Il cesse d’être responsable
de ses propres actes, mais la fiction gouvernementale ne le rend
pas moins responsable de l’heur comme du malheur de ses
fils, c’est-à-dire de son peuple.
A cet égard, la théorie du pouvoir impérial est plus logique
dans l’Empire du Milieu que dans les autres États monarchiques.
Les souverains aiment d’ordinaire à s’attribuer la prospérité
de leur nation ; ils s’attendent à voir monter vers leur
trône la gratitude du peuple pour tous les événements propices
; mais il est rare qu’ils s’attribuent avec la même sérénité
les revers et calamités qui frappent le pays : pour eux, pour
leurs flatteurs, ce sont là des malheurs immérités.
La morale des Empereurs de Chine se tient beaucoup mieux
debout. « Le peuple a-t-il froid? disait l’empereur Yao, c’est
moi qui en suis cause; a-t-il faim? c’est ma faute; tombe-t-il
dans quelque infortune? c’est moi qu’il faut accuser. » De
même Yu s’imputait les calamités du peuple : « Pendant les
règnes de Yao et de Chun, tous les sujets se faisaient un devoir