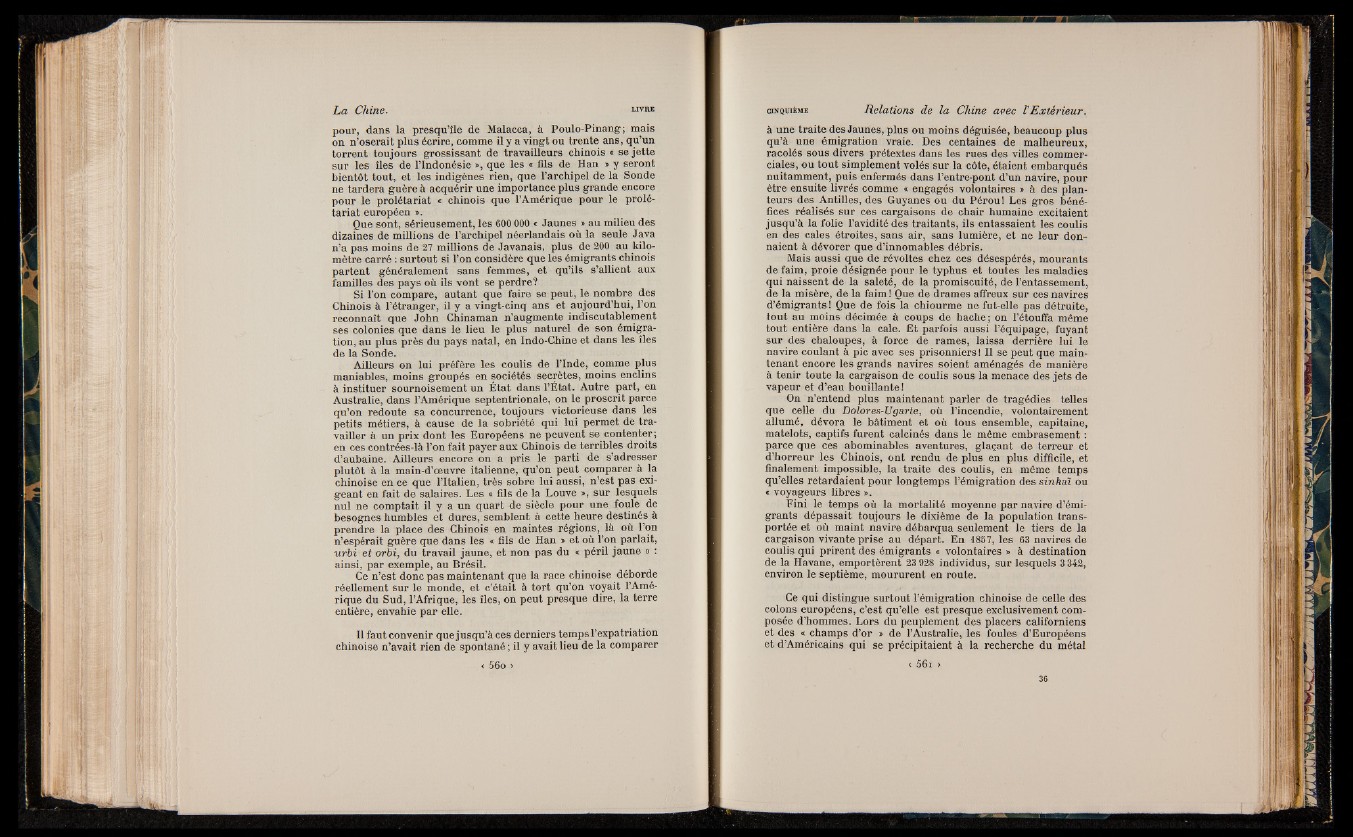
pour, dans la presqu’île de Malacca, à Poulo-Pinang; mais
on n’oserait plus écrire, comme il y a vingt ou trente ans, qu’un
torrent toujours grossissant de travailleurs chinois t se jette
sur les îles de l’Indonésie », que les « fils de Han » y seront
bientôt tout, et les indigènes rien, que l’archipel de la Sonde
ne tardera guère à acquérir une importance plus grande encore
pour le prolétariat * chinois que l’Amérique pour le prolétariat
européen ».
Que sont, sérieusement, les 600 000 « Jaunes » au milieu des
dizaines de millions de l’archipel néerlandais où la seule Java
n’a pas moins de 27 millions de Javanais, plus de 200 au kilomètre
carré : surtout si l’on considère que les émigrants chinois
partent généralement sans femmes, et qu’ils s’allient aux
familles des pays où ils vont se perdre?
Si l’on compare, autant que faire se peut, le nombre des
Chinois à l’étranger, il y a vingt-cinq ans et aujourd’hui, l’on
reconnaît que John Chinaman n’augmente indiscutablement
ses colonies que dans le lieu le plus naturel de son émigration,
au plus près du pays natal, en Indo-Chine et dans les îles
de la Sonde.
Ailleurs on lui préfère les coulis de l’Inde, comme plus
maniables, moins groupés en sociétés secrètes, moins enclins
à instituer sournoisement un État dans l’État. Autre part, en
Australie, dans l’Amérique septentrionale, on le proscrit parce
qu’on redoute sa concurrence, toujours victorieuse dans les
petits métiers, à cause de la sobriété qui lui permet de travailler
à un prix dont les Européens ne peuvent se contenter;
en ces contrées-là l’on fait payer aux Chinois de terribles droits
d’aubaine. Ailleurs encore on a pris le parti de s’adresser
plutôt à la main-d’oeuvre italienne, qu’on peut comparer à la
chinoise en ce que l’Italien, très sobre lui aussi, n’est pas exigeant
en fait de salaires. Les « fils de la Louve », sur lesquels
nul ne comptait il y a un quart de siècle pour une foule de
besognes humbles et dures, semblent à cette heure destinés à
prendre la place des Chinois en maintes régions, là où l’on
n’espérait guère que dans les t fils de Han » et où l’on parlait,
u rbi et orbi, du travail jaune, et non pas du « péril jaune » :
ainsi, par exemple, au Brésil.
Ce n’est donc pas maintenant que la race chinoise déborde
réellement sur le monde, et c’était à to rt qu’on voyait l’Amérique
du Sud, l’Afrique, les îles, on peut presque dire, la terre
entière, envahie par elle.
Il faut convenir que jusqu’à ces derniers temps l’expatriation
chinoise n’avait rien de spontané ; il y avait lieu de la comparer
à une traite des Jaunes, plus ou moins déguisée, beaucoup plus
qu’à une émigration vraie. Des centaines de malheureux,
racolés sous divers prétextes dans les rues des villes commerciales,
ou tout simplement volés sur la côte, étaient embarqués
nuitamment, puis enfermés dans l’entre-pont d’un navire, pour
être ensuite livrés comme « engagés volontaires » à des planteurs
des Antilles, des Guyanes ou du Pérou! Les gros bénéfices
réalisés sur ces cargaisons de chair humaine excitaient
jusqu’à la folie l’avidité des traitants, ils entassaient les coulis
en des cales étroites, sans air, sans lumière, et ne leur donnaient
à dévorer que d’innomables débris.
Mais aussi que de révoltes chez ces désespérés, mourants
de faim, proie désignée pour le typhus et toutes les maladies
qui naissent de la saleté, de la promiscuité, de l’entassement,
de la misère, de la faim ! Que de drames affreux sur ces navires
d’émigrants ! Que de fois la chiourme ne fut-elle pas détruite,
tout au moins décimée à coups de hache; on l’étouffa même
tout entière dans la cale. Et parfois aussi l’équipage, fuyant
sur des chaloupes, à force de rames, laissa derrière lui le
navire coulant à pic avec ses prisonniers! Il se peut que maintenant
encore les grands navires soient aménagés de manière
à tenir toute la cargaison de coulis sous la menace des jets de
vapeur et d’eau bouillante!
On n’entend plus maintenant parler de tragédies telles
que celle du Dolores-Ugarte, où l’incendie, volontairement
allumé, dévora le bâtiment et où tous ensemble, capitaine,
matelots, captifs furent calcinés dans le même embrasement :
parce que ces abominables aventures, glaçant de terreur et
d’horreur les Chinois, ont rendu de plus en plus difficile, et
finalement impossible, la traite des coulis, en même temps
qu’elles retardaient pour longtemps l’émigration des sinha/i ou
« voyageurs libres ».
Fini le temps où la mortalité moyenne par navire d’émigrants
dépassait toujours le dixième de la population transportée
et où maint navire débarqua seulement le tiers de la
cargaison vivante prise au départ. En 18S7, les 63 navires de
coulis qui prirent des émigrants « volontaires » à destination
de la Havane, emportèrent 23 928 individus, sur lesquels 3 342,
environ le septième, moururent en route.
Ce qui distingue surtout l’émigration chinoise de celle des
colons européens, c’est qu’elle est presque exclusivement composée
d’hommes. Lors du peuplement des placers californiens
et des « champs d’or » de l’Australie, les foules d’Européens
et d’Américains qui se précipitaient à la recherche du métal