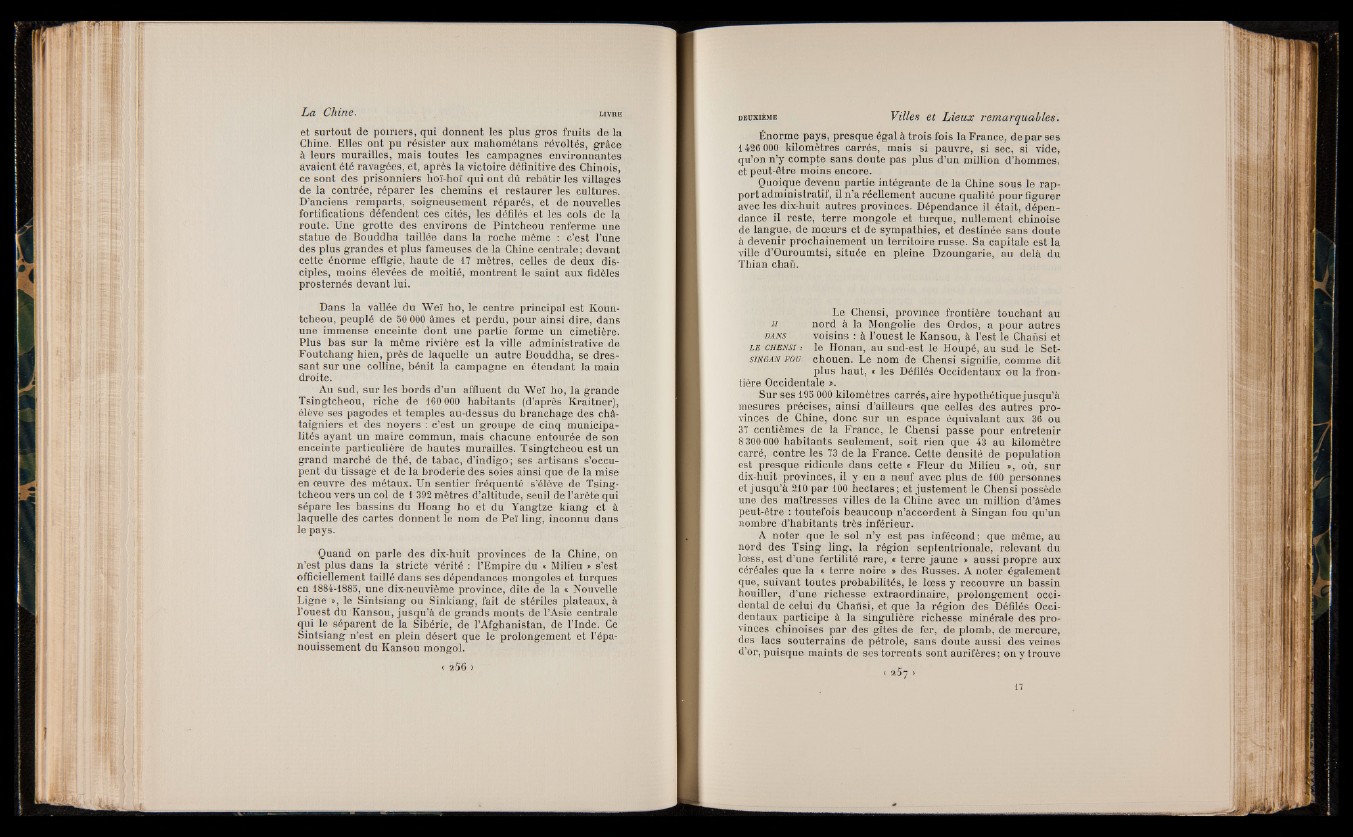
et surtout de poiriers, qui donnent les plus gros fruits de la
Chine. Elles ont pu résister aux mahométans révoltés, grâce
à leurs murailles, mais toutes les campagnes environnantes
avaient été ravagées, et, après la victoire définitive des Chinois,
ce sont des prisonniers hol-hoï qui ont dû rebâtir les villages
de la contrée, réparer les chemins et restaurer les cultures.
D’anciens remparts, soigneusement réparés, et de nouvelles
fortifications défendent ces cités, les défilés et les cols de la
route. Une grotte des environs de Pintcheou renferme une
statue de Bouddha taillée dans la roche même : c’est l’une
des plus grandes et plus fameuses de la Chine centrale ; devant
cette énorme effigie, haute de 17 mètres, celles de deux disciples,
moins élevées de moitié, montrent le saint aux fidèles
prosternés devant lui.
Dans la vallée du Weï ho, le centre principal est Koun-
tcheou, peuplé de 50 000 âmes et perdu, pour ainsi dire, dans
une immense enceinte dont une partie forme un cimetière.
Plus bas sur la même rivière est la ville administrative de
Foutchang hien, près de laquelle un autre Bouddha, se dressant
sur une colline, bénit la campagne en étendant la main
droite.
Au sud, sur les bords d’un affluent du Weï ho, la grande
Tsingtcheou, riche de 160 000 habitants (d’après Kraitner),
élève ses pagodes et temples au-dessus du branchage des châtaigniers
et des noyers : c’est un groupe de cinq municipalités
ayant un maire commun, mais chacune entourée de son
enceinte particulière de hautes murailles. Tsingtcheou est un
grand marché de thé, de tabac, d’indigo ; ses artisans s’occupent
du tissage et de la broderie des soies ainsi que de la mise
en oeuvre des métaux. Un sentier fréquenté s’élève de Tsingtcheou
vers un col de 1 392 mètres d’altitude, seuil de l’arête qui
sépare les bassins du Hoang ho et du Yangtze kiang et à
laquelle des cartes donnent le nom de Peï ling, inconnu dans
le pays.
Quand on parle des dix-huit provinces de la Chine, on
n ’est plus dans la stricte vérité : l’Empire du « Milieu » s’est
officiellement taillé dans ses dépendances mongoles et turques
en 1884-1885, une dix-neuvième province, dite de la « Nouvelle
Ligne », le Sintsiang ou Sinkiang, fait de stériles plateaux, à
l’ouest du Kansou, jusqu’à de grands monts de l’Asie centrale
qui le séparent de la Sibérie, de l’Afghanistan, de l’Inde. Ce
Sintsiang n’est en plein désert que le prolongement et l’épanouissement
du Kansou mongol.
Énorme pays, presque égal à trois fois la France, de par ses
1426 000 kilomètres carrés, mais si pauvre, si sec, si vide,
qu’on n’y compte sans doute pas plus d’un million d’hommes,
et peut-être moins encore.
Quoique devenu partie intégrante de la Chine sous le rapport
administratif, il n’a réellement aucune qualité pour figurer
avec les dix-huit autres provinces. Dépendance il était, dépendance
il reste, terre mongole et turque, nullement chinoise
de langue, de moeurs et de sympathies, et destinée sans doute
à devenir prochainement un territoire russe. Sa capitale est la
ville d’Ouroumtsi, située en pleine Dzoungarie, au delà du
Thian chan.
Le Chensi, province frontière touchant au
a nord à la Mongolie des Ordos, a pour autres
d a n s voisins ; à l’ouest le Kansou, à l’est le Ghaîïsi et
l e c h e n s i : le Honan, au sud-est le Houpé, au sud. le Set-
s in g a n f o u ! chouen. Le nom de Chensi signifie, comme dit
plus haut, » les Défilés Occidentaux ou la frontière
Occidentale ».
Sur ses 195 000 kilomètres carrés, aire hypothétique jusqu’à
mesures précises, ainsi d’ailleurs que celles des autres provinces
de Chine, donc sur un espace équivalant aux 36 ou
37 centièmes de la France, le Chensi passe pour entretenir
8 300 000 habitants seulement, soit rien que 43 au kilomètre
carré, contre les 73 de la France. Cette densité de population
est presque ridicule dans cette « Fleur du Milieu », où, sur
dix-huit provinces, il y en a neuf avec plus de 100 personnes
et jusqu’à 210 par 100 hectares ; et justement le Chensi possède
une des maîtresses villes de la Chine avec un million d’âmes
peut-être : toutefois beaucoup n’accordent à Singan fou qu’un
nombre d’habitants très inférieur.
A noter que le sol n’y est pas infécond ; que même, au
nord des Tsing ling, la région septentrionale, relevant du
loess, est d’une fertilité rare, » terre jaune » aussi propre aux
céréales que la « terre noire » des Russes. A noter également
que, suivant toutes probabilités, le loess y recouvre un bassin
houiller, d’une richesse extraordinaire, prolongement occidental
de celui du Chafisi, et que la région des Défilés Occidentaux
participe à la singulière richesse minérale des provinces
chinoises par des gîtes de fer, de plomb, de mercure,
des lacs souterrains de pétrole, sans doute aussi des veines
d’or, puisque maints de ses torrents sont aurifères ; on y trouve
n