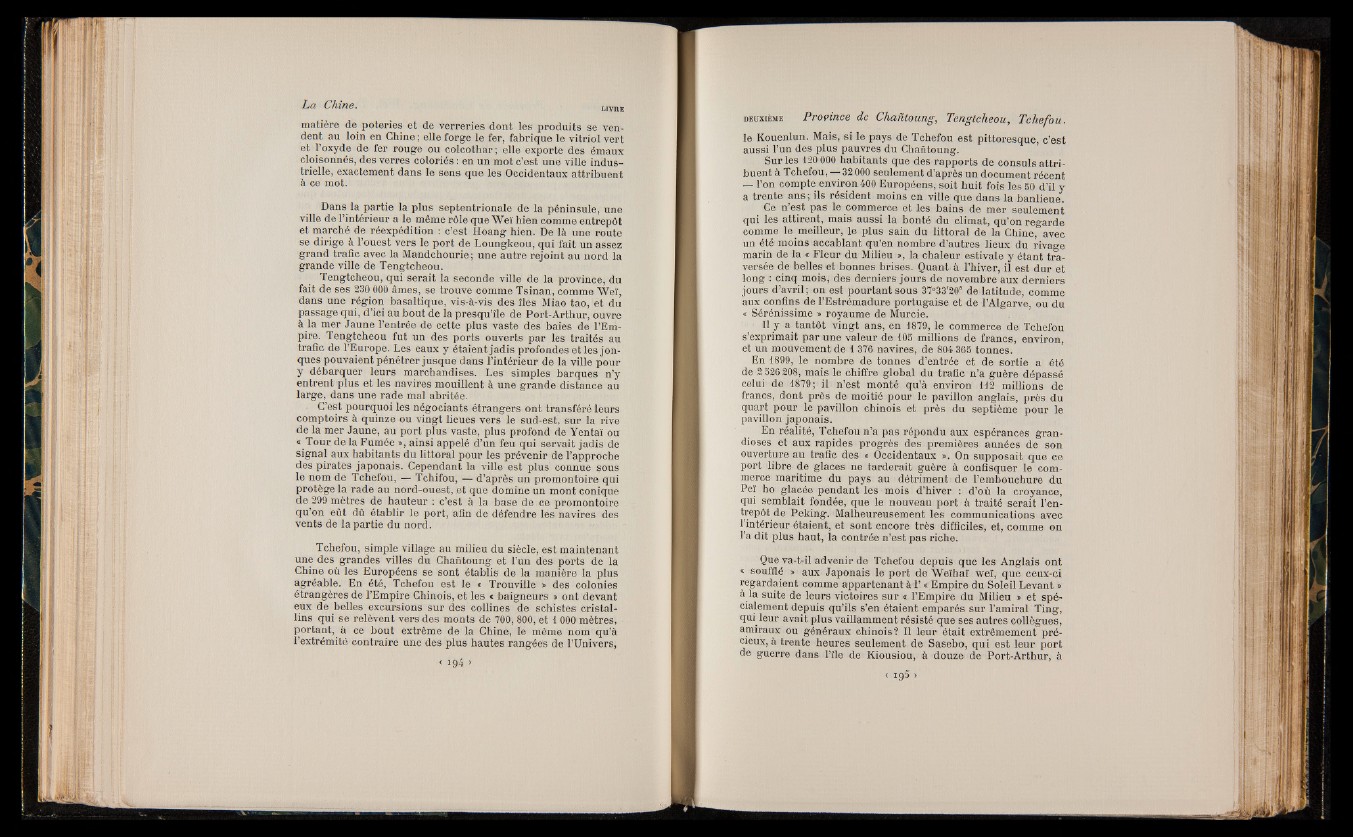
matière de poteries et de verreries dont les produits se vendent
au loin en Chine ; elle forge le fer, fabrique le vitriol vert
et l’oxyde de fer rouge ou colcothar; elle exporte des émaux
cloisonnés, des verres coloriés : en un mot c’est une ville industrielle,
exactement dans le sens que les Occidentaux attribuent
à ce mot.
Dans la partie la plus septentrionale de la péninsule, une
ville de l’intérieur a le même rôle que Weï hien comme entrepôt
et marché de réexpédition : c’est Hoang hien. De là une route
se dirige à l’ouest vers le port de Loungkeou, qui fait un assez
grand trafic avec la Mandchourie; une autre rejoint au nord la
grande ville de Tengtcheou.
Tengtcheou, qui serait la seconde ville de la province, du
fait de ses 230 000 âmes, se trouve comme Tsinan, comme Weï,
dans une région basaltique, vis-à-vis des îles Miao tao, et du
passage qui, d’ici au bout de la presqu’île de Port-Arthur, ouvre
à la mer Jaune l’entrée de cette plus vaste des baies de l’Empire.
Tengtcheou fut un des ports ouverts par les traités au
trafic de l’E urope. Les eaux y étaient jadis profondes et les jonques
pouvaient pénétrer jusque dans l’intérieur de la ville pour
y débarquer leurs marchandises. Les simples barques n’y
entrent plus et les navires mouillent à une grande distance au
large, dans une rade mal abritée.
C’est pourquoi les négociants étrangers ont transféré leurs
comptoirs à quinze ou vingt lieues vers le sud-est, sur la rive
de la mer Jaune, au port plus vaste, plus profond de Yentaï ou
‘ Tout de la Fumée », ainsi appelé d’un feu qui servait jadis de
signal aux habitants du littoral pour les prévenir de l’approche
des pirates japonais. Cependant la ville est plus connue sous
le nom de Tchefou, — Tchifou, —- d’après un promontoire qui
protège la rade au nord-ouest, et que domine un mont conique
de 299 mètres de hauteur : c’est à la base de ce promontoire
qu’on eût dû établir le port, afin de défendre les navires des
vents de la partie du nord.
Tchefou, simple village au milieu du siècle, est maintenant
une des grandes villes du Chantoung et l’un des ports de la
Chine où les Européens se sont établis de la manière la plus
agréable. En été, Tchefou est le * Trouville » des colonies
étrangères de l’Empire Chinois, et les « baigneurs » ont devant
eux de belles excursions sur des collines de schistes cristallins
qui se relèvent vers des monts de 700, 800, et 1 000 mètres,
portant, à ce bout extrême de la Chine, le même nom qu’à
l’extrémité contraire une des plus hautes rangées de l’Univers,
d e u x i è m e Province de Chantoung, Tengtcheou, Tchefou.
le Kouenlun. Mais, si le pays de Tchefou est pittoresque, c’est
aussi l’un des plus pauvres du Chantoung.
Sur les 120 000 habitants que des rapports de consuls a ttribuent
à Tchefou, — 32 000 seulement d’après un document récent
— l’on compte environ 400 Européens, soit huit fois les B0 d ’il y
a trente ans; ils résident moins en ville que dans la banlieue.
Ce n’est pas le commerce et les bains de mer seulement
qui les attirent, mais aussi la bonté du climat, qu’on regarde
comme le meilleur, le plus sain du littoral de la Chine, avec
un été moins accablant qu’en nombre d’autres lieux du rivage
marin de la « Fleur du Milieu », la chaleur estivale y étant traversée
de belles et bonnes brises. Quant à l’hiver, il est dur et
long : cinq mois, des derniers jours de novembre aux derniers
jours d’avril; on est pourtant sous 37°33'20" de latitude, comme
aux confins de l’Estrémadure portugaise et de l’Algarve, ou du
« Sérénissime » royaume de Murcie.
Il y a tantôt vingt ans, en 1879, le commerce de Tchefou
s’exprimait par une valeur de 105 millions de francs, environ,
et un mouvement de 1 376 navires, de 804 365 tonnes.
En 1899, le nombre de tonnes d’entrée et de sortie a été
de 2 526 208, mais le chiffre global du trafic n ’a guère dépassé
celui de 1879; il n’est monté qu’à environ 112 millions de
francs, dont près de moitié pour le pavillon anglais, près du
quart pour le pavillon chinois et près du septième pour le
pavillon japonais.
En réalité, Tchefou n’a pas répondu aux espérances grandioses
et aux rapides progrès des premières années de son
ouverture au trafic des « Occidentaux ». On supposait que ce
port libre de glaces ne tarderait guère à confisquer le commerce
maritime du pays au détriment de l’embouchure du
Peï ho glacée pendant les mois d’hiver : d’où la croyance,
qui semblait fondée, que le nouveau port à traité serait l'entrepôt
de Peking. Malheureusement les communications avec
l’intérieur étaient, et sont encore très difficiles, et, comme on
l’a dit plus haut, la contrée n ’est pas riche.
Que va-t-il advenir de Tchefou depuis que les Anglais ont
« soufflé » aux Japonais le port de Weïhaï weï, que ceux-ci
regardaient comme appartenant à 1’ « Empire du Soleil Levant »
à la suite de leurs victoires sur t l’Empire du Milieu » et spécialement
depuis qu’ils s’en étaient emparés sur l’amiral Ting,
qui leur avait plus vaillamment résisté que ses autres collègues,
amiraux ou généraux chinois? Il leur était extrêmement précieux,
à trente heures seulement de Sasebo, qui est leur port
de guerre dans l’île de Kiousiou, à douze de Port-Arthur, à