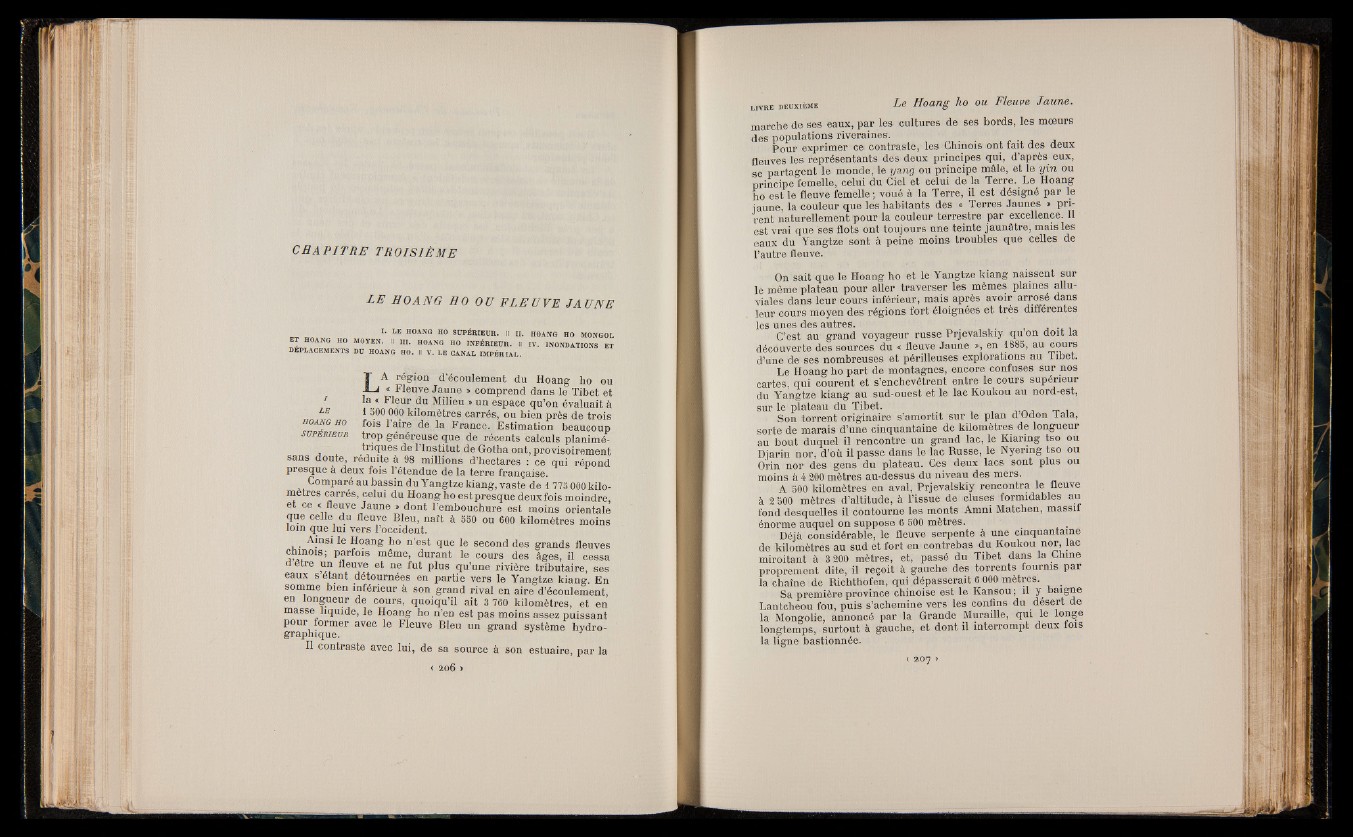
CH A P IT R E T ROI S IÈME
L E HO A N G HO OU F L E U V E JAU N E
I . L E HOANG HO SU P É R IEU R . Il H . HOANG HO MONGOL
ET HOANG HO MOYEN. Il I I I . HOANG HO IN F É R IE U R . Il IV . INONDATIONS ET
DEPLACEMENTS DU HOANG HO. Il V. L E CANAL IM P É R IA L .
LA région d ’écoulement du Hoang ho ou
« Fleuve Jaune » comprend dans le Tibet et
1 la « Fleur du Milieu » un espace qu’on évaluait à
lb 1 500 000 kilomètres carrés, ou bien près de trois
h o a n g HO fois l’aire de la France. Estimation beaucoup
s u p é r i e u r trop généreuse que de récents calculs planimé-
triques de l’Institut de Gotha ont, provisoirement
sans doute, réduite à 98 millions d’hectares : ce qui répond
presque à deux fois l’étendue de la terre française.
Comparé au bassin du Yangtze kiang, vaste de 1775 000 kilomètres
carrés, celui du Hoang ho est presque deux fois moindre,
et ce « fleuve Jaune » dont l’embouchure est moins orientale
que celle du fleuve Bleu, naît à 550 ou 600 kilomètres moins
loin que lui vers l’occident.
Ainsi le Hoang ho n ’est que le second des grands fleuves
!nA*n° 1S’ Pj?rï°*s même> durant le cours des âges, il cessa
d être un fleuve et ne fut plus qu’une rivière tributaire, ses
eaux s étant détournées en partie vers le Yangtze kiang. En
somme bien inférieur à son grand rival en aire d’écoulement,
en longueur de cours, quoiqu’il ait 3 760 kilomètres, et en
masse liquide, le Hoang ho n’en est pas moins assez puissant
pour former avec le Fleuve Bleu un grand système hydrographique.
J
Il contraste avec lui, de sa source à son estuaire, par la
marche de ses eaux, par les cultures de ses bords, les moeurs
des populations riveraines. ■
Pour exprimer ce contraste, les Chinois ont fait des deux
fleuves les représentants des deux principes qui, d’après eux,
se partagent le monde, le ?/ang ou principe mâle, et le yin ou
principe femelle, celui du Ciel et celui de la Terre. Le Hoang
ho est le fleuve femelle ; voué à la Terre, il est désigné par le
jaune, la couleur que les habitants des « Terres Jaunes » prirent
naturellement pour la couleur terrestre par excellence. Il
est vrai que ses flots ont toujours une teinte jaunâtre, mais les
eaux du Yangtze sont à peine moins troubles que celles de
l’autre fleuve.
On sait que le Hoang ho et le Yangtze kiang naissent sur
le même plateau pour aller traverser les mêmes plaines alluviales
dans leur cours inférieur; mais après avoir arrosé dans
leur cours moyen des régions fort éloignées et très différentes
les u n e s d e s a u tre s . .
C’est au grand voyageur russe Prjevalskiy qu on doit la
découverte des sources du « fleuve Jaune >, en 1885, au cours
d’une de ses nombreuses et périlleuses explorations au Tibet.
Le Hoang ho part de montagnes, encore confuses sur nos
cartes, qui courent et s’enchevêtrent entre le cours supérieur
du Yangtze kiang au sud-ouest et le lac Koukou au nord-est,
s u r le plateau du Tibet.
Son torrent originaire s’amortit sur le plan dUdon iala,
sorte de marais d’une cinquantaine de kilomètres de longueur
au bout duquel il rencontre un grand lac, le Kiaring tso ou
Djarin nor, d’où il passe dans le lac Russe, le Nyering tso ou
Orin nor des gens du plateau. Ces deux lacs sont plus ou
moins à 4 200 mètres au-dessus du niveau des mers.
A 500 kilomètres en aval, Prjevalskiy rencontra le fleuve
à 2 500 mètres d’altitude, à l’issue de cluses formidables au
fond desquelles il contourne les monts Amni Matchen, massif
énorme auquel on suppose 6 500 mètres.
Déjà c o n s id é ra b le , le fleuve s e rp e n te à u n e c in q u a n ta in e
d e k ilom è tre s au su d e t fo rt en c o n tre b a s d u Ko u k o u n o r , la c
m iro ita n t à 3 200 m è tre s , e t, p a s sé d u T ib e t d a n s la Chine
p ro p rem e n t d ite , il re ç o it à g a u c h e d e s to r r e n ts fo u rn is p a r
la c h a în e ide R ich th o fen , q u i d é p a s s e ra it 6 000 m è tre s .
Sa première province chinoise est le Kansou; il y baigne
Lantcheou fou, puis s’achemine vers les confins du désert de
la Mongolie, annoncé par la Grande Muraille, qui le longe
longtemps, surtout à gauche, et dont il interrompt deux lois
la ligne bastionnée.