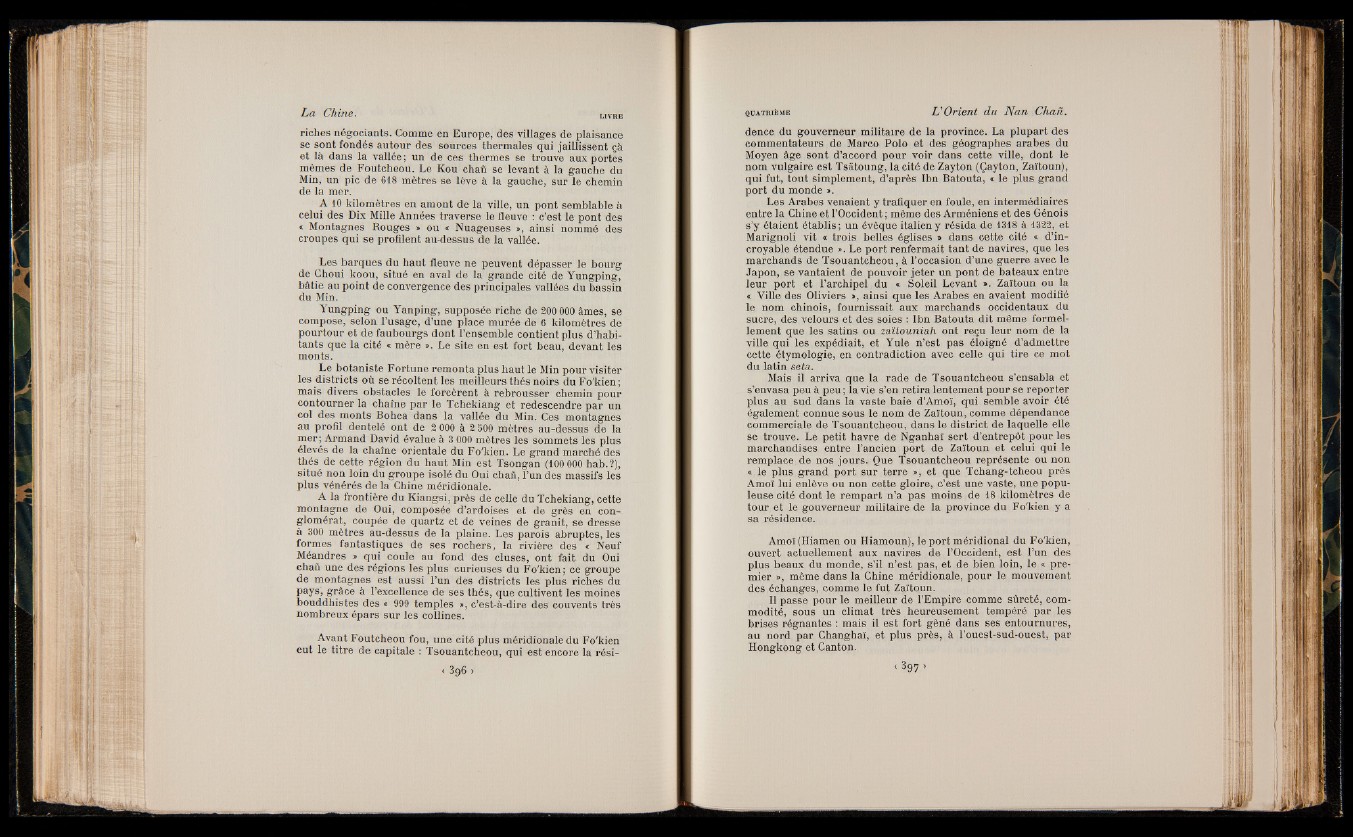
riches négociants. Comme en Europe, des villages de plaisance
se sont fondés autour des sources thermales qui jaillissent çà
et là dans la vallée ; un de ces thermes se trouve aux portes
mêmes de Foutcheou. Le Kou chan se levant à la gauche du
Min, un pic de 618 mètres se lève à la gauche, sur le chemin
de la mer.
A 10 kilomètres en amont de la ville, un pont semblable à
celui des Dix Mille Années traverse le fleuve : c’est le pont des
« Montagnes Rouges » ou * Nuageuses », ainsi nommé des
croupes qui se profilent au-dessus de la vallée.
Les barques du haut fleuve ne peuvent dépasser le bourg
de Choui koou, situé en aval de la grande cité de Yungping,
bâtie au point de convergence des principales vallées du bassin
du Min.
Yungping ou Yanping, supposée riche de 200 000 âmes, se
compose, selon l’usage, d’une place murée de 6 kilomètres de
pourtour et de faubourgs dont l’ensemble contient plus d ’habitants
que la cité « mère ». Le site en est fort beau, devant les
monts.
Le botaniste Fortune remonta plus haut le Min pour visiter
les districts où se récoltent les meilleurs thés noirs du Fo'kien ;
mais divers obstacles le forcèrent à rebrousser chemin pour
contourner la chaîne par le Tchekiang et redescendre par un
col des monts Bohea dans la vallée du Min. Ces montagnes
au profil dentelé ont de 2 000 à 2 500 mètres au-dessus de la
mer; Armand David évalue à 3 000 mètres les sommets les plus
élevés de la chaîne orientale du Fo'kien. Le grand marché des
thés de cette région du haut Min est Tsongan (100 000 hab.?),
situé non loin du groupe isolé du Oui chan, l’un des massifs les
plus vénérés de la Chine méridionale.
A la frontière du Kiangsi, près de celle du Tchekiang, cette
montagne de Oui, composée d’ardoises et de grès en conglomérat,
coupée de quartz et de veines de granit, se dresse
à 300 mètres au-dessus de la plaine. Les parois abruptes, les
formes fantastiques de ses rochers, la rivière des « Neuf
Méandres » qui coule au fond des cluses, ont fait du Oui
chan une des régions les plus curieuses du Fo'kien; ce groupe
de montagnes est aussi l’un des districts les plus riches du
pays, grâce à l’excellence de ses thés, que cultivent les moines
bouddhistes des » 999 temples », c’est-à-dire des couvents très
nombreux épars sur les collines.
Avant Foutcheou fou, une cité plus méridionale du Fo'kien
eut le titre de capitale : Tsouantcheou, qui est encore la résidence
du gouverneur militaire de la province. La plupart des
commentateurs de Marco Polo et des géographes arabes du
Moyen âge sont d’accord pour voir dans cette ville, dont le
nom vulgaire est Tsàtoung, la cité de Zayton (Çayton, Zaïtoun),
qui fut, tout simplement, d’après Ibn Batouta, « le plus grand
port du monde ».
Les Arabes venaient y trafiquer en foule, en intermédiaires
entre la Chine et l’Occident ; même des Arméniens et des Génois
s’y étaient établis ; un évêque italien y résida de 1318 à 1322, et
Marignoli vit « trois belles églises » dans cette cité « d’incroyable
étendue ». Le port renfermait tant de navires, que les
marchands de Tsouantcheou, à l’occasion d’une guerre avec le
Japon, se vantaient de pouvoir jeter un pont de bateaux entre
leur port et l’archipel du « Soleil Levant ». Zaïtoun ou la
« Ville des Oliviers », ainsi que les Arabes en avaient modifié
le nom chinois, fournissait aux marchands occidentaux du
sucre, des velours et des soies : Ibn Batouta dit même formellement
que les satins ou zaïtouniah ont reçu leur nom de la
ville qui les expédiait, et Yule n’est pas éloigné d’admettre
cette étymologie, en contradiction avec celle qui tire ce mot
du latin seta.
Mais il arriva que la rade de Tsouantcheou s’ensabla et
s’envasa peu à peu ; la vie s’en retira lentement pour se reporter
plus au sud dans la vaste baie d’Amoï, qui semble avoir été
également connue sous le nom de Zaïtoun, comme dépendance
commerciale de Tsouantcheou, dans le district de laquelle elle
se trouve. Le petit havre de Nganhaï sert d’entrepôt pour les
marchandises entre l’ancien port de Zaïtoun et celui qui le
remplace de nos jours. Que Tsouantcheou représente ou non
1 le plus grand port sur terre », et que Tchang-tcheou près
Amoï lui enlève ou non cette gloire, c’est une vaste, une populeuse
cité dont le rempart n’a pas moins de 18 kilomètres de
tour et le gouverneur militaire de la province du Fo'kien y a
sa résidence.
Amoï (Hiamen ou Hiamoun), le port méridional du Fo'kien,
ouvert actuellement aux navires de l’Occident, est l’un des
plus beaux du monde, s’il n’est pas, et de bien loin, le « premier
», même dans la Chine méridionale, pour le mouvement
des échanges, comme le fut Zaïtoun.
Il passe pour le meilleur de l’Empire comme sûreté, commodité,
sous un climat très heureusement tempéré par les
brises régnantes : mais il est fort gêné dans ses entournures,
au nord par Changhaï, et plus près, à l’ouest-sud-ouest, par
Hongkong et Canton.