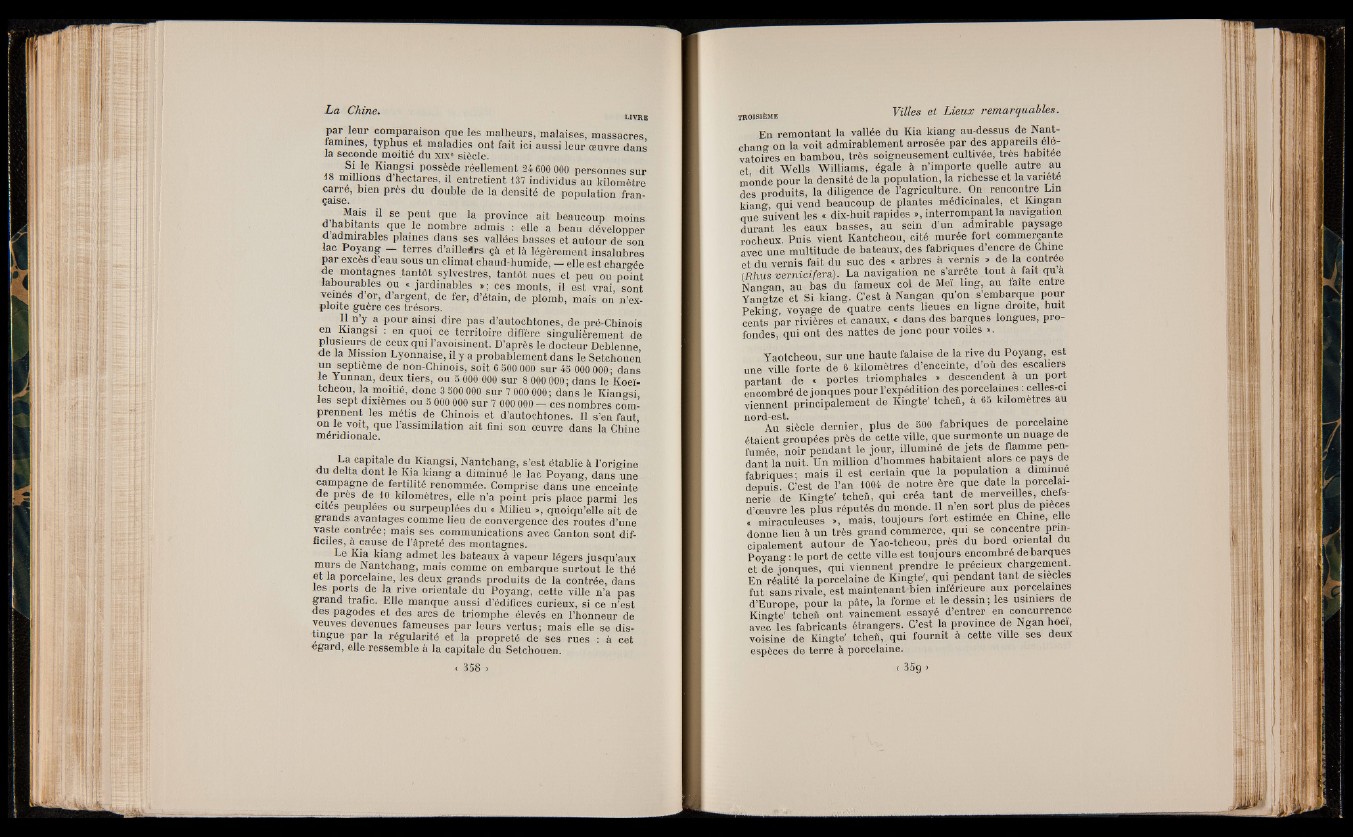
par leur comparaison que les malheurs, malaises, massacres
famines, typhus et maladies ont fait ici aussi leur oeuvre dans
la seconde moitié du xixe siècle.
Si le Kiangsi possède réellement 24 600 000 personnes sur
18 millions d’hectares, il entretient 137 individus au kilomètre
carré, bien près du double de la densité de population française.
,,, Mais il se peut que la province ait beaucoup moins
d habitants que le nombre admis : elle a beau développer
d admirables plaines dans ses vallées basses et autour de son
lac Poyang — terres d’ailleirs çà et là légèrement insalubres
par excès d eau sous un climat chaud-humide, — elle est chargée
de montagnes tantôt sylvestres, tantôt nues et peu ou point
labourables ou « jardinables >; ces monts, il est vrai sont
veines d’or, d’argent, de fer, d’étain, de plomb, mais on n ’exploite
guère ces trésors.
Il n’y a pour ainsi dire pas d’autochtones, de pré-Chinois
en Kiangsi : en quoi ce territoire diffère singulièrement de
plusieurs de ceux qui l’avoisinent. D’après le docteur Deblenne,
de la Mission Lyonnaise, il y a probablement dans le Setchouen
un septième de non-Chinois, soit 6 500 000 sur 45 000 000; dans
le Yunnan, deux tiers, ou 5 000 000 sur 8 000 000; dans le Koeï-
tcheou, la moitié, donc 3 500 000 sur 7 000 000 ; dans le Kiangsi
les sept dixièmes ou 5 000 000 sur 7 000 000 — ces nombres comprennent
les métis de Chinois et d’autochtones. Il s’en faut
on le voit, que l’assimilation ait fini son oeuvre dans la Chiné
méridionale.
La capitale du Kiangsi, Nantchang, s’est établie à l’origine
du delta dont le Kia kiang a diminué le lac Poyang, dans une
campagne de fertilité renommée. Comprise dans une enceinte
de près de 10 kilomètres, elle n’a point pris place parmi les
cités peuplées ou surpeuplées du . Milieu », quoiqu’elle ait de
grands avantages comme lieu de convergence des routes d’une
vaste contrée; mais ses communications avec Canton sont difficiles,
à cause de l’âpreté des montagnes.
Le Kia kiang admet les bateaux à vapeur légers jusqu’aux
murs de Nantchang, mais comme on embarque surtout le thé
e t la porcelaine, les deux grands produits de la contrée, dans
les ports de la rive orientale du Poyang, cette ville n’a pas
grand trafic. Elle manque aussi d’édifices curieux, si ce n’est
des pagodes et des arcs de triomphe élevés en l’honneur de
veuves devenues fameuses par leurs vertus; mais elle se distingue
par la régularité et la propreté de ses rues : à cet
égard, elle ressemble à la capitale du Setchouen.
En remontant la vallée du Kia kiang au-dessus de Nantchang
on la voit admirablement arrosée par des appareils élé-
vatoires en bambou, très soigneusement cultivée, très habitée
et dit Wells Williams, égale à n’importe quelle autre au
monde pour la densité de la population, la richesse et la variété
des produits, la diligence de l’agriculture. On rencontre Lin
kiang qui vend beaucoup de plantes médicinales, et Kmgan
aue suivent les « dix-huit rapides », interrompant la navigation
durant les eaux basses, au sein d’un admirable paysage
rocheux. Puis vient Kantcheou, cité murée fort commerçante
avec une multitude de bateaux, des fabriques d’encre de Chine
et du vernis fait du suc des * arbres à vernis » de la contrée
(Rhus vernicifera). La navigation ne s’arrête tout à fait q u à
Nangan au bas du fameux col de Meï ling, au faite entre
Yangtze et Si kiang. C’est à Nangan qu’on s’embarque pour
Peking voyage de quatre cents lieues en ligne droite, huit
cents par rivières et canaux, « dans des barques longues, profondes,
qui ont des nattes de jonc pour voiles ».
Yaotcheou, sur une haute falaise de la rive du Poyang, est
une ville forte de 6 kilomètres d’enceinte, d’où des escaliers
partant de * portes triomphales » descendent à un port
encombré de jonques pour l’expédition des porcelaines : celles-ci
viennent principalement de Kingte' tchen, à 65 kilomètres au
nord-est •
Au siècle dernier, plus de 500 fabriques de porcelaine
étaient groupées près de cette ville, que surmonte un nuage de
fumée noir pendant le jour, illuminé de jets de flamme pendant
la nuit. Un million d’hommes habitaient alors ce pays de
fabriques; mais il est certain que la population a diminué
depuis. C’est de l’an 1004 de notre ère que date la porcelai-
nerie de Kingte' tchen, qui créa tant de merveilles, chefs-
d’oeuvre les plus réputés du monde. Il n’en sort plus de pièces
« miraculeuses », mais, toujours fort estimée en Chine, elle
donne lieu à un très grand commerce, qui se concentre principalement
autour de Yao-tcheou, près du bord oriental du
Poyang| le port de cette ville est toujours encombré débarqués
et de jonques, qui viennent prendre le précieux chargement.
En réalité la porcelaine de Kingte', qui pendant tant de siècles
fut sans rivale, est maintenant bien inférieure aux porcelaines
d’Europe, pour la pâte, la forme et le dessin; les usiniers de
Kingte' tchen ont vainement essayé d’entrer en concurrence
avec les fabricants étrangers. C’est la province de Ngan hoei,
voisine de Kingte' tchen, qui fournit à cette ville ses deux
espèces de terre à porcelaine.