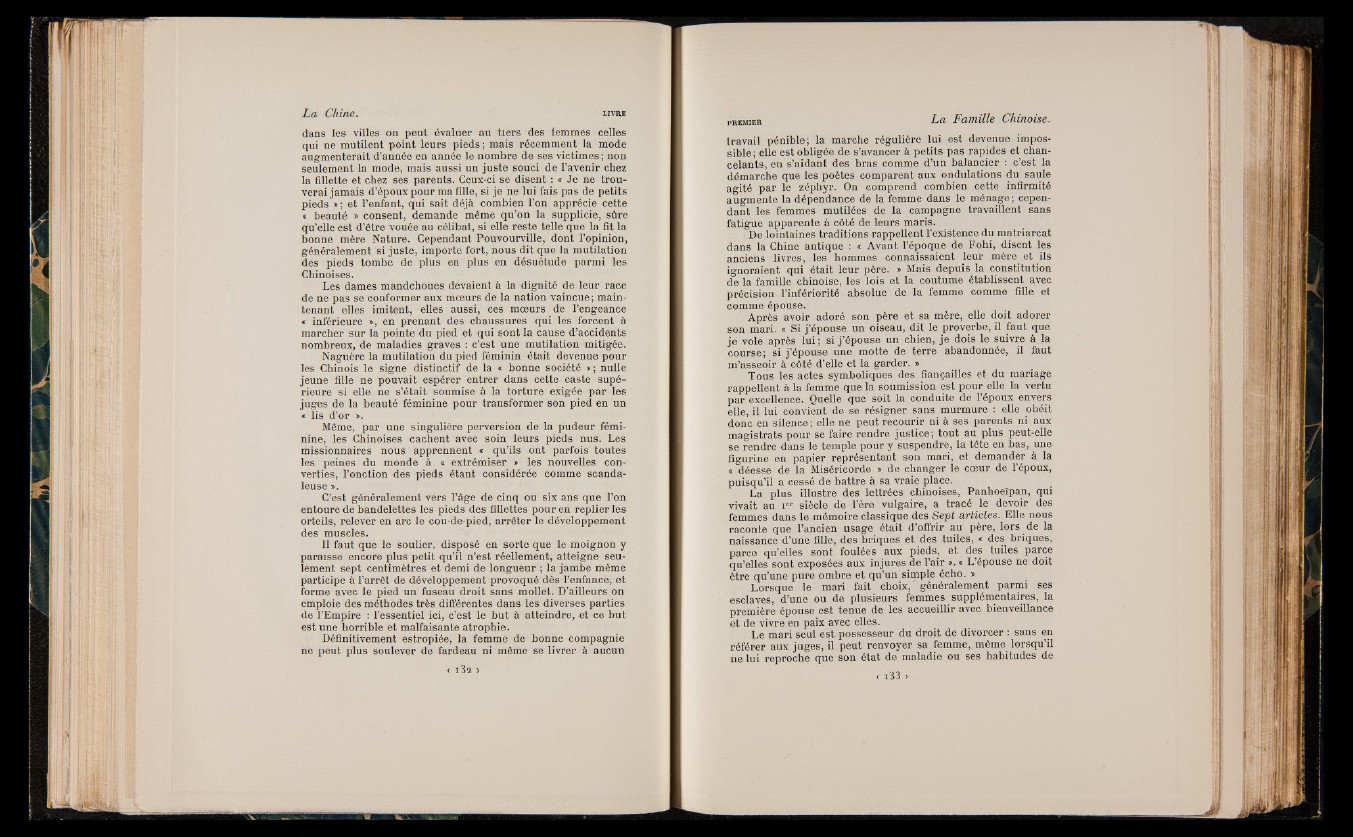
dans les villes on peut évaluer au tiers des femmes celles
qui ne mutilent point leurs pieds; mais récemment la mode
augmenterait d’année en année le nombre de ses victimes; non
seulement la mode, mais aussi un juste souci de l’avenir chez
la fillette et chez ses parents. Ceux-ci se disent : « Je ne trouverai
jamais d’époux pour ma fille, si je ne lui fais pas de petits
pieds » ; et l’enfant, qui sait déjà combien l’on apprécie cette
« beauté » consent, demande même qu’on la supplicie, sûre
qu’elle est d’être vouée au célibat, si elle reste telle que la fit la
bonne mère Nature. Cependant Pouvourville, dont l’opinion,
généralement si juste, importe fort, nous dit que la mutilation
des pieds tombe de plus en plus en désuétude parmi les
Chinoises.
Les dames mandchoues devaient à la dignité de leur race
de ne pas se conformer aux moeurs de la nation vaincue ; maintenant
elles imitent, elles aussi, ces moeurs de l’engeance
« inférieure », en prenant des chaussures qui les forcent à
marcher sur la pointe du pied et qui sont la cause d’accidents
nombreux, de maladies graves : c’est une mutilation mitigée.
Naguère la mutilation du pied féminin était devenue pour
les Chinois le signe distinctif de la « bonne société » ; nulle
jeune fille ne pouvait espérer entrer dans cette caste supérieure
si elle ne s’était soumise à la torture exigée par les
juges de la beauté féminine pour transformer son pied en un
« lis d’or ».
Même, par une singulière perversion de la pudeur féminine,
les Chinoises cachent avec soin leurs pieds nus. Les
missionnaires nous apprennent « qu’ils ont parfois toutes
les peines du monde à * extrémiser » les nouvelles converties,
Ponction des pieds étant considérée comme scandaleuse
».
C’est généralement vers l’âge de cinq ou six ans que l’on
entoure de bandelettes les pieds des fillettes pour en replier les
orteils, relever en arc le cou-de-pied, arrêter le développement
des muscles.
Il faut que le soulier, disposé en sorte que le moignon y
paraisse encore plus petit qu’il n’est réellement, atteigne seulement
sept centimètres et demi de longueur ; la jambe même
participe à l’arrêt de développement provoqué dès l’enfance, et
forme avec le pied un fuseau droit sans mollet. D’ailleurs on
emploie des méthodes très différentes dans les diverses parties
de l’Empire : l’essentiel ici, c’est le but à atteindre, et ce but
est une horrible et malfaisante atrophie.
Définitivement estropiée, la femme de bonne compagnie
ne peut plus soulever de fardeau ni même se livrer à aucun
travail pénible; la marche régulière lui est devenue impossible
; elle est obligée de s’avancer à petits pas rapides et chancelants,
en s’aidant des bras comme d’un balancier : c’est la
démarche que les poètes comparent aux ondulations du saule
agité par le zéphyr. On comprend combien cette infirmité
augmente la dépendance de la femme dans le ménage ; cependant
les femmes mutilées de la campagne travaillent sans
fatigue apparente à côté de leurs maris.
De lointaines traditions rappellent l’existence du matriarcat
dans la Chine antique : « Avant l’époque de Fohi, disent les
anciens livres, les hommes connaissaient leur mère et ils
ignoraient qui était leur père. » Mais depuis la constitution
de la famille chinoise, les lois et la coutume établissent avec
précision l’infériorité absolue de la femme comme fille et
comme épouse.
Après avoir adoré son père et sa mère, elle doit adorer
son mari. « Si j ’épouse un oiseau, dit le proverbe, il faut que
je vole après lui; si j ’épouse un chien, je dois le suivre à la
course; si j ’épouse une motte de terre abandonnée, il faut
m’asseoir à côté d’elle et la garder. »
Tous les actes symboliques des fiançailles et du mariage
rappellent à la femme que la soumission est pour elle la vertu
par excellence. Quelle que soit la conduite de l’époux envers
elle, il lui convient de se résigner sans murmure : elle obéit
donc en silence ; elle ne peut recourir ni à ses parents ni aux
magistrats pour se faire rendre justice; tout au plus peut-elle
se rendre dans le temple pour y suspendre, la tête en bas, une
figurine en papier représentant son mari, et demander à la
« déesse de la Miséricorde » de changer le coeur de l’époux,
puisqu’il a cessé de battre à sa vraie place.
La plus illustre des lettrées chinoises, Panhoeïpan, qui
vivait au I e r siècle de l’ère vulgaire, a tracé le devoir des
femmes dans le mémoire classique des Sept articles. Elle nous
raconte que l’ancien usage était d’offrir au père, lors de la
naissance d’une fille, des briques et des tuiles, « des briques,
parce qu’elles sont foulées aux pieds, et des tuiles parce
qu’elles sont exposées aux injures de l’air ». « L’épouse ne doit
être qu’une pure ombre et qu’un simple écho. »
Lorsque le mari fait choix, généralement parmi ses
esclaves, d’une ou de plusieurs femmes supplémentaires, la
première épouse est tenue de les accueillir avec bienveillance
et de vivre en paix avec elles.
Le mari seul est possesseur du droit de divorcer : sans en
référer aux juges, il peut renvoyer sa femme, même lorsqu’il
ne lui reproche que son état de maladie ou ses habitudes de