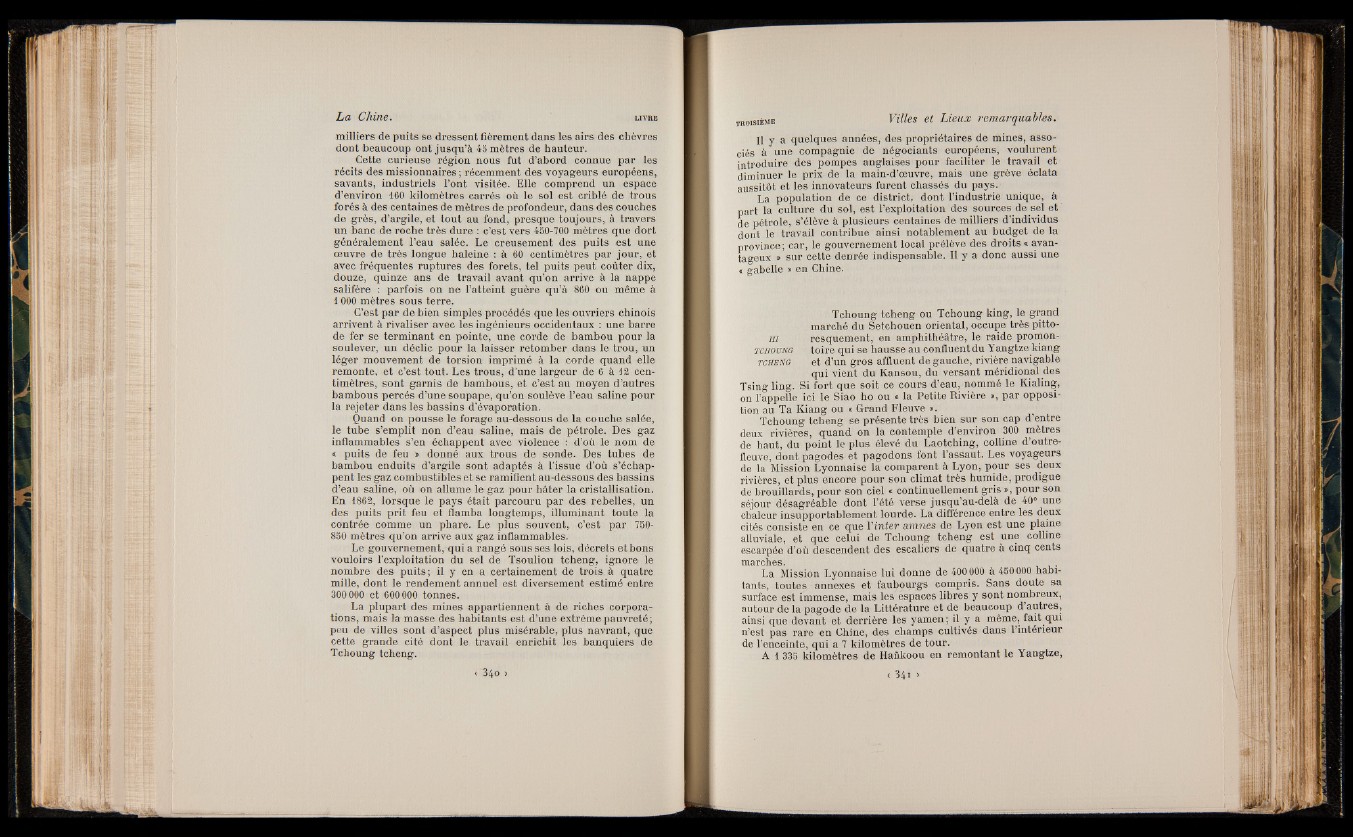
milliers de puits se dressent fièrement dans les airs des chèvres
dont beaucoup ont jusqu’à 45 mètres de hauteur.
Cette curieuse région nous fut d’abord connue par les
récits des missionnaires; récemment des voyageurs européens,
savants, industriels l’ont visitée. Elle comprend un espace
d’environ 160 kilomètres carrés où le sol est criblé de trous
forés à des centaines de mètres de profondeur, dans des couches
de grès, d’argile, et tout au fond, presque toujours, à travers
un banc de roche très dure : c’est vers 450-700 mètres que dort
généralement l’eau salée. Le creusement des puits est une
oeuvre de très longue haleine : à 60 centimètres par jour, et
avec fréquentes ruptures des forets, tel puits peut coûter dix,
douze, quinze ans de travail avant qu’on arrive à la nappe
salifère : parfois on ne l’atteint guère qu’à 860 ou même à
1000 mètres sous terre.
C’est par de bien simples procédés que les ouvriers chinois
arrivent à rivaliser avec les ingénieurs occidentaux : une barre
de fer se terminant en pointe, une corde de bambou pour la
soulever, un déclic pour la laisser retomber dans le trou, un
léger mouvement de torsion imprimé à la corde quand elle
remonte, et c’est tout. Les trous, d’une largeur de 6 à 12 centimètres,
sont garnis de bambous, et c’est au moyen d’autres
bambous percés d’une soupape, qu’on soulève l’eau saline pour
la rejeter dans les bassins d’évaporation.
Quand on pousse le forage au-dessous de la couche salée,
le tube s’emplit non d’eau saline, mais de pétrole. Des gaz
inflammables s’en échappent avec violenee : d’où le nom de
» puits de feu » donné aux trous de sonde. Des tubes de
bambou enduits d’argile sont adaptés à l’issue d’où s’échappent
les gaz combustibles et se ramifient au-dessous des bassins
d’eau saline, où on allume le gaz pour hâter la cristallisation.
En 1862, lorsque le pays était parcouru par des rebelles, un
des puits prit feu et flamba longtemps, illuminant toute la
contrée comme un phare. Le plus souvent, c’est par 750-
850 mètres qu’on arrive aux gaz inflammables.
Le gouvernement, qui a rangé sous ses lois, décrets et bons
vouloirs l’exploitation du sel de Tsouliou tcheng, ignore le
nombre des puits; il y en a certainement de trois à quatre
mille, dont le rendement annuel est diversement estimé entre
300000 et 600000 tonnes.
La plupart des mines appartiennent à de riches corporations,
mais la masse des habitants est d’une extrême pauvreté ;
peu de villes sont d’aspect plus misérable, plus navrant, que
cette grande cité dont le travail enrichit les banquiers de
Tchoung tcheng.
Il y a quelques années, des propriétaires de mines, associés
à une compagnie de négociants européens, voulurent
introduire des pompes anglaises pour faciliter le travail et
diminuer le prix de la main-d’oeuvre, mais une grève éclata
aussitôt et les innovateurs furent chassés du pays.
La population de ce district, dont l’industrie unique, à
part la culture du sol, est l’exploitation des sources de sel et
de pétrole, s’élève à plusieurs centaines de milliers d’individus
dont le travail contribue ainsi notablement au budget de la
province; car, le gouvernement local prélève des droits « avantageux
» sur cette denrée indispensable. Il y a donc aussi une
« gabelle » en Chine.
Tchoung tcheng ou Tchoung king, le grand
marché du Setchouen oriental, occupe très pitto-
ui resquement, en amphithéâtre, le raide promontchoung
toire qui se hausse au confluentdu Yangtze kiang
tch eng et d’un gros affluent de gauche, rivière navigable
qui vient du Kansou, du versant méridional des
Tsing ling. Si fort que soit ce cours d’eau, nommé le Kialing,
on l’appelle ici le Siao ho ou « la Petite Rivière », par opposition
au Ta Kiang ou » Grand Fleuve ».
Tchoung tcheng se présente très bien sur son cap d’entre
deux rivières, quand on la contemple d’environ 300 mètres
de haut, du point le plus élevé du Laotehing, colline d’outre-
fleuve, dont pagodes et pagodons font l’assaut. Les voyageurs
de la Mission Lyonnaise la comparent à Lyon, pour ses deux
rivières, et plus encore pour son climat très humide, prodigue
de brouillards, pour son ciel « continuellement gris », pour son
séjour désagréable dont l’été verse jusqu’au-delà de 40° une
chaleur insupportablement lourde. La différence entre les deux
cités consiste en ce que Vinter amnes de Lyon est une plaine
alluviale, et que celui de Tchoung tcheng est une colline
escarpée d’où descendent des escaliers de quatre à cinq cents
marches. .
La Mission Lyonnaise lui donne de 400000 à 450000 habitants,
toutes annexes et faubourgs compris. Sans doute sa
surface est immense, mais les espaces libres y sont nombreux,
autour de la pagode de la Littérature et de beaucoup d’autres,
ainsi que devant et derrière les yamen; il y a même, fait qui
n’est pas rare en Chine, des champs cultivés dans l’intérieur
de l’enceinte, qui a 7 kilomètres de tour.
A 1 335 kilomètres de Hankoou en remontant le Yangtze,