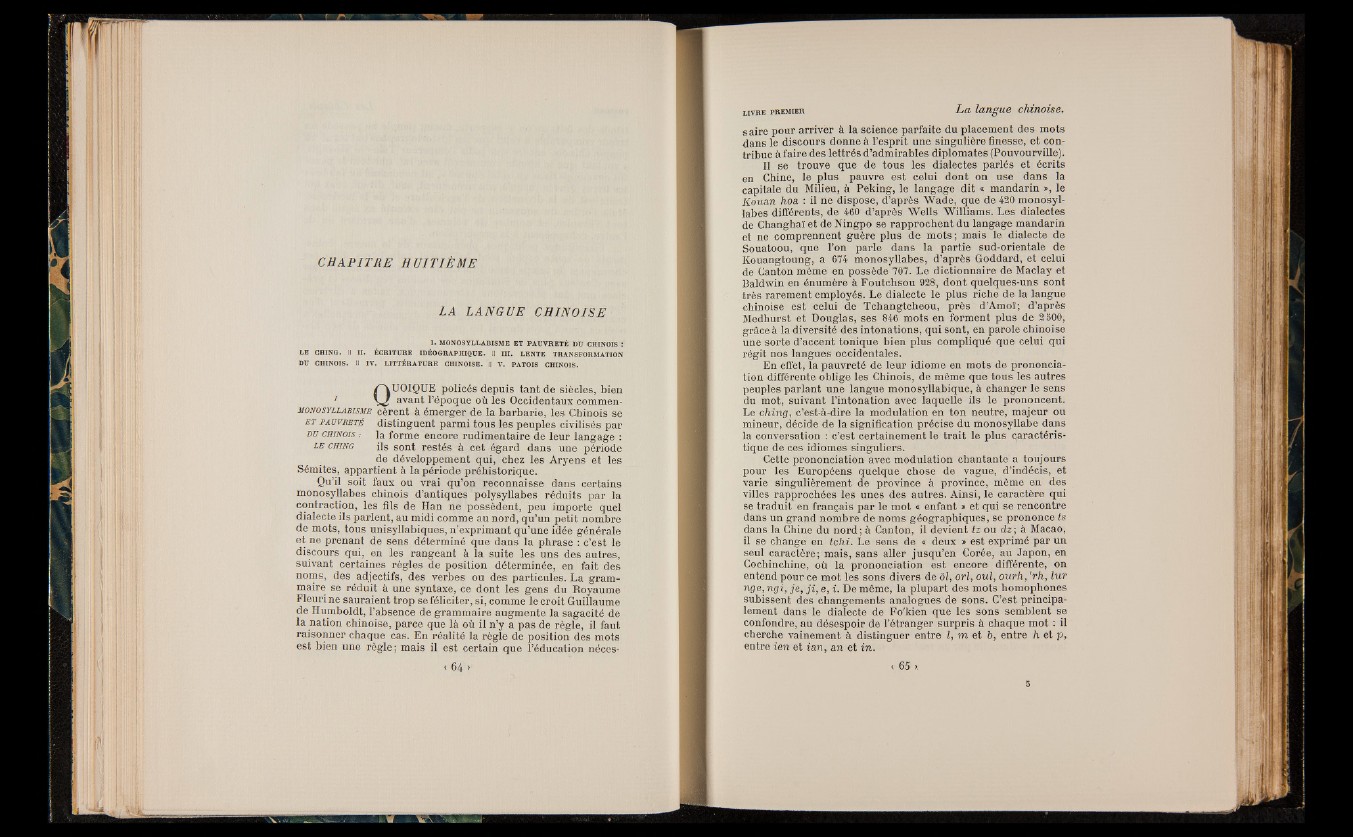
■
C H A P I T R E H U I T I ÈM E
L A L A N G U E CHI NO I S E
I . MONOSYLLABISME ET PAUVRETÉ DU CHINOIS :
LE CHING. Il II. ÉCRITURE IDÉOGRAPHIQUE. Il III. LENTE TRANSFORMATION
DU CHINOIS. Il IV. LITTÉRATURE CHINOISE. Il V. PATOIS CHINOIS.
QUOIQUE policés depuis tant de siècles, bien
avant l’époque où les Occidentaux commen-
m o n o s y lla b ism e cèrent à émerger de la barbarie, les Chinois se
e t p a u v r e t é distinguent parmi tous les peuples civilisés par
d u c h in o is : la forme encore rudimentaire de leur langage :
l e ching ils sont restés à cet égard dans une période
de développement qui, chez les Aryens et les
Sémites, appartient à la période préhistorique.
Qu’il soit faux ou vrai qu’on reconnaisse dans certains
monosyllabes chinois d’antiques polysyllabes réduits par la
contraction, les fils de Han ne possèdent, peu importe quel
dialecte ils parlent, au midi comme au nord, qu’un petit nombre
de mots, tous unisyllabiques, n’exprimant qu’une idée générale
et ne prenant de sens déterminé que dans la phrase : c’est le
discours qui, en les rangeant à la suite les uns des autres,
suivant certaines règles de position déterminée, en fait des
noms, des adjectifs, des verbes ou des particules. La grammaire
se réduit à une syntaxe, ce dont les gens du Royaume
Fleuri ne sauraient trop se féliciter, si, comme le croit Guillaume
de Humboldt, l’absence de grammaire augmente la sagacité de
la nation chinoise, parce que là où il n’y a pas de règle, il faut
raisonner chaque cas. En réalité la règle de position des mots
est bien une règle; mais il est certain que l’éducation nécess
aire pour arriver à la science parfaite du placement des mots
dans le discours donne à l’esprit une singulière finesse, et contribue
à faire des lettrés d’admirables diplomates (Pouvourville).
II se trouve que de tous les dialectes parlés et écrits
en Chine, le plus pauvre est celui dont on use dans la
capitale du Milieu, à Peking, le langage dit « mandarin », le
Kouan hoa : il ne dispose, d’après Wade, que de 420 monosyllabes
différents, de 460 d’après Wells Williams. Les dialectes
de Changhaï et de Ningpo se rapprochent du langage mandarin
et ne comprennent guère plus de mots; mais le dialecte de
Souatoou, que l’on parle dans la partie sud-orientale de
Kouangtoung, a 674 monosyllabes, d’après Goddard, et celui
de Canton même en possède 707. Le dictionnaire de Maclay et
Baldwin en énumère à Foutchsou 928, dont quelques-uns sont
très rarement employés. Le dialecte le plus riche de la langue
chinoise est celui de Tchangtcheou, près d’Amoï; d’après
Medhurst et Douglas, ses 846 mots en forment plus de 2500,
grâce à la diversité des intonations, qui sont, en parole chinoise
une sorte d’accent tonique bien plus compliqué que celui qui
régit nos langues occidentales.
En effet, la pauvreté de leur idiome en mots de prononciation
différente oblige les Chinois, de même que tous les autres
peuples parlant une langue monosyllabique, à changer le sens
du mot, suivant l’intonation avec laquelle ils le prononcent.
Le ching, c’est-à-dire la modulation en ton neutre, majeur ou
mineur, décide de la signification précise du monosyllabe dans
la conversation : c’est certainement le tra it le plus caractéristique
de ces idiomes singuliers.
Cette prononciation avec modulation chantante a toujours
pour les Européens quelque chose de vague, d’indécis, et
varie singulièrement de province à province, même en des
villes rapprochées les unes des autres. Ainsi, le caractère qui
se traduit en français par le mot 1 enfant » et qui se rencontre
dans un grand nombre de noms géographiques, se prononce ts
dans la Chine du nord; à Canton, il devient tz ou dz; à Macao,
il se change en tchi. Le sens de « deux » ëst exprimé par un
seul caractère; mais, sans aller jusqu’en Corée, au Japon, en
Cochinchine, où la prononciation est encore différente, on
entend pour ce mot les sons divers de 01, orl, oui, ourh, 'rh, lur
nge, ngi, e, i. De même, la plupart des mots homophones
subissent des changements analogues de sons. C’est principalement
dans le dialecte de Fo'kien que les sons semblent se
confondre, au désespoir de l’étranger surpris à chaque mot : il
cherche vainement ù distinguer entre i, m et b, entre h et p,
entre ien et ian, an et in.