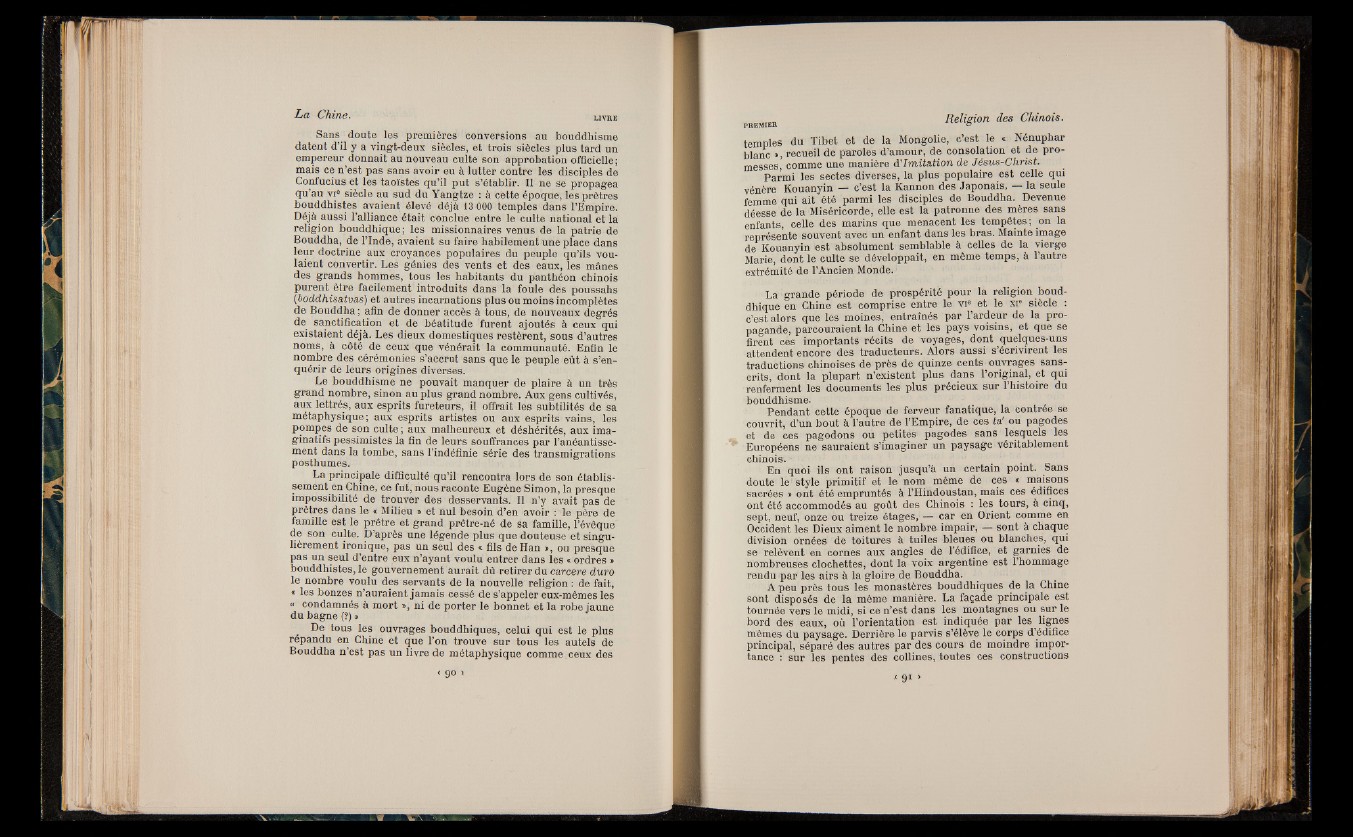
Sans doute les premières conversions au bouddhisme
datent d’il y a vingt-deux siècles, et trois siècles plus tard un
empereur donnait au nouveau culte son approbation officielle;
mais ce n ’est pas sans avoir eu à lutter contre les disciples de
Confucius et les taoïstes qu’il put s’établir. Il ne se propagea
qu’au vie siècle au sud du Yangtze : à cette époque, les prêtres
bouddhistes avaient élevé déjà 13 000 temples dans l’Empire.
Déjà aussi l’alliance était conclue entre le culte national et la
religion bouddhique; les missionnaires venus de la patrie de
Bouddha, de l’Inde, avaient su faire habilement une place dans
leur doctrine aux croyances populaires du peuple qu’ils voulaient
convertir. Les génies des vents et des eaux, les mânes
des grands hommes, tous les habitants du panthéon chinois
purent être facilement introduits dans la foule des poussahs
(boddhisatvas) et autres incarnations plus ou moins incomplètes
de Bouddha ; afin de donner accès à tous, de nouveaux degrés
de sanctification et de béatitude furent ajoutés à ceux qui
existaient déjà. Les dieux domestiques restèrent, sous d’autres
noms, à côté de ceux que vénérait la communauté. Enfin le
nombre des cérémonies s’accrut sans que le peuple eût à s’enquérir
de leurs origines diverses.
Le bouddhisme ne pouvait manquer de plaire à un très
grand nombre, sinon au plus grand nombre. Aux gens cultivés,
aux lettrés, aux esprits fureteurs, il offrait les subtilités de sa
métaphysique; aux esprits artistes ou aux esprits vains, les
pompes de son culte ; aux malheureux et déshérités, aux imaginatifs
pessimistes la fin de leurs souffrances par l’anéantissement
dans la tombe, sans l’indéfinie série des transmigrations
posthumes.
La principale difficulté qu’il rencontra lors de son établissement
en Chine, ce fut, nous raconte Eugène Simon, la presque
impossibilité de trouver des desservants. Il n’y avait pas de
prêtres dans le « Milieu » et nul besoin d’en avoir : le père de
famille est le prêtre et grand prêtre-né de sa famille, l’évêque'
de son culte. D’après une légende plus que douteuse et singulièrement
ironique, pas un seul des « fils deHan », ou presque
pas un seul d’entre eux n’ayant voulu entrer dans les * ordres »
bouddhistes, le gouvernement aurait dû retirer du carcere duro
le nombre voulu des servants de la nouvelle religion : de fait,
« les bonzes n’auraient jamais cessé de s’appeler eux-mèmes les
« condamnés à mort », ni de porter le bonnet et la robe jaune
du bagne (?) »
De tous les ouvrages bouddhiques, celui qui est le plus
répandu en Chine et que l’on trouve sur tous les autels de
Bouddha n ’est pas un livre de métaphysique comme ceux des
' 9° >
Religion des Chinois. PREMIER O
temples du Tibet et de la Mongolie, c’est le c Nénuphar
blanc », recueil de paroles d’amour, de consolation et de promesses,'
comme une manière A'Imitation de Jésus-Christ.
Parmi les sectes diverses, la plus populaire est celle qui
vénère Kouanyin — c’est la Kannon des Japonais, — la seule
femme qui ait été parmi les disciples de Bouddha. Devenue
déesse de la Miséricorde, elle est la patronne des mères sans
enfants, celle des marins que menacent les tempêtes; on la
représente souvent avec un enfant dans les bras. Mainte image
de Kouanyin est absolument semblable à celles de la vierge
Marie, dont le culte se développait, en même temps, à l’autre
extrémité de l’Ancien Monde. ■
La grande période de prospérité pour la religion bouddhique
en Chine est comprise entre le VIe et le xie siècle :
c’est alors que les moines, entraînés par l’ardeur de la propagande,
parcouraient la Chine et les pays voisins, et que se
firent ces importants récits de voyages, dont quelques-uns
attendent encore des traducteurs. Alors aussi' s écrivirent les
traductions chinoises de près de quinze cents ouvrages sanscrits,
dont la plupart n’existent plus dans l’original, et qui
renferment les documents les plus précieux sur l’histoire du
bouddhisme; ' * ;
Pendant cette époque de ferveur fanatique, la Contrée se
couvrit, d’un bout à l’autre de l’Empire, de ces ta’ ou pagodes
et de ces pagodons ou petites pagodes sans lesquels les
Européens ne sauraient s’imaginer un paysage véritablement
chinois.'' ' •"
En quoi ils ont raison jusqu’à un certain point. Sans
doute le' style primitif et le nom même de ces « maisons
sacrées » ont été empruntés à l’Hindoustan, mais ces édifices
ont été accommodés au goût des Chinois : les tours, à cinq,
sept, neuf, onze ou treize étages, -#•* car en Orient comme en
Occident les Dieux aiment le nombre impair, — sont à chaque
division ornées de toitures à tuiles bleues ou blanches, qui
se relèvent en cornes aux angles de l’édifice, et garnies de
nombreuses clochettes, dont la voix argentine est l’hommage
rendu par les airs à la gloire de Bouddha.
A peu près tous les monastères bouddhiques de la Chine
sont disposés de la même manière. La façade principale est
tournée vers le midi, si ce n’est dans les montagnes ou sur le
bord des eaux, où l’orientation est indiquée par les lignes
mêmes du paysage. Derrière le parvis s’élève le corps d’édifice
principal, séparé des autres par des cours de moindre importance
: sur les pentes des collines, toutes ces constructions
< 91 >