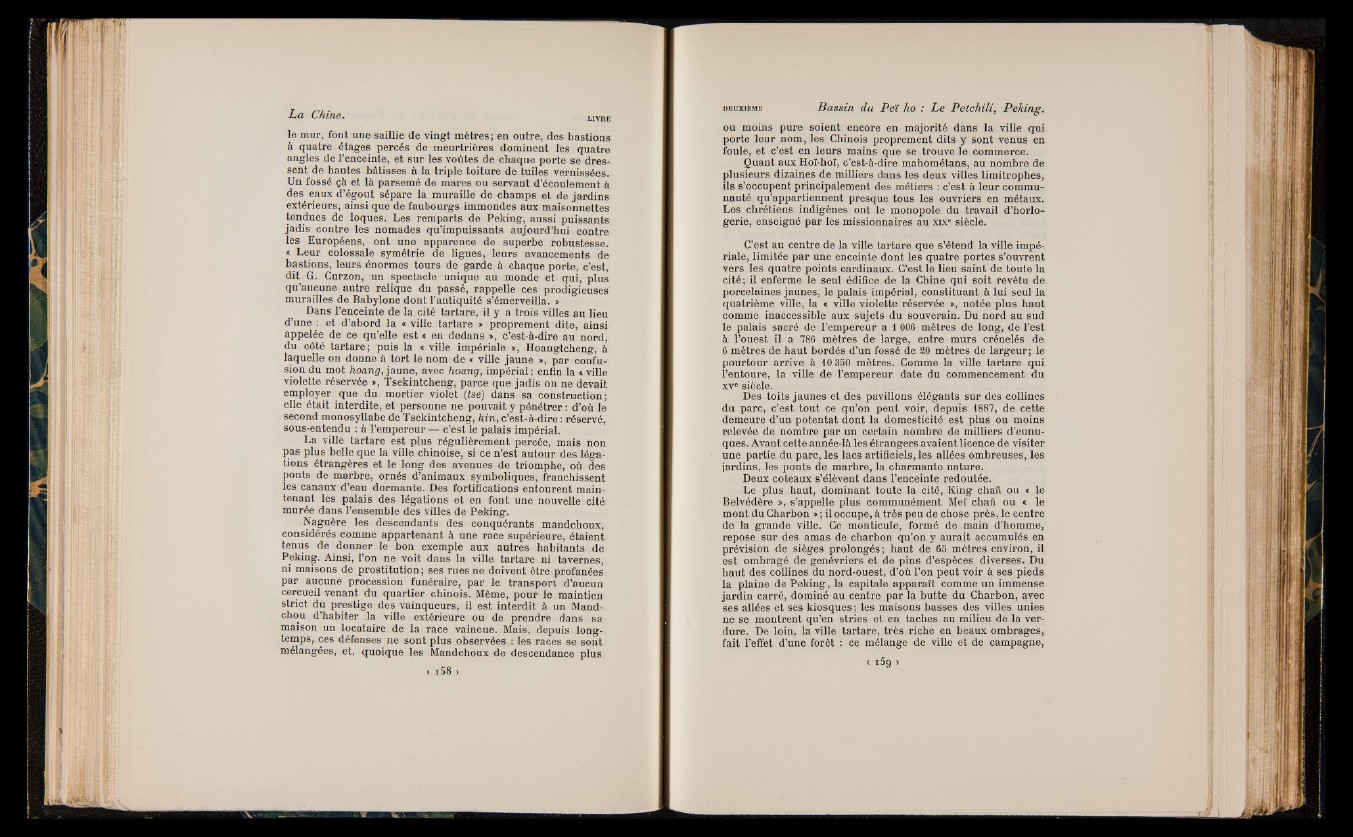
le mur, font une saillie de vingt mètres; en outre, des bastions
à quatre étages percés de meurtrières dominent les quatre
angles de l’enceinte, et sur les voûtes de chaque porte se dressent
de hautes bâtisses à la triple toiture de tuiles vernissées.
Un fossé çà et là parsemé de mares ou servant d’écoulement à
des eaux d’égout sépare la muraille de champs et de jardins
extérieurs, ainsi que de faubourgs immondes aux maisonnettes
tendues de loques. Les remparts de Peking, aussi puissants
jadis contre les nomades qu’impuissants aujourd’hui contre
les Européens, ont une apparence de superbe robustesse.
« Leur colossale symétrie de lignes, leurs avancements de
bastions, leurs énormes tours de garde à chaque porte, c’est,
dit G. Curzon, un spectacle unique au monde et qui, plus
qu’aucune autre relique du passé, rappelle ces prodigieuses
murailles de Babylone dont l’antiquité s’émerveilla. »
Dans l’enceinte de la cité tartare, il y a trois villes au lieu
d’une : et d’abord la » ville tartare » proprement dite, ainsi
appelée de ce qu’elle est « en dedans », c’est-à-dire au nord,
du côté tartare; puis la « ville impériale », Hoangtcheng, à
laquelle on donne à tort le nom de « ville jaune », par confusion
du mot hoang,jaune, avec hoang, impérial; enfin la »ville
violette réservée », Tsekintcheng, parce que jadis on ne devait
employer que du mortier violet (tse) dans sa construction;
elle était interdite, et personne ne pouvait y pénétrer : d’où le
second monosyllabe de Tsekintcheng, hin, c’est-à-dire : réservé,
sous-entendu : à l’empereur — c’est le palais impérial.
La ville tartare est plus régulièrement percée, mais non
pas plus belle que la ville chinoise, si ce n ’est autour des légations
étrangères et le long des avenues de triomphe, où des
ponts de marbre, ornés d’animaux symboliques, franchissent
les canaux d’eau dormante. Des fortifications entourent maintenant
les palais des légations et en font une nouvelle cité
murée dans l’ensemble des villes de Peking.
Naguère les descendants des conquérants mandchoux,
considérés comme appartenant à une race supérieure, étaient
tenus de donner le bon exemple aux autres habitants de
Peking. Ainsi, Ton ne voit dans la ville tartare ni tavernes,
ni maisons de prostitution ; ses rues ne doivent être profanées
par aucune procession funéraire, par le transport d’aucun
cercueil venant du quartier chinois. Même, pour le maintien
strict du prestige des vainqueurs, il est interdit à un Mandchou
d’habiter la ville extérieure ou de prendre dans sa
maison un locataire de la race vaincue. Mais, depuis longtemps,
ces défenses ne sont plus observées : les races se sont
mélangées, et, quoique les Mandchoux de descendance plus
ou moins pure soient encore en majorité dans la ville qui
porte leur nom, les Chinois proprement dits y sont venus en
foule, et c’est en leurs mains que se trouve le commerce.
Quant aux Hoï-hoï, c’est-à-dire mahométans, au nombre de
plusieurs dizaines de milliers dans les deux villes limitrophes,
ils s’occupent principalement des métiers : c’est à leur communauté
qu’appartiennent presque tous les ouvriers en métaux.
Les chrétiens indigènes ont le monopole du travail d’horlogerie,
enseigné par les missionnaires au xix° siècle.
C’est au centre de la ville tartare que s’étend la ville impériale,
limitée par une enceinte dont les quatre portes s’ouvrent
vers les quatre points cardinaux. C’est le lieu saint de toute la
cité; il enferme le seul édifice de la Chine qui soit revêtu de
porcelaines jaunes, le palais impérial, constituant à lui seul la
quatrième ville, la « ville violette réservée », notée plus haut
comme inaccessible aux sujets du souverain. Du nord au sud
le palais sacré de l’empereur a 1 006 mètres de long, de Test
à l’ouest il a 786 mètres de large, entre murs crénelés de
6 mètres de haut bordés d’un fossé de 20 mètres de largeur ; le
pourtour arrive à 10 350 mètres. Comme la ville tartare qui
l’entoure, la ville de l’empereur date du commencement du
XVe siècle.
Des toits jaunes et des pavillons élégants sur des collines
du parc, c’est tout ce qu’on peut voir, depuis 1887, de cette
demeure d’un potentat dont la domesticité est plus ou moins
relevée de nombre par un certain nombre de milliers d’eunuques.
Avant cette année-là les étrangers avaient licence dé visiter
une partie du parc, les lacs artificiels, les allées ombreuses, les
jardins, les ponts de marbre, la charmante nature.
Deux coteaux s’élèvent dans l’enceinte redoutée.
Le plus haut, dominant toute la cité, King chan ou « le
Belvédère », s’appelle plus communément Meï chan ou » le
mont du Charbon » ; il occupe, à très peu de chose près, le centre
de la grande ville. Ce monticule, formé de main d’homme,
repose sur des amas de charbon qu’on y aurait accumulés en
prévision de sièges prolongés; haut de 65 mètres environ, il
est ombragé de genévriers et de pins d’espèces diverses. Du
haut des collines du nord-ouest, d’où Ton peut voir à ses pieds
la plaine de Peking, la capitale apparaît comme un immense
jardin carré, dominé au centre par la butte du Charbon, avec
ses allées et ses kiosques; les maisons basses des villes unies
ne se montrent qu’en stries et en taches au milieu de la verdure.
De loin, la ville tartare, très riche en beaux ombrages,
fait l’effet d’une forêt : ce mélange de ville et de campagne,