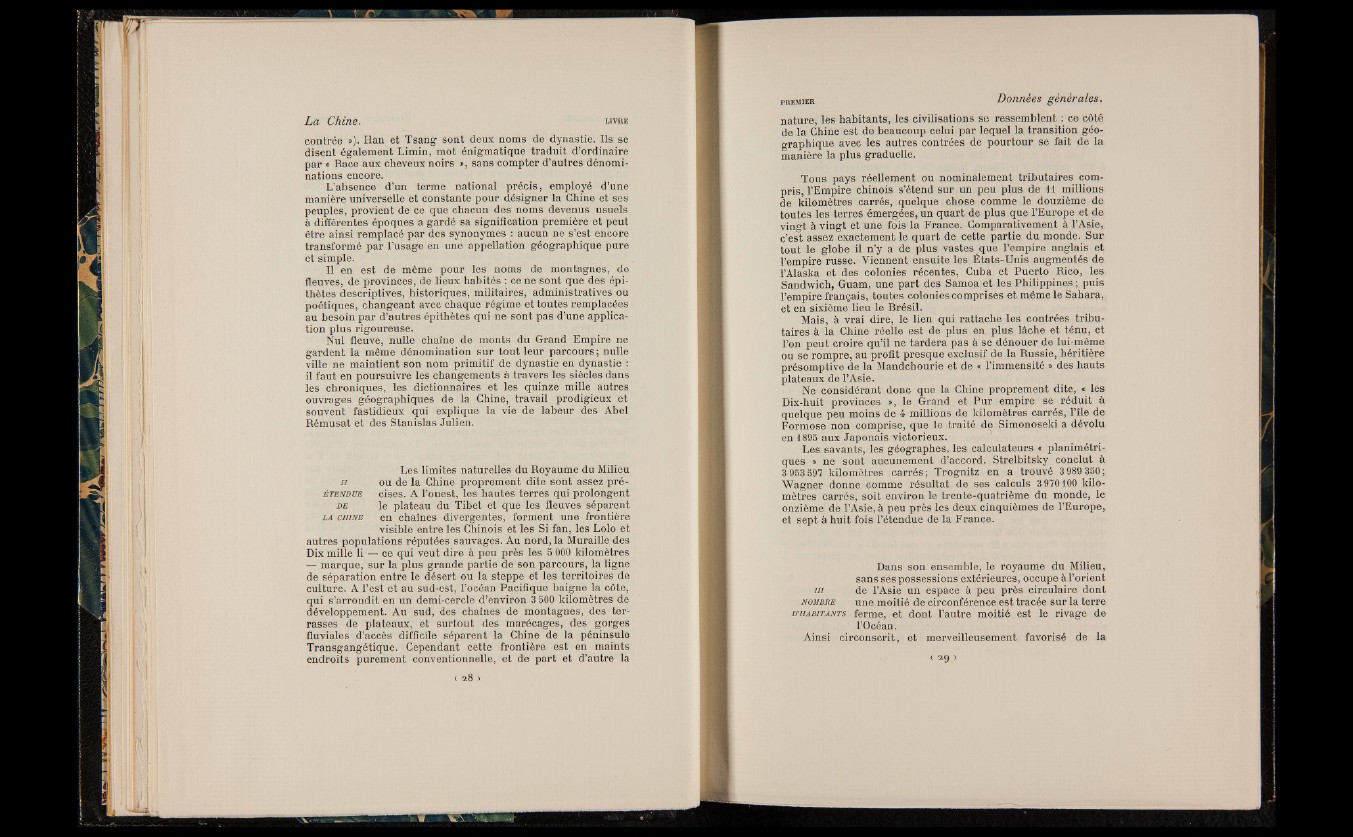
contrée »)• Han et Tsang sont deux noms de dynastie. Ils se
disent également Limin, mot énigmatique traduit d’ordinaire
par « Race aux cheveux noirs », sans compter d’autres dénominations
encore.
L’absence d’un terme national précis, employé d’une
manière universelle et constante pour désigner la Chine et ses
peuples, provient de ce que chacun des noms devenus usuels
à différentes époques a gardé sa signification première et peut
être ainsi remplacé par des synonymes : aucun ne s’est encore
transformé par l’usage en une appellation géographique pure
et simple.
Il en est de même pour les noms de montagnes, de
fleuves, de provinces, de lieux habités : ce ne sont que des épi-
thètes descriptives, historiques, militaires, administratives ou
poétiques, changeant avec chaque régime et toutes remplacées
au besoin par d’autres épithètes qui ne sont pas d’une application
plus rigoureuse.
Nul fleuve, nulle chaîne de monts du Grand Empire ne
gardent la même dénomination sur tout leur parcours; nulle
ville ne maintient son nom primitif de dynastie en dynastie :
il faut en poursuivre les changements à travers les siècles dans
les chroniques, les dictionnaires et les quinze mille autres
ouvrages géographiques de la Chine, travail prodigieux et
souvent fastidieux qui explique la vie de labeur des Abel
Rémusat et des Stanislas Julien.
Les limites naturelles du Royaume du Milieu
il ou de la Chine proprement dite sont assez préé
t e n d ü e cises. A l’ouest, les hautes terres qui prolongent
d e le plateau du Tibet et que les fleuves séparent
l a c h in e en chaînes divergentes, forment une frontière
visible entre les Chinois et les Si fan, les Lolo et
autres populations réputées sauvages. Au nord, la Muraille des
Dix mille li — ce qui veut dire à peu près les 5 000 kilomètres
*4 marque, sur la plus grande partie de son parcours, la ligne
de séparation entre le désert ou la steppe et les territoires de
culture. A l’est et au sud-est, l’océan Pacifique baigne la côte,
qui s’arrondit en un demi-cercle d’environ 3 500 kilomètres de
développement. Au sud, des chaînes de montagnes, des te rrasses
de plateaux, et surtout des marécages, des gorges
fluviales d’accès difficile séparent la Chine de la péninsule
Transgangétique. Cependant cette frontière est en maints
endroits purement conventionnelle, et de part et d’autre la
nature, les habitants, les civilisations se ressemblent : ce côté
de la Chine est de beaucoup celui par lequel la transition géographique
avec les autres contrées de pourtour se fait de la
manière la plus graduelle.
Tous pays réellement ou nominalement tributaires compris,
l’Empire chinois s’étend sur un peu plus de 11 millions
de kilomètres carrés, quelque chose comme le douzième de
toutes les terres émergées, un quart de plus que l’Europe et de
vingt à vingt et une fois la France. Comparativement à l’Asie,
c’est assez exactement le quart de cette partie du monde. Sur
tout le globe il n’y a de plus vastes que l’empire anglais et
l’empire russe. Viennent ensuite les États-Unis augmentés de
l’Alaska et des colonies récentes, Cuba et Puerto Rico, les
Sandwich, Guam, une part des Samoa et les Philippines ; puis
l’empire français, toutes colonies comprises et même le Sahara,
et en sixième lieu le Brésil.
Mais, à vrai dire, le lien qui rattache les contrées tributaires
à la Chine réelle est de plus en plus lâche et ténu, et
l’on peut croire qu’il ne tardera pas à se dénouer de lui-mème
ou se rompre, au profit presque exclusif de la Russie, héritière
présomptive de la Mandchourie et de « l’immensité » des hauts
plateaux de l’Asie.
Ne considérant donc que la Chine proprement dite, « les
Dix-huit provinces », le Grand et Pur empire se réduit à
quelque peu moins de 4 millions de kilomètres carrés, l’île de
Formose non comprise, que le traité de Simonoseki a dévolu
en 1895 aux Japonais victorieux.
Les savants, les géographes, les calculateurs » planimétri-
ques » ne sont aucunement d’accord. Strelbitsky conclut à
3 953 597 kilomètres carrés; Trognitz en a trouvé 3 989 350;
Wagner donne comme résultat de ses calculs 3970100 kilomètres
carrés, soit environ le trente-quatrième du monde, le
onzième de l’Asie, à peu près les deux cinquièmes de l’Europe,
et sept à huit fois l’étendue de la France.
Dans son ensemble, le royaume du Milieu,
sans ses possessions extérieures, occupe à l’orient
ni de l’Asie un espace à peu près circulaire dont
nom b r e une moitié de circonférence est tracée sur la terre
d'h a b it a n t s ferme, et dont l’autre moitié est le rivage de
l’Océan.
Ainsi circonscrit, et merveilleusement favorisé de la