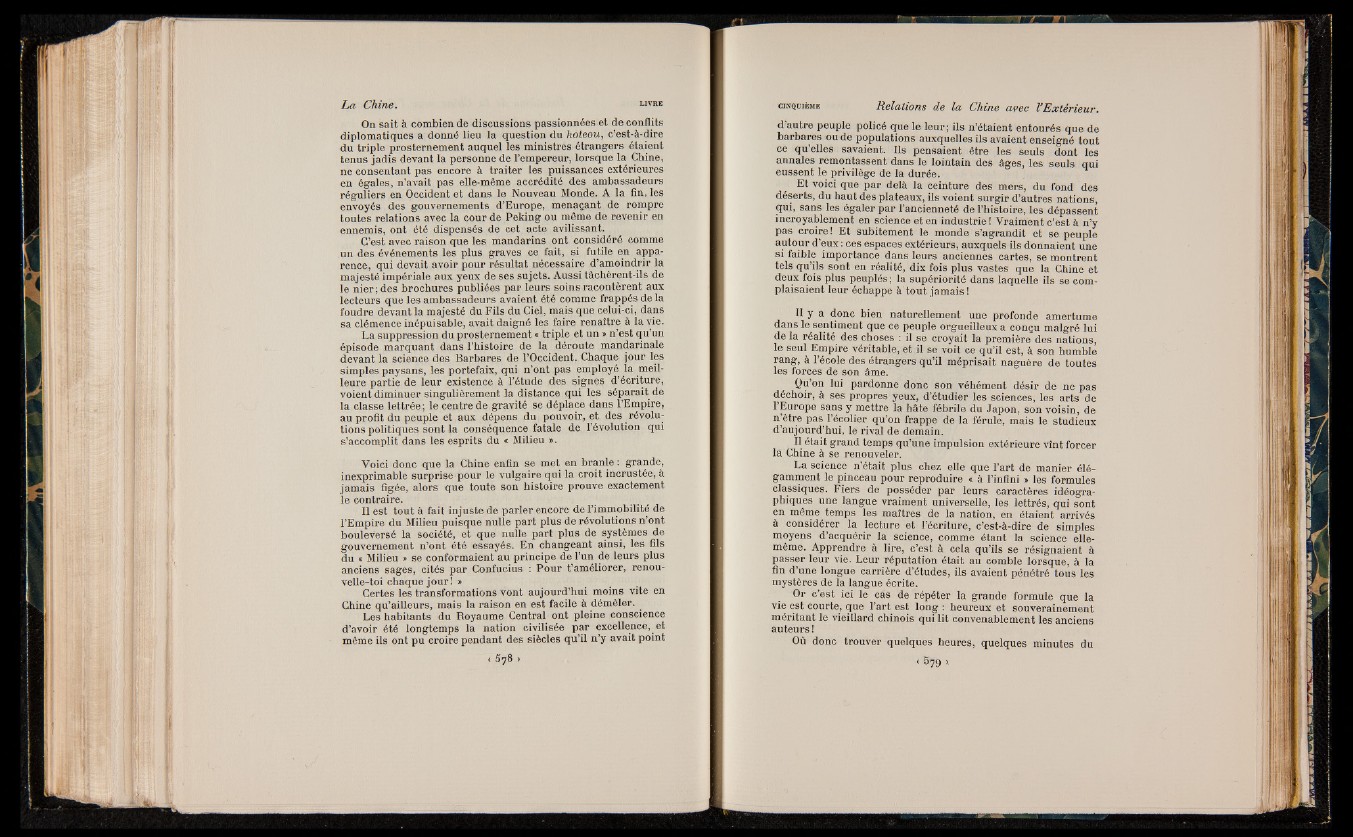
On sait à combien de discussions passionnées et de conflits
diplomatiques a donné lieu la question du hoteou, c’est-à-dire
du triple prosternement auquel les ministres étrangers étaient
tenus jadis devant la personne de l’empereur, lorsque la Chine,
ne consentant pas encore à traiter les puissances extérieures
en égales, n’avait pas elle-même accrédité des ambassadeurs
réguliers en Occident et dans le Nouveau Monde. A la fin, les
envoyés des gouvernements d’Europe, menaçant de rompre
toutes relations avec la cour de Peking ou même de revenir en
ennemis, ont été dispensés de cet acte avilissant.
C’est avec raison que les mandarins ont considéré comme
un des événements les plus graves ce fait, si futile en apparence,
qui devait avoir pour résultat nécessaire d’amoindrir la
majesté impériale aux yeux de ses sujets. Aussi tâchèrent-ils de
le nier; des brochures publiées par leurs soins racontèrent aux
lecteurs que les ambassadeurs avaient été comme frappés de la
foudre devant la majesté du Fils du Ciel, mais que celui-ci, dans
sa clémence inépuisable, avait daigné les faire renaître à la vie.
La suppression du prosternement « triple et un » n’est qu’un
épisode marquant dans l’histoire de la déroute mandarinale
devant la science des Barbares de l’Occident. Chaque jour les
simples paysans, les portefaix, qui n’ont pas employé la meilleure
partie de leur existence à l’étude des signes d’écriture,
voient diminuer singulièrement la distance qui les séparait de
la classe lettrée; le centre de gravité se déplace dans l’Empire,
au profit du peuple et aux dépens du pouvoir, et des révolutions
politiques sont la conséquence fatale de l’évolution qui
s’accomplit dans les esprits du * Milieu ».
Voici donc que la Chine enfin se met en branle : grande,
inexprimable surprise pour le vulgaire qui la croit incrustée, à
jamais figée, alors que toute son histoire prouve exactement
le contraire.
Il est tout à fait injuste de parler encore de l’immobilité de
l’Empire du Milieu puisque nulle part plus de révolutions n’ont
bouleversé la société, et que nulle part plus de systèmes de
gouvernement n’ont été essayés. En changeant ainsi, les fils
du « Milieu » se conformaient au principe de l’un de leurs plus
anciens sages, cités par Confucius : Pour t’améliorer, renou-
velle-toi chaque jo u rî »
Certes les transformations vont aujourd’hui moins vite en
Chine qu’ailleurs, mais la raison en est facile à démêler.
Les habitants du Royaume Central ont pleine conscience
d’avoir été longtemps la nation civilisée par excellence, et
même ils ont pu croire pendant des siècles qu’il n’y avait point
< 578 >
d autre peuple policé que le leur ; ils n’étaient entourés que de
barbares ou de populations auxquelles ils avaient enseigné tout
ce qu elles savaient. Ils pensaient être les seuls dont les
annales remontassent dans le lointain des âges, les seuls qui
eussent le privilège de la durée.
Et voici que par delà la ceinture des mers, du fond des
déserts, du haut des plateaux, ils voient surgir d’autres nations,
qui, sans les égaler par l’ancienneté de l’histoire, les dépassent
incroyablement en science et en industrie! Vraiment c’est à n’y
pas croire ! Et subitement le monde s’agrandit et se peuple
autour d’eux : ces espaces extérieurs, auxquels ils donnaient une
si faible importance dans leurs anciennes cartes, se montrent
tels qu’ils sont en réalité, dix fois plus vastes que la Chine et
deux fois plus peuplés; la supériorité dans laquelle ils se complaisaient
leur échappe à tout jamais !
Il y a donc bien naturellement une profonde amertume
dans le sentiment que ce peuple orgueilleux a conçu malgré lui
de la réalité des choses : il se croyait la première des nations,
le seul Empire véritable, et il se voit ce qu’il est, à son humble
rang, à l’école des étrangers qu’il méprisait naguère de toutes
les forces de son âme.
Qu’on lui pardonne donc son véhément désir de ne pas
déchoir, à ses propres yeux, d’étudier les sciences, les arts de
1 Europe sans y mettre la hâte fébrile du Japon, son voisin, de
n’être pas l’écolier qu’on frappe de la férule, mais le studieux
d’aujourd’hui, le rival de demain.
Il était grand temps qu’une impulsion extérieure vînt forcer
la Chine à se renouveler.
La science n’était plus chez elle que l’art de manier élégamment
le pinceau pour reproduire « à l’infini » les formules
classiques. Fiers de posséder par leurs caractères idéographiques
une langue vraiment universelle, les lettrés, qui sont
en même temps les maîtres de la nation, en étaient arrivés
à considérer la lecture et l’écriture, c’est-à-dire de simples
moyens d’acquérir la science, comme étant la science elle-
même. Apprendre à lire, c’est à cela qu’ils se résignaient à
passer leur vie. Leur réputation était au comble lorsque, à la
fin d’une longue carrière d’études, ils avaient pénétré tous les
mystères de la langue écrite.
Or c’est ici le cas de répéter la grande formule que la
vie est courte, que l’art est long : heureux et souverainement
méritant le vieillard chinois qui lit convenablement les anciens
auteurs !
Où donc trouver quelques heures, quelques minutes du
< 579 I