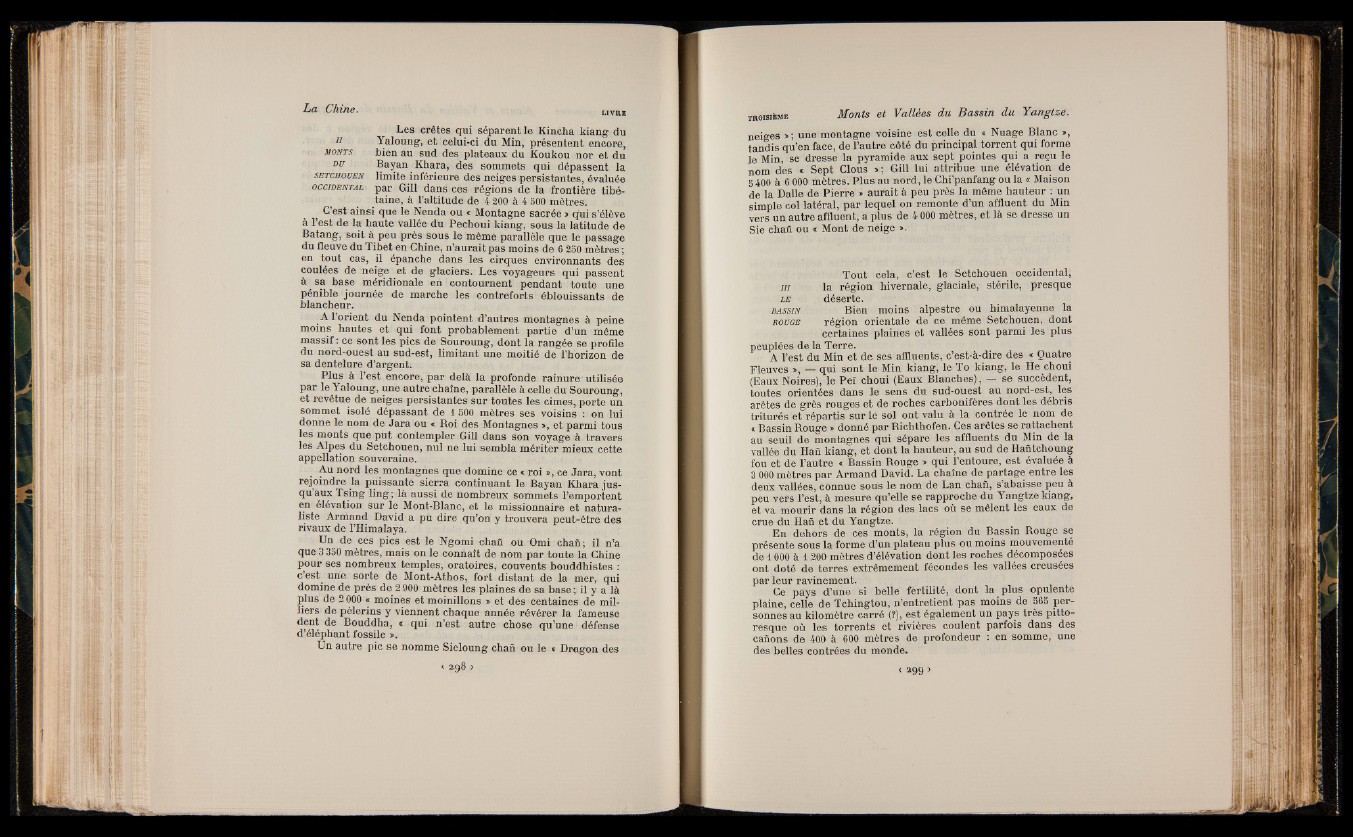
Les crêtes qui séparent le Kincha kiang du
m Yaloung, e t celui-ci du Min, présentent encore,
m o n t s bien au sud des plateaux du Koukou nor et du
du Bayan Khara, des sommets qui dépassent la
se tc h o u e n limite inférieure des neiges persistantes, évaluée
o c cid ental par Gill dans ces régions de la frontière tibétaine,
à l’altitude de 4 200 à 4 500 mètres.
C’est ainsi que le Nenda ou « Montagne sacrée » qui s’élève
à l’est de la haute vallée du Pechoui kiang, sous la latitude de
Batang, soit à peu près sous le même parallèle que le passage
du fleuve du Tibet en Chine, n’aurait pas moins de 6 250 mètres ;
en tout cas, il épanche dans les cirques environnants des
coulées de neige et de glaciers. Les voyageurs qui passent
à sa base méridionale en contournent pendant toute une
pénible journée de marche les contreforts éblouissants de
blancheur.
. A l’orient du Nenda pointent d’autres montagnes à peine
moins hautes et qui font probablement partie d’un même
massif : ce sont les pics de Souroung, dont la rangée se profile
du nord-ouest au sud-est, limitant une moitié de l’horizon de
sa dentelure d’argent.
Plus à l’est encore, par delà la profonde rainure utilisée
par le Yaloung, une autre chaîne, parallèle à celle du Souroung,
et revêtue de neiges persistantes sur toutes les cimes, porte un
sommet isolé dépassant de d 500 mètres ses voisins : on lui
donne le nom de Jara ou « Roi des Montagnes », et parmi tous
les monts que put contempler Gill dans son voyage à travers
les Alpes du Setchouen, nul ne lui sembla mériter mieux cette
appellation souveraine.
Au nord les montagnes que domine ce * roi », ce Jara, vont
rejoindre la puissante sierra continuant le Bayan Khara jusqu’aux
Tsing ling; là aussi de nombreux sommets l’emportent
en élévation sur le Mont-Blanc, et le missionnaire et naturaliste
Armand David a pii dire qu’on y trouvera peut-être des
rivaux de l’Himalaya.
Un de ces pics est le Ngomi chan ou Omi chan; il n’a
que 3 350 mètres, mais on le connaît de nom par toute la Chine
pour ses nombreux temples, oratoires, couvents bouddhistes :
c’est une sorte de Mont-Athos, fort distant de la mer, qui
domine de près de 2900 mètres les plaines de sa base; il y a là
plus de 2000 * moines et moinillons » et des centaines de milliers
de pèlerins y viennent chaque année révérer la fameuse
dent de Bouddha, « qui n ’est autre chose qu’une défense
d’éléphant fossile ».
Un autre pic se nomme Sieloung chan ou le « Dragon des
neiges »; une montagne voisine est celle du « Nuage Blanc »,
tandis qu’en face, de l’autre côté du principal torrent qui forme
le Min, se dresse la pyramide aux sept pointes qui a reçu le
nom des « Sept Clous »; Gill lui attribue une élévation de
5400 à 6 0Û0 mètres^ Plus au nord, le Chi’panfang ou la « Maison
de la Dalle de Pierre » aurait à peu près la même hauteur : un
simple col latéral, par lequel on remonte d’un affluent du Min
vers un autre affluent, a plus de 4 000 mètres, et là se dresse un
Sie chan ou « Mont de neige ».
Tout cela, c’est le Setchouen occidental,
m la région hivernale, glaciale, stérile, presque
l e déserte.
b a s s in Bien moins alpestre ou himalayenne la
roug e région orientale de ce même Setchouen, dont
certaines plaines et vallées sont parmi les plus
peuplées de là Terre.
A l’est du Min et de ses affluents, c’est-à-dire des « Quatre
Fleuves », — qui sont le Min kiang, le To kiang, le He choui
(Eaux Noires), le Peï choui (Eaux Blanches), — se succèdent,
toutes orientées dans le sens du sud-ouest au nord-est, les
arêtes de grès rouges et de roches carbonifères dont les débris
triturés et répartis sur lé sol ont valu à la contrée le nom de
« Bassin Rouge » donné par Richthofen. Ces arêtes se rattachent
au seuil de montagnes qui sépare les affluents du Min de la
vallée du Han kiang, et dont la hauteur, au sud de Hantchoung
fou et de l’autre « Bassin Rouge » qui l’entoure, est évaluée à
3 000 mètres par Armand David. La chaîne de partage entre les
deux vallées, connue sous le nom de Lan chan, s’abaisse peu à
peu vers l’est, à mesure qu’elle se rapproche du Yangtze kiang,
et va mourir dans la région des lacs où se mêlent les eaux de
crue du Han et du Yangtze.
En dehors de ces monts, la région du Bassin Rouge se
présente sous la forme d’un plateau plus ou moins mouvementé
de 1000 à 1 200 mètres d’élévation dont les roches décomposées
ont doté de terres extrêmement fécondes les vallées creusées
par leur ravinement.
Ce pays d’une si belle fertilité, dont la plus opulente
plaine, celle de Tchingtou, n’entretient pas moins de 565 personnes
au kilomètre carré (î), est également un pays très pittoresque
où les torrents et rivières coulent parfois dans des
canons de 400 à 600 mètres de profondeur : en somme, une
des belles contrées du monde.