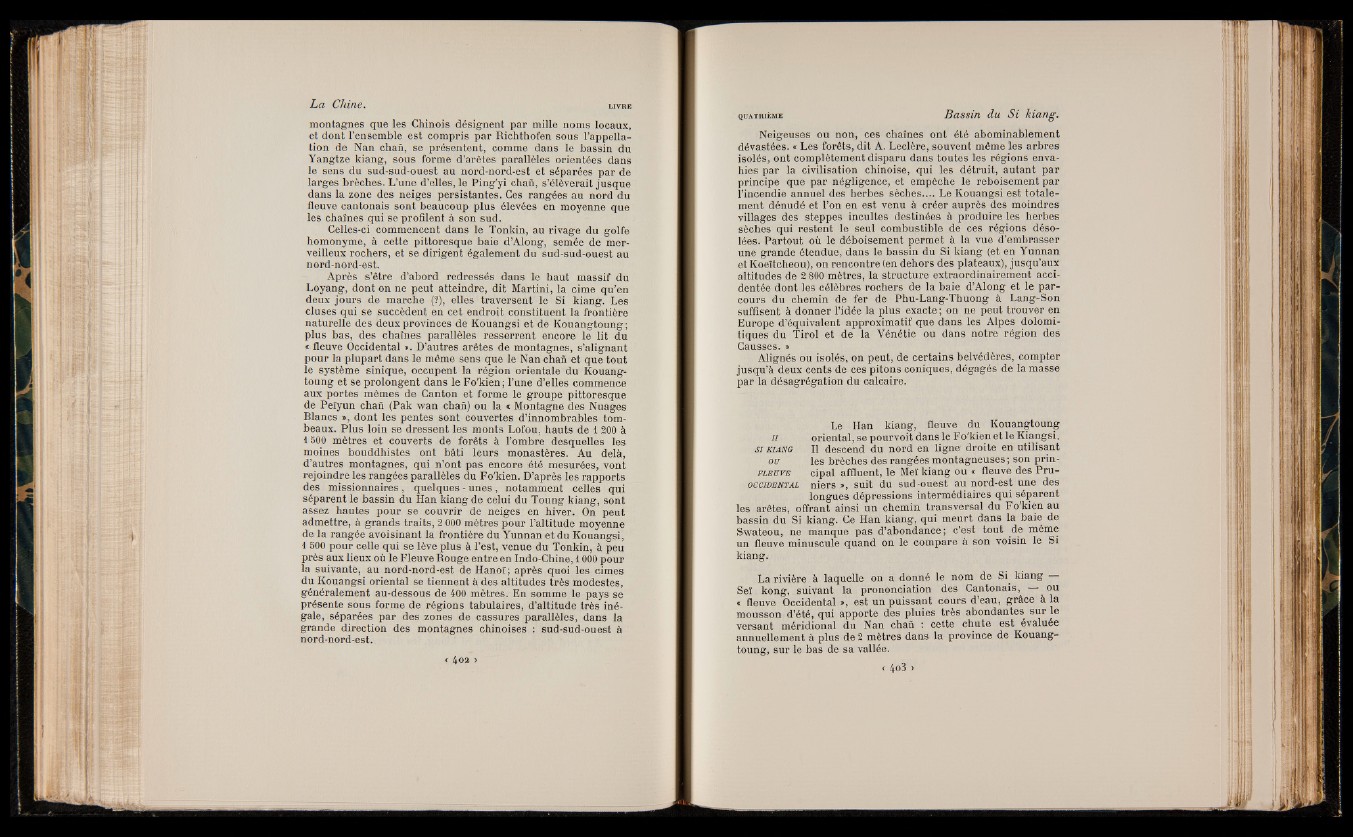
montagnes que les Chinois désignent par mille noms locaux,
et dont l’ensemble est compris par Richthofen sous l’appellation
de Nan chaü, se présentent, comme dans le bassin du
Yangtze kiang, sous forme d’arêtes parallèles orientées dans
le sens du sud-sud-ouest au nord-nord-est et séparées par de
larges brèches. L’une d’elles, le Ping'yi chaü, s’élèverait jusque
dans la zone des neiges persistantes. Ces rangées au nord du
fleuve cantonáis sont beaucoup plus élevées en moyenne que
les chaînes qui se profilent à son sud.
Celles-ci commencent dans le Tonkin, au rivage du golfe
homonyme, à cette pittoresque baie d’Along, semée de merveilleux
rochers, et se dirigent également du sud-sud-ouest au
nord-nord-est.
Après s’être d’abord redressés dans le haut massif du
Loyang, dont on ne peut atteindre, dit Martini, la cime qu’en
deux jours de marche (?), elles traversent le Si kiang. Les
cluses qui se succèdent en cet endroit constituent la frontière
naturelle des deux provinces de Kouangsi et de Kouangtoung ;
plus bas, des chaînes parallèles resserrent encore le lit du
« fleuve Occidental ». D’autres arêtes de montagnes, s’alignant
pour la plupart dans le même sens que le Nan chaü et que tout
le système sinique, occupent la région orientale du Kouangtoung
et se prolongent dans le Fo'kien; l’une d’elles commence
aux portes mêmes de Canton et forme le groupe pittoresque
de Peîyun chafi (Pak wan chaü) ou la « Montagne des Nuages
Blancs », dont les pentes sont couvertes d’innombrables tombeaux.
Plus loin se dressent les monts Lofou, hauts de 1 200 à
1500 mètres et couverts de forêts à l’ombre desquelles les
moines bouddhistes ont bâti leurs monastères. Au delà,
d’autres montagnes, qui n’ont pas encore été mesurées, vont
rejoindre les rangées parallèles du Fo'kien. D’après les rapports
des missionnaires, quelques - u n e s , notamment celles qui
séparent le bassin du Han kiang de celui du Toung kiang, sont
assez hautes pour se couvrir de neiges en hiver. On peut
admettre, à grands traits, 2 000 mètres pour l’altitude moyenne
de la rangée avoisinant la frontière du Yunnan et du Kouangsi,
1 500 pour celle qui se lève plus à l’est, venue du Tonkin, à peu
près aux lieux où le Fleuve Rouge entre en Indo-Chine, 1000 pour
la suivante, au nord-nord-est de Hanoï ; après quoi les cimes
du Kouangsi oriental se tiennent à des altitudes très modestes,
généralement au-dessous de 400 mètres. En somme le pays se
présente sous forme de régions tabulaires, d’altitude très inégale,
séparées par des zones de cassures parallèles, dans la
grande direction des montagnes chinoises : sud-sud-ouest à
nord-nord-est.
Neigeuses ou non, ces chaînes ont été abominablement
dévastées, i Les forêts, dit A. Leclère, souvent même les arbres
isolés, ont complètement disparu dans toutes les régions envahies
par la civilisation chinoise, qui les détruit, autant par
principe que par négligence, et empêche le reboisement par
l’incendie annuel des herbes sèches.... Le Kouangsi est totalement
dénudé et l’on en est venu à créer auprès des moindres
villages des steppes incultes destinées à produire les herbes
sèches qui restent le seul combustible de ces régions désolées.
Partout où le déboisement permet à la vue d’embrasser
une grande étendue, dans le bassin du Si kiang (et en Yunnan
etKoeïtcheou), on rencontre (en dehors des plateaux), jusqu’aux
altitudes de 2 800 mètres, la structure extraordinairement accidentée
dont les célèbres rochers de la baie d’Along et le parcours
du chemin de fer de Phu-Lang-Thuong à Lang-Son
suffisent à donner l’idée la plus exacte ; on ne peut trouver en
Europe d’équivalent approximatif que dans les Alpes dolomi-
tiques du Tirol et de la Vénétie ou dans notre région des
Causses. »
Alignés ou isolés, on peut, de certains belvédères, compter
jusqu’à deux cents de ces pitons coniques, dégagés de la masse
par la désagrégation du calcaire.
Le Han kiang, fleuve du Kouangtoung
n oriental, se pourvoit dans le Fo'kien et le Kiangsi.
s i k ia n g II descend du nord en ligne- droite en utilisant
ou les brèches des rangées montagneuses ; son prinf
l e u v e cipal affluent, le Met kiang ou * fleuve des PruocciDENTAL
niers », suit du sud-ouest au nord-est une des
longues dépressions intermédiaires qui séparent
les arêtes, offrant ainsi un chemin transversal du Fo'kien au
bassin du Si kiang. Ce Han kiang, qui meurt dans la baie de
Swateou, ne manque pas d’abondance; c’est tout de même
un fleuve minuscule quand on le compare à son voisin le Si
kiang.
La rivière à laquelle on a donné le nom de Si kiang —
Seï kong, suivant la prononciation des Cantonáis, ou
« fleuve Occidental », est un puissant cours d’eau, grâce à la
mousson d’été, qui apporte des pluies très abondantes sur le
versant méridional du Nan chaü : cette chute est évaluée
annuellement à plus de 2 mètres dans la province de Kouangtoung,
sur le bas de sa vallée.