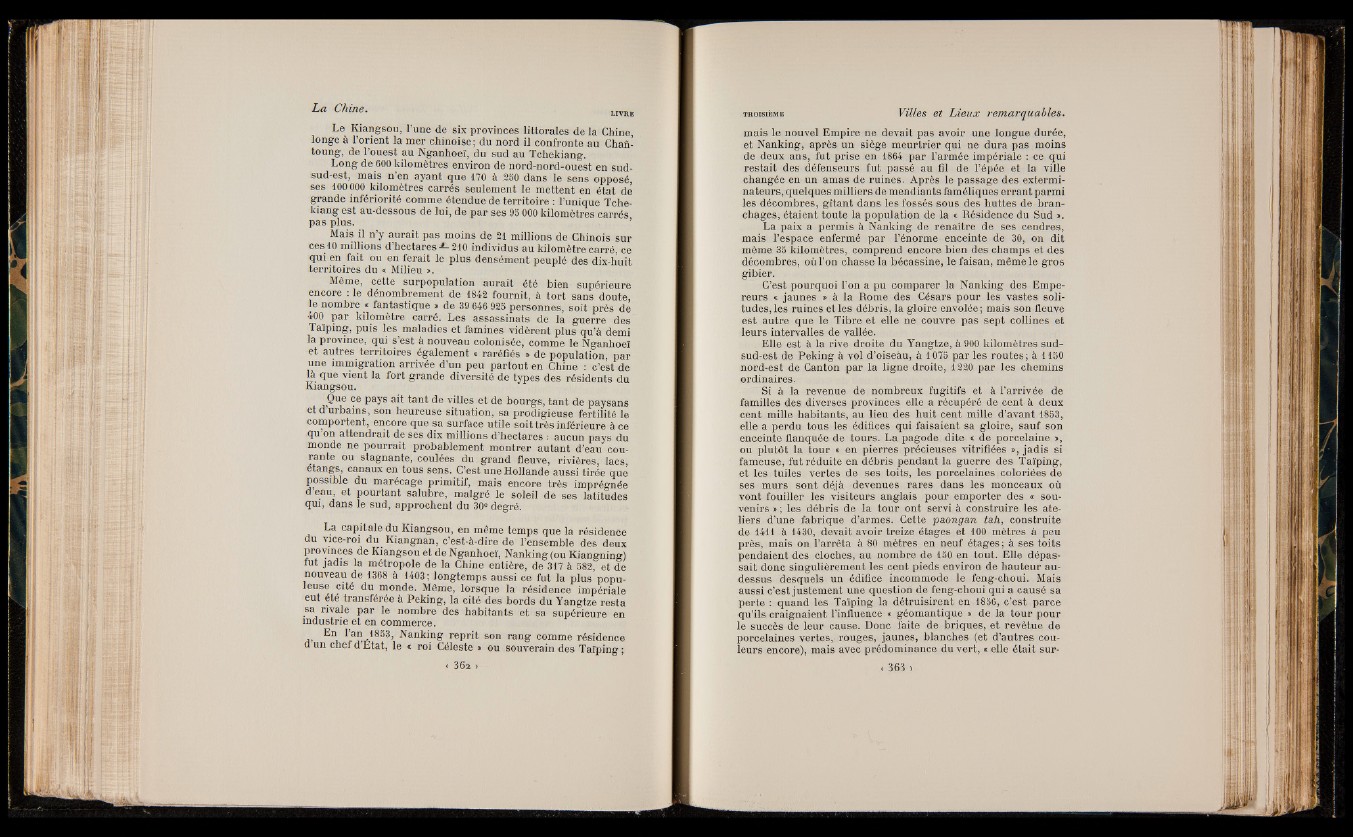
Le Kiangsou, l’une de six provinces littorales de la Chine,
longe à l’orient la mer chinoise; du nord il confronte au Chan-
toung, de l’ouest au Nganhoeï, du sud au Tchekiang.
Long de 600 kilomètres environ de nord-nord-ouest en sud-
sud-est, mais n’en ayant que 170 à 250 dans le sens opposé,
ses 100000 kilomètres carrés seulement le mettent en état dé
grande infériorité comme étendue de territoire : l’unique Tchekiang
est au-dessous de lui, de par ses 95 000 kilomètres carrés
pas plus.
Mais il n’y aurait pas moins de 21 millions de Chinois sur
ces 10 millions d’hectares 210 individus au kilomètre carré, ce
qui en fait ou en ferait le plus densément peuplé des dix-huit
territoires du * Milieu ».
Même, cette surpopulation aurait été bien supérieure
encore : le dénombrement de 1842 fournit, à tort sans doute
le nombre « fantastique » de 39 646 925 personnes, soit près dé
400 par kilomètre carré. Les assassinats de la guerre des
Taïping, puis les maladies et famines vidèrent plus qu’à demi
la province, qui s’est à nouveau colonisée, comme le Nganhoeï
et autres territoires également « raréfiés » de population, par
une immigration arrivée d’un peu partout en Chine : c’est de
là que vient la fort grande diversité de types des résidents du
Kiangsou.
Que ce pays ait tant de villes et de bourgs, tant de paysans
et d’urbains, son heureuse situation, sa prodigieuse fertilité le
comportent, encore que sa surface utile soit très inférieure à ce
qu on attendrait de ses dix millions d’hectares : aucun pays du
monde ne pourrait probablement montrer autant d’eau courante
ou stagnante, coulées du grand fleuve, rivières, lacs,
étangs, canaux en tous sens. C’est une Hollande aussi tirée que
possible du marécage primitif, mais encore très imprégnée
d eau, et pourtant salubre, malgré le soleil de ses latitudes
qui, dans le sud, approchent du 30e degré.
La capitale du Kiangsou, en même temps que la résidence
du vice-roi du Kiangnan, c’est-à-dire de l’ensemble des deux
provinces de Kiangsou et de Nganhoeï, Nanking(ou Kiangning)
fut jadis la métropole de la Chine entière, de 317 à 582, et de
nouveau de 1368 à 1403 ; longtemps aussi ce fut la plus populeuse
cité du monde. Même, lorsque la résidence impériale
eut été transférée à Peking, la cité des bords du Yangtze resta
sa rivale par le nombre des habitants et sa supérieure en
industrie et en commerce.
En ,4853, Nanking reprit son rang comme résidence
d un chef d’Etat, le * roi Céleste » ou souverain des Taïping ;
mais le nouvel Empire ne devait pas avoir une longue durée,
et Nanking, après un siège meurtrier qui ne dura pas moins
de deux ans, fut prise en 1864 par l’armée impériale : ce qui
restait des défenseurs fut passé au fil de l’épée et la ville
changée en un amas de ruines. Après le passage des exterminateurs,
quelques milliers de mendiants faméliques errant parmi
les décombres, gîtant dans les fossés sous des huttes de branchages,
étaient toute la population de la * Résidence du Sud ».
La paix a permis à Nanking de renaître de ses cendres,
mais l’espace enfermé par l’énorme enceinte de 30, on dit
même 35 kilomètres, comprend encore bien des champs et des
décombres, où l’on chasse la bécassine, le faisan, même le gros
gibier.
C’est pourquoi l’on a pu comparer la Nanking des Empereurs
i jaunes » à la Rome des Césars pour les vastes solitudes,
les ruines et les débris, la gloire envolée ; mais son fleuve
est autre que le Tibre et elle ne couvre pas sept collines et
leurs intervalles de vallée.
Elle est à la rive droite du Yangtze, à 900 kilomètres sud-
sud-est de Peking à vol d’oiseàu, à 1075 par les routes; à 1150
nord-est de Canton par la ligne droite, 1220 par les chemins
ordinaires.
Si à la revenue de nombreux fugitifs et à l’arrivée de
familles des diverses provinces elle a récupéré de cent à deux
cent mille habitants, au lieu des huit cent mille d’avant 1853,
elle a perdu tous les édifices qui faisaient sa gloire, sauf son
enceinte flanquée de tours. La pagode dite « de porcelaine »,
ou plutôt la tour « en pierres précieuses vitrifiées », jadis si
fameuse, fut réduite en débris pendant la guerre des Taïping,
et les tuiles vertes de ses toits, les porcelaines coloriées de
ses murs sont déjà devenues rares dans les monceaux où
vont fouiller les visiteurs anglais pour emporter des « souvenirs
» ; les débris de la tour ont servi à construire les ateliers
d’une fabrique d’armes. Cette pa.onga.ri tah, construite
de 1411 à 1430, devait avoir treize étages et 100 mètres à peu
près, mais on l’arrêta à 80 mètres en neuf étages ; à ses toits
pendaient des cloches, au nombre de 150 en tout. Elle dépassait
donc singulièrement les cent pieds environ de hauteur au-
dessus desquels un édifice incommode le feng-choui. Mais
aussi c’est justement une question de feng-choui qui a causé sa
perte : quand les Taïping la détruisirent en 1856, c’est parce
qu’ils craignaient l’influence * géomantique » de la tour pour
le succès de leur cause. Donc faite de briques, et revêtue de
porcelaines vertes, rouges, jaunes, blanches (et d’autres couleurs
encore), mais avec prédominance du vert, « elle était sur