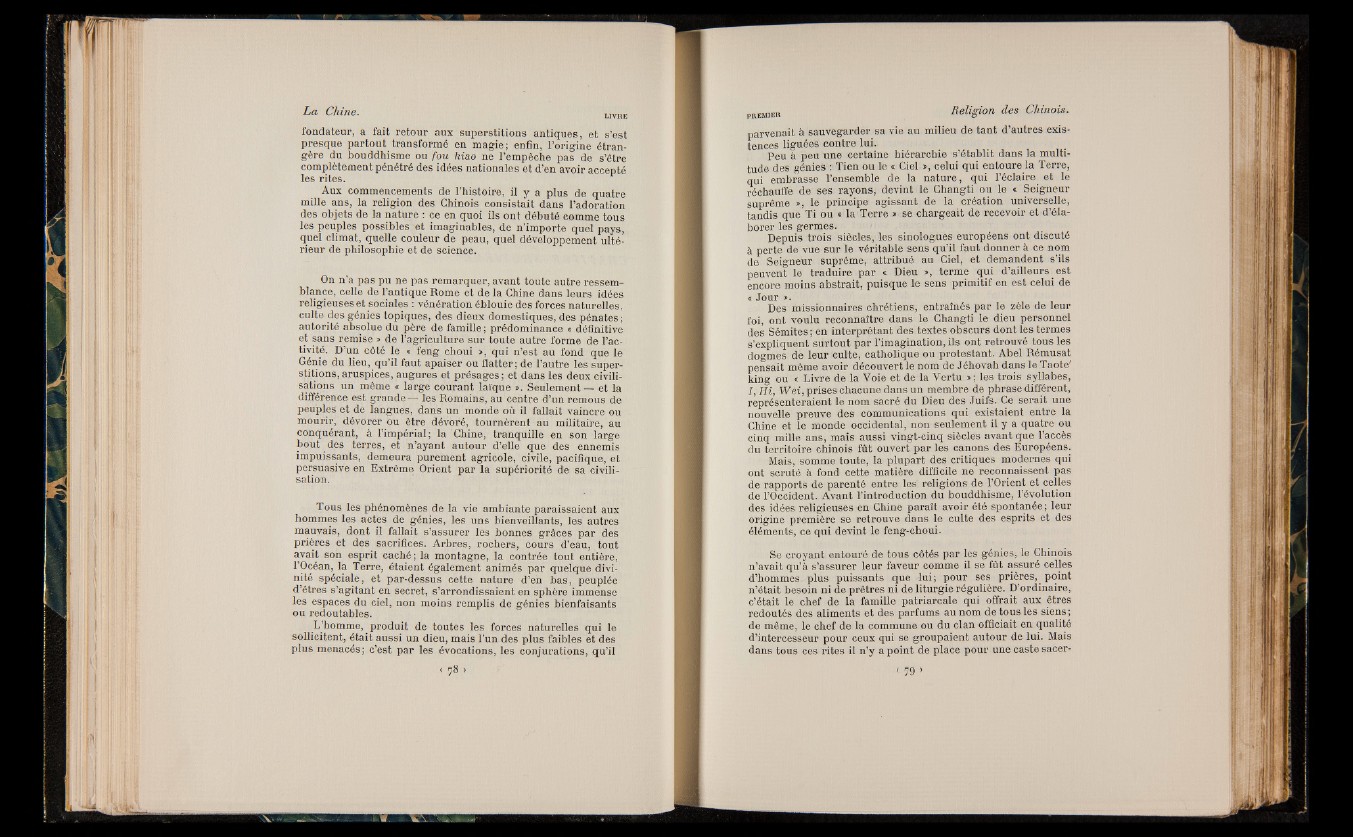
fondateur, a fait retour aux superstitions antiques, et s’est
presque partout transformé en magie; enfin, l’origine étrangère
du bouddhisme ou fou kiao ne l ’empêche pas de s’être
complètement pénétré des idées nationales et d’en avoir accepté
les rites.
Aux commencements de l’histoire, il y a plus de quatre
mille ans, la religion des Chinois consistait dans l’adoration
des objets de la nature : ce en quoi ils ont débuté comme tous
les peuples possibles et imaginables, de n ’importe quel pays,
quel climat, quelle couleur de peau, quel développement ultérieur
de philosophie et de science.
On n’a pas pu ne pas remarquer, avant toute autre ressemblance,
celle de l’antique Rome et de la Chine dans leurs idées
religieuses et sociales : vénération éblouie des forces naturelles,
culte des génies topiques, des dieux domestiques, des pénates;
autorité absolue du père de famille ; prédominance « définitive
et sans remise » de l’agriculture sur toute autre forme de l’activité.
D’un côté le « feng choui », qui n’est au fond que le
Génie du lieu, qu’il faut apaiser ou flatter; de l’autre les superstitions,
aruspices, augures et présages ; et dans les deux civilisations
un même « large courant laïque ». Seulement— et la
différence est grande-'- les Romains, au centre d’un remous de
peuples et de langues, dans un monde où il fallait vaincre ou
mourir, dévorer ou être dévoré, tournèrent au militaire, au
conquérant, à l’impérial; la Chine, tranquille en son large
bout des terres, et n’ayant autour d’elle que des ennemis
impuissants, demeura purement agricole, civile, pacifique, et
persuasive en Extrême Orient par la supériorité de sa civilisation.
Tous les phénomènes de la vie ambiante paraissaient aux
hommes les actes de génies, les uns bienveillants, les autres
mauvais, dont il fallait s’assurer les bonnes grâces par des
prières et des sacrifices. Arbres, rochers, cours d’eau, tout
avait son esprit caché; la montagne, la contrée tout entière,
l’Océan, la Terre, étaient également animés par quelque divinité
spéciale, et par-dessus cette nature d’en bas, peuplée
d’êtres s’agitant en secret, s’arrondissaient en sphère immense
les espaces du ciel, non moins remplis de génies bienfaisants
ou redoutables.
L’homme, produit de toutes les forces naturelles qui le
sollicitent, était aussi un dieu, mais l’un des plus faibles et des
plus menacés; c’est par les évocations, les conjurations, qu’il
parvenait à sauvegarder sa vie au milieu de tant d’autres existences
liguées contre lui.
Peu à peu une certaine hiérarchie s’établit dans la multitude
des génies : Tien ou le « Ciel », celui qui entoure la Terre,
qui embrasse l’ensemble de la nature, qui l’éclaire et le
réchauffe de ses rayons, devint le Changti ou le « Seigneur
suprême », le principe agissant de la création universelle,
tandis que Ti ou « la Terre » se chargeait de recevoir et d’éla-
borer les germes.
Depuis trois siècles, les sinologues européens ont discuté
à perte de vue sur le véritable sens qu’il faut donner à ce nom
de Seigneur suprême, attribué au Ciel, et demandent s’ils
peuvent le traduire par » Dieu », terme qui d’ailleurs est
encore moins abstrait, puisque le sens primitif en est celui de
i Jour ».
Des missionnaires chrétiens, entraînés par le zèle de leur
foi, ont voulu reconnaître dans le Changti le dieu personnel
des Sémites; en interprétant des textes obscurs dont les termes
s’expliquent surtout par l’imagination, ils ont retrouvé tous les
dogmes de leur culte, catholique ou protestant. Abel Rémusat
pensait même avoir découvert le nom de Jéhovah dans le Taote'
king ou « Livre de la Voie et de la Vertu »; les trois syllabes,
I, Hi, Wei, prises chacune dans un membre de phrase différent,
représenteraient le nom sacré du Dieu des Juifs. Ce serait une
nouvelle preuve des communications qui existaient entre la
Chine et le monde occidental, non seulement il y a quatre ou
cinq mille ans, mais aussi vingt-cinq siècles avant que l’accès
du territoire chinois fût ouvert par les canons des Européens.
Mais, somme toute, la plupart des critiques modernes qui
ont scruté à fond cette matière difficile ne reconnaissent pas
de rapports de parenté entre les! religions de l’Orient et celles
de l’Occident. Avant l’introduction du bouddhisme, l’évolution
des idées religieuses en Chine paraît avoir été spontanée; leur
origine première se retrouve dans le culte des esprits et des
éléments, ce qui devint le feng-choui.
Se croyant entouré de tous côtés par les génies, le Chinois
n’avait qu’à s’assurer leur faveur comme il se fût assuré celles
d’hommes plus puissants que lui; pour ses prières, point
n’était besoin ni de prêtres ni de liturgie régulière. D’ordinaire,
c’était le chef de la famille patriarcale qui offrait aux êtres
redoutés des aliments et des parfums au nom de tous les siens;
de même, le chef de la commune ou du clan officiait en qualité
d’intercesseur pour ceux qui se groupaient autour de lui. Mais
dans tous ces rites il n’y a point de place pour une caste sacer