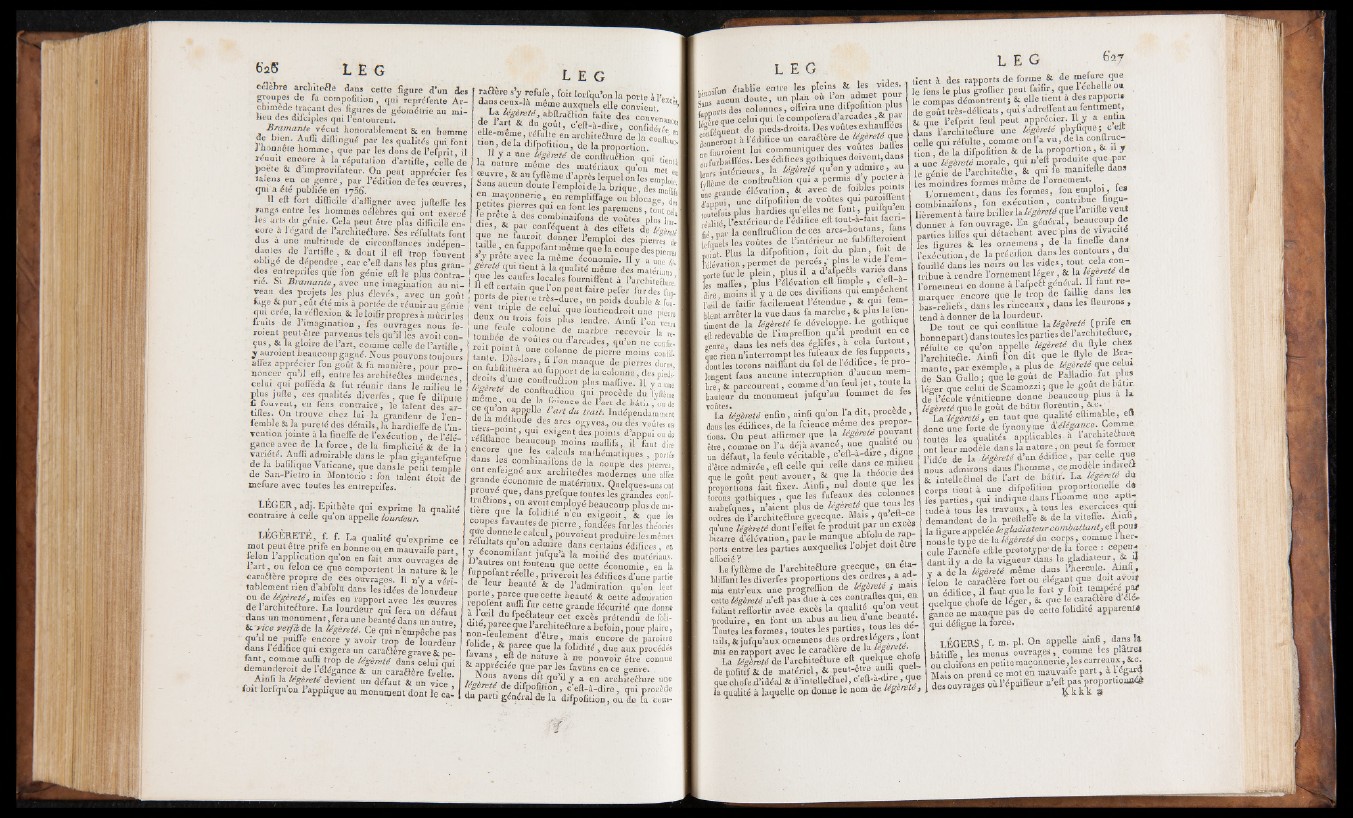
6' a 5 L Ë G
célèbre arcliite^ê dans cette figure d’un des
groupes de fa compofilion , qui repréfente Archimède
traçant des figures de géométrie au milieu
des difciples qui l’entourent.
Bramante vécut honorablement 8t en homme
ae bien. Aufli dillirigué par les qualités qui font
jnonnete homme, que par les dons de l’efprit, il
renuit encore à la réputation d’artifle, celle de
ÿoete & d’improvifateur. On peut apprécier fes
la,eus en ce genre, par l ’édition de fes oeuvres,
cjm a£té publiée en 175.6'.
Il eft fort difficile d’aflignèr avec juftefle les
rangs entre les hommes célèbres qui ont exércé
les arts du génie. Cela peut être plus difficile encore
a 1 egard de l’archfte&ure. Ses réfultats font
dus à une multitude de circonftances indépen-
dantes de l’avlifte , & dont il eft trop fouvent
obligé de dépendre , car c’eft dans les plus grandes
entreprises que fon génie eft le plus contra- ;
ne. Si Bramante, avec une imagination au ni- *
veau des projets les plus élevés , avec un o-oût !
»âge & pur, eut été mis à portée de réunir au génie !
qui crée, là réflexion & le IoîjGt propres à mûrir les
fruits de 1 imagination , fes ouvragés nous fe- ]
roi en t peut-être parvenus tels 'qu’il les a voit con- !
çus, & la gloire de l’art, comme celle de l’artifte,
y aurcnept beaucoup gagné. Nous pouvons toujours
allez apprécier fon goût & fa manière, pour prononcer
qu’il efl, entre les archifeOes modernes
celui qui pofîeda & fut réunir dans le milieu le
plus jufte, ces qualités diverfes, que fe dilpule
fi fouvent, en fens contraire, le talent des ar-
tiftes. On trouve chez lui la grandeur de l’en-
f’emble 81 la pureté des détails,la hardiefle de l’invention
jointe à la fmeffe de l’exécution, de l’élégance
avec de la force, de la fimpficité & de la
variété. Aufli admirable dans le plan gigantefque
de la bahuque vaticane, que dans le petit temple
de San-Pietro in Montôrio : fon talent éloit de
mefure avec toutes les enireprifes.
LEGER, adj. Epithete qui exprime la qualité
contraire à celle qu’on appelle lourdeur.
LÉGÈRETÉ, f. f. La qualité qu’exprime ce
mot peut etre pnfe en bonne on en mauvaife part
félon 1 application qu’on en fait aux ouvrages dé
1 a r t, ou félon ce què comportent la natnre & le
r * ;ir .'lf r p rp T v r tin r o A-ni —a n . _ n na!mre fit le
carattere propre de ees ouvrages. Il nV a véritablement
nen d'abfoln dans les idées de lourdeur
ou de légèreté, mifes en rapport avec lés oeuvres
de 1 architecture. La lourdeur qui fera un défaut
■ dans un monumen t , fera une beauté dans un antre
U-vtee verfa&e la légèreté. Ce qui n’empêche pas’
3“ 1 j O s S I enCOTe y avoir troP de lourdeur
dans 1 édifice qui exigera un caraSere grave St ne-
fant, comme aufli trop i e légèreté dans celui dui
demanderont dé 1 élégance St un caraflère fvelte
Ainb la légèreté devient un défaut 8t un vice
ioit ioriqu ou 1 applique au monument dont le ca- |
L E G
raflère s’y refufe, foit lorfqu’on la porte à « S I
dans ceux-la même auxquels elle convient ”
La légèreté, abftraêlion faite des convénanr
de 1 art St du goût, c’eft-à-dire, confidé,?.?
elle-meme, réfulte en architeaure de la conft'
tton, delà difpofition, de la proportion H
fi y a nue légèreté de conltraflion qui M |
la nature même des matériaux qu’on me 1
oeuvre, St au fyftèmn d’après lequel cîn les empul
hans aucun doute 1 emploi de la V iq u e , des 5
en maçonnerie, en rempliffage ou blocage S
petites pierres qui en font les paremens, tou! „ t
fe pie te a des combmaifons de voûtes plus W
dies, St par conféquent à des effets de légèJA
que ne faurott donner l’emploi des pierres J
taille, en fuppofant même que la coupe des pierrt
s y prête avec la meme économie. Il y a une U
gèt-eté qui tient à la qualité même des matériau,'
que les caufes locales fourniffeut à
Il eil certain que l’on peut faire pefer fur des
ports de pierre très-dure, un poids double & h,,.
vent triple de celui que foutiendroit une pierre
deux ou trois fois plus tendre. Ainfi H H
une feule colonne de marbre recevoir la re.
tombée de voûtes ou d’arcades, qu’on r.emaâ-
a°ù eP° n H M r ° l°aae de piorre H M H
o r L(Vès’ Iors’. fl on milI“ Iue de pierres dures
on fubftituera au luppovt de la colonne, des piedi!
K d l conflruaton plus maffive. Il y a une
légèreté de conftruêhon qui procède dufyftème
meme, ou de la fcrence de l ’art de bâtirfoude
ce qu ou appelle H H du trait. Indépendamment
de u méthode des arcs ogyyes, ou dés voûtes ea
'it t fi P01“ 1,’ ‘1U1 exISent des points’ d’appui ou de
îtfifiance beaucoup moins maffifs, il faut dire’
encore que les- calculs mathématiques , .portés
dans les combmaifons de la coupe des pierres,
e? ejS ne #ux arcbiteâes modernes une allez
grande économie de matériaux. Quelques-uns ont
prouvé que, dans prefque toutes les grandes eonfÜT
„ °nS’ T î v° I,t.emP1°y$beaucoup plus de matière
que la folidité n’en exîgeoil, & que les
coupes favantes de pierre, fondées furies théories
que donne le calcul, pouvoient produire les mêmes
reluitats qu on admire dans certains édifices , en
y économifant jnfqu’à 'la moitié des matériaux.
U autres ont foutenu que cette économie, en .
luppofantréelle,------ , priverait lcs les eainces édifices a d’une une parue
parti
fit* lf» n r h a u n tX O. J - H t * • . ‘ ,
[ de leur beauté & de l ’admiration qu’on leur
porte, parce que cette beauté & cette admiration
repoient atiffi fur cette grande fécurité que donne
a l oeil dufpectateur cet excès prétendu de foli-
dité, parce que l’arcbiteaure a bèfùin, pour plaire,
non-leulement d’ê tre, mais encore de paraître
lofide, & parce que la folidité, due aux procédés
avans, en: de nature à ne pouvoir être connue
& appréciée que par les fav'ans en ce genre.
Nous avons dit qu’il y a en arcliiteânre une
légèreté de difpofi/ion, c’eft-à-dire, qui procède
du parti général dé la difpofition, ou de la coin-
L E G
I ;f„n établie entre les pleins & les vides. |
£ aucun doute, un plan où l’on admet pour
S o r t s des colonnes, offrira une difpofition plus
S e que celui qui le compoferad arcades ,& par
douent de pieds-droits. Des voules exbauflees
S S u “ à l ’édifice un caraflère de légèreté que
te fauvoient lui communiquer des voûtes balles
ii furbailfées. Les édifices gothiques doivent, dans
l “ rs intérieurs , la légèreté qu’on y admire , au
f Mme de B 1 — qui a permis d'y porter a
Ü H élévation, l avec de foibles points
Anuui, une difpofilion de voûtes qui paroifient
tortefois plus hardies qu elles ne font , puilfinen
réalité, l’extérieur de l’édifice ell tout-a-fait facri-
: fié par la conftruaion de ces avcs-boutans, fans
lefquels le« voûtes de l’intérieur ne fubfifteroient
: point. Plus la difpofilion, foit du plan, fort de
{élévation, permet de percés,' plus le vide 1 em-
porte fiir le plein, plus il a d’afpeas varivi dans
fes maffes, plus l’élévation eft fimple , c elt-à-
dire moins il y a de ces divifions qui empeclient
l’céil’ de faifir facilement l’étendue, & qui fem-
blent arrêter la vue daus fa marche, 8t plusse len-
timeut de la légèreté fe développe. Le gothique
eft redevable de Timprelïion qu’il produit en ce
genre, dans les nefs dès églifes, à cela fuvtout,
nue rien n’interrompt les fuieaux de fes lupports,
dont les torons naifiant du fol de l’édifice, le prolongent
fans aucune interruption d aucun membre,
& parcourent, comme d’un, feul jpt, toute la
hauteur du monument jufqu’au fommet ae es
voûtes. I „
La légèreté enfin, ainfi qu on 1 a dit, procède ,
dans les édifices, de la fcience même des proportions.
On peut, affirmer que la légerete pouvant
être, comme on l ’a déjà avancé, une qualité ou
un défaut, la feule véritable, c’eft-a-dire , digne
d’être admirée, eft celle qui refte dans ce milieu
que le goût peut avouer, & qu.e -la théorie ües
proportions fait fixer. Ainfi, nul doute que les
forons gothiques ,-que les fufeaux des. colonnes
■ n u Valent plus de légèreté que^tous les
ordres de l ’architeaure grecque.; Mais , épi eit-ce
qu’une légèreté dontl’efl’et Ce produit par un excès,
bizarre d’élévation, parle manque abfolu de rapports
entre les parties auxquelles 1 objet .01 e 'e
affocié ? /.
Le fyftème de l’arcbiteaure grecque, en éta-
bliffantles diverfes proportions des ordres, a att-
mis entr’eux une progreffton de légèret ; mat
celte légèreté n’eft pas due à ces contraftes qui, en
faiiàut reffortir avec excès la qualité qu on veut
produire, en font un abus au lieu dune
Toutes les formes, toutes les parties, jnus es
tiils, & jufqu’aux omemens des ordres légers, lout
mis en rapport avec le caraaère de la lég nié *
La légèreté de l’arcbiteaure eft quelque cbofe
de pofitif 8t de matériel, & peut-etra aulb quelque
chofed’idéal & d’intelleauel, c eft-a-dire, que
la qualité à laquelle op donne le nom de légerete,
L E G . 6 2 7
lient à des rapports de forme & de “ efnre qoe
le fens le plus greffier peut faifir, que 1 échelle ou
ie compasPdémVutrentP8t elle tient à des rapport»
de goût très-délicats, qui s’adreffient au fentiment,
& que l ’efprit feul peut apprécier. I l y a enfin
dans l’architeaure une légèreté pbyfique ; c elt
celle qui réfulte, comme onl a vu, d elà conifiuc-
tion , de la difpofition &. de la proportion, 81 il y
a une légèreté morale, qui n’eft produite <I“ ed?‘7
le génie de l’arebiteae, & qui fe mamfefte dans
les moindres formes même de 1 ornement.
L’ornement, dans fes formes, fon emploi, le»
combinaifons, fon exécution , . contribue fiogulièrement
à faire briller la légèreté que l artifte veut
donner à fou ouvrage. Eu général, beaucoup de
parties lifl’es qui détachent avec plus de viyaoité
les figures & les ornemens , de la fineffe dan»
l’exécution, de la précifion dans les contours, du
fouillé dans les noirs ou les vides, tout cela contribue
à rendre l ’oruemeatléger, & la legereté de
l ’ornement en donne à l’afpeÛ général. Il faut remarquer
encore que le trop de faillie ans
bas-reliefs, dans les rinceaux , dans les fleurons ,
tend à donner de la lourdeur. ...
De tout ce qui conftitue la légèreté Cp1“ ® en
bonne part) dans toutes les parties del architetture,
réfuire ce qu’on appelle légèreté du ftyle chez
l’arcbifefle. Ainfi fou dit que le ftyle de Bramante,
par exemple, a plus de légère^ çpie celu
de San Gallo ; qué le goût de Palladimfut plus
léger que celui deScamozzi; que le goût de bâtir,
de l’école vénitienne donne beaucoup plus a la
légèreté que le goût de bâtir florentin, &c._
La 'légèreté, en tant que qualité eftimable, efl
donc une forte de fynonyme S élégance. Comme
toutes les qualités applicables- a 1 arcbiLetluta
ont leur modèle dans la nature, on peut le ffirtuet
l’idée de la ,légèreté d’un édifice , par celle que
nous admirons dans l’homme, ce .modèle mdireU
& intellefluel de l’art de bâtir. La légèreté du
corps tient à nue difpofition proportionelle de
fes parties, qui indique dans l’homme nue aptitude
à tous les travaux, à tous les exercices- qui
demandent d elà prefteffe & de la vitefle. Amü,
la figure appelée le gladiateur combattant, eft pou*
noosie type de la légèreté du corps comme 1 fier,
cule Farhèfe eftle prototype-de la force ; cepen-
dant il y a de la vigueur dans le gladiateur, & d
v a de la légèreté même dans 1 hercule. Ainü ,
félon le caraaère fort ou élégant ju e doit avoi*
un édifice, il faut que. le fort y fort tempere pa«
quelque çhofe de léger, U que fis c a r^ e r e d é le .
ganceue manque pas de cette folidité apparent,
qui déûgne la force*
LÉGERS, L m- pl' 0 a appelle ainfi, dansl»
bâtiffe , les menus ouvrages, comme les plaürel
ou cloil’ous en petite maçonnerie, les carreaux, Sir,.
Mais on prend ce mot en mauvaife p art, a iegari)
desouyrage» gùl’épaifleur n’eftpasproporLtounéè