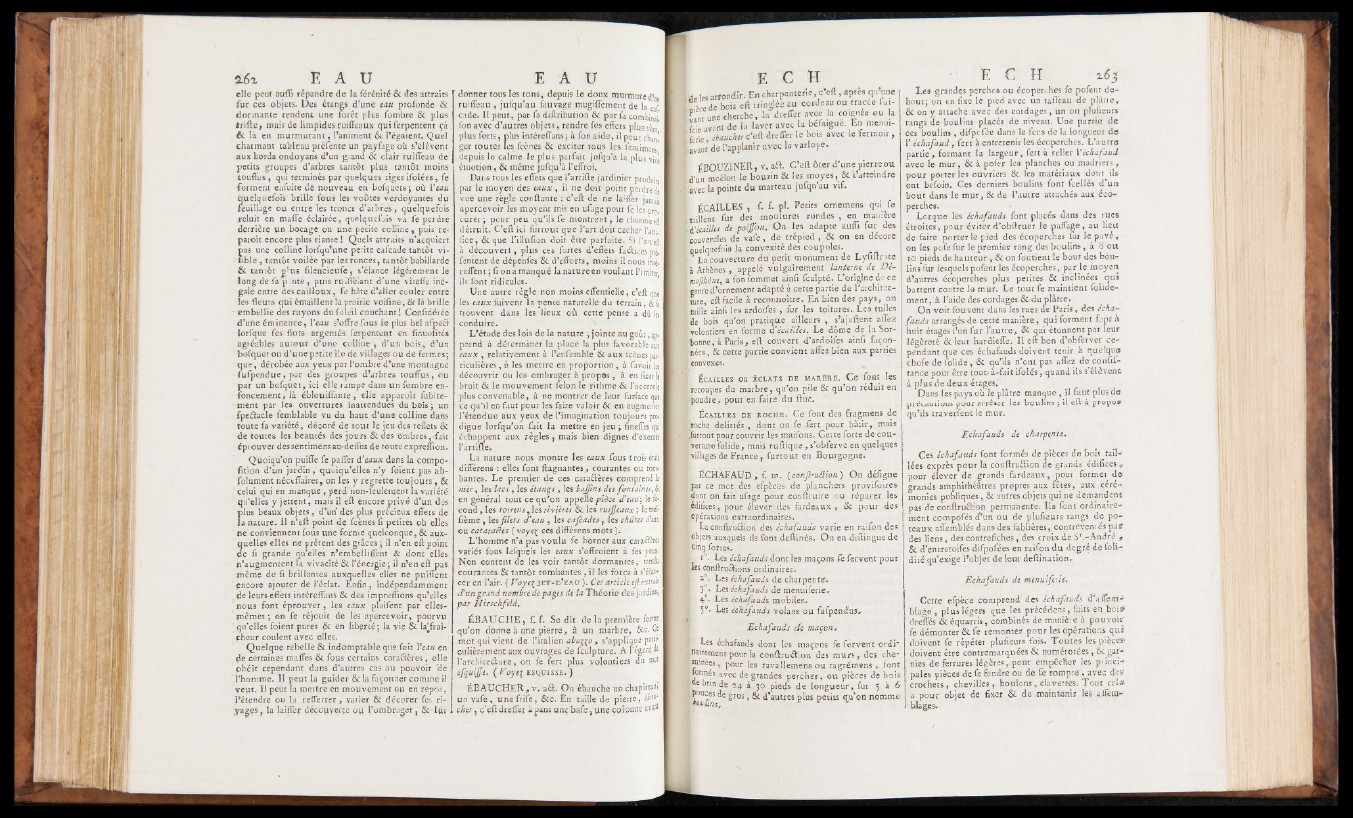
elle peut auffi répandre de la férénité & des attraits
fur ces objets. Des étangs d’une eau profonde &
dormante rendent une forêt plus fombre & plus
tr ille , mais de limpides ruiffeaux qui ferpentent çà
&. là en murmurant, l’animent &. l’égaient. Quel
charmant tableau préfente un payfage où s’élèvent
aux bords ondoyans d’ un grand & clair ruiffeau de
petits groupes d’arbres tantôt plus tantôt moins
touffus , qui terminés par quelques tiges ifolées, fe
forment enfuite de nouveau en bofquets ; où l'tau
quelquefois brille fous les voûtes verdoyantes du
feuillage ou entre les troncs d’arbres, quelquefois
/reluit en maffe éclairée, quelquefois va fe perdre
derrière un bocage ou une petite coliine, puis re-
paroît encore plus riante 1 Quels attraits n'a.çquiert
pas une colline lorfqu’ une petite cafcade tantôt vi-
lible , tantôt voilée par les ronces, tantôt babilfarde
& tantôt plus filencieufe, s’élance légèrement le
long de fa p.nte , puis ruîffeiant d’une vîteffe inégale
entre des cailloux, fe hâte d’aller couler entre
les fleurs qui émaillent la prairie voifine, & là brille
embellie des rayons du foleil couchant ! Copfidérée
d’une éminence, Veau s’offre fous le plus bel afpeél
lorfque fes flots argentés ferpentent en finuoiités
agréables autour d’une colline , d’un bois,, d’un
bofquet ou d’une petite île de villages ou de fermes;
que, dérobée aux yeux par l’ombre d’une montagne
fufpendue, par des groupes d’arbres touffus, ou
par un bofquet, ici elle, rampe dans un fombre enfoncement,
là éblouiffante, elle apparoît fubite-
ment par les ouvertures inattendues du bois ; un
fpeétacle femblable vu du haut d’une colline dans
toute fa variété, décoré de tout le jeu des reflets &
de toutes les beautés des jours & des ombres,-fait
éprouver dessçntimens au-deffus de toute expreifion.
Quoiqu’on puiffe fe paffer d * eaux dans la compo-
fition d’un jardin, quoiqu’elles n’y foient pas absolument
néctffaires, on les y regrette toujours , &
celui qui en manque, perd non'leulerqent la variété
qu’elles y jettent, mais il eft encore privé d’un des
plus beaux objets, d’un des plus précieux effets de
la nature. 11 n’eft point de fcènes fl petites ou elles
pe conviennent fous une forme quelconque, & auxquelles
elles ne prêtent des grâces ; il n’en eft point
de fl grande qu’elles n’ embelliffent & dont elles
n’augmentent la vivacité & l’énergie; il n’en eft pas
même de fi brillantes auxquelles elles ne puiflent
encore ajouter de l’éclat. Enfin, indépendamment
de leurs effets intéreffans & des impreffions qu’elles
nous font éprouver, les taux plaifent par elles-
mêmes ; ôn fe réjouit de les apercevoir, pourvu
' qu’elles foient pures & en liberté \ la vie & la'fraî-
cheur coulent avec elles.
Quelque rebelle & indomptable que foit Veau en
de certaines maffes & fops certains caraélères, elle
pbéit cependant dans d’autres cas au pouvoir ‘de
l’homme. Il peut la guider & la façonner comme il
veut. Il peut la mettre en mouvement ou en repos,
l ’ étendre ou la refferrer, varier & décorer fes ri- ;
yages, la lailfer déçoiiy'erçe ou l’ombrager % & lui i
donner tous les tons, depuis le doux murmure d’u»
ruiffeau , jufqu’au fauvage mugiffement de la Caf
cade. 11 peut, par fa diftribution & par fa combina!
fon avec d’autres objets, rendre fes effets plus sûrs*
plus forts, plus intéreffans; à fon aide, il peutchan!
ger toutes les fcènes & exciter tous les fentimens
; depuis le calme le plus parfait jnfqu’à la plus vive
émotion, & même jufqu’à l’effroi.
Dans tous les effets que l’artifte jardinier produira
par le moyen des eaux , il ne doit point perdre de
vue une règle confiante : c’eft de ne la;ffer jamais
apercevoir les moyens mis en ufage pour fe les proc
u r e r ; pour peu qu’ils fe montrent, le charme eft
détruit.. C’eft ici furtout que l ’art doit cacher l’arti.
fice, & que l’illuflon doit être parfaite. Si l’art eft
à découvert, plus ces fortes d’effets fac tice s pré.
fentent de dépenfes & d’efforts, moins il nous inté-
reffent ; fl on a manqué la nature en voulant l’imiter
ils font ridicules.
Une autre règle non moins effentielle, c’eft que
les eaux fuivent la pente naturelle du terrain, &fe
trouvent dans les lieux ou cette pente a dû les
conduire.
L’ étude des lois de la nature ; jointe au goût,apprend
à déterminer la place la plus favorable aux
eaux , relativement à l’ e n fem b le & aux lcènes par-
ticulières, à les mettre en proportion , à favoir les
découvrir ou les ombrager à propos , à en fixer le
i bruit & le mouvement lelon le rithme & l ’accent le
plus convenable, à ne montrer de leur furface que
ce qu’il en faut pour les faire valoir & en augmenter
l ’étendue aux yeux de l’imagination toujours prodigue
lorfqu’on fait la mettre en jeu ; fineffes qui
échappent aux règles, mais bien dignes d’exercer
l’artifte.
La nature nous montre les eaux fous trois états
différens : elles font ilagnantes, courantes ou tombantes.
Le premier de ces caraélères comprend la
mer, les lacs , les étangs , les bajjins des fontaines, b
en général tout ce qu’on appelle pièce d'eau\ le fécond
, les torrens, les rivières & les ruijjeaux ; le troi-
fième, lès filets d’eau , les cafcadts} les chûtes d'eau
ou cataraSies ( voye{ ces différens roots )|
L ’homme n’a pas voulu fe borner aux caradèreî
variés fous lefquels les eaux s’offroient à fes yeux.
Non content de les voir tantôt dormantes, tantôt
courantes & tantôt tombantes , il les força à s’élancer
en l’air. ( Voye{ jet-d’eàu ). Cet article efl extrait
(Tun grand nojnbre de pages de Ici Théorie des jardins,
par Hirschfeld,
É B A U CH E , f f . Se dit de la première forme
qu’on donne à une pierre, à un marbre, &c. Cfi
mot qui vient de l’ italien abo^ro , s'applique part1'
culièrement aux ouvrages de fculpture. A l ’égard de
Parchiteélure, on fe fert plus volontiers du £É|
e fq u ijfe . ( P o y e { esquisse. )
ÉBAUCHER, v , a61. On ébauche un chapiteau»
un vafe, unefrife, &c. En taille de pierre, éwtf*
çher, ç’eft dreffer à pans une bafe, une çoipnne
L l e s arrondir. En charpenterie, c’e ft, après quatre
1 è e de hors eft tringlée au cordeau ou tracee fur-
E t une cherche, la dreffer avec la co.gnée ou la
fris avant de la laver avec la befargue. En menm-
E rie éUuchcr c’eft dreffer le bois avec le fermoir,
ÉBOUZINER, v. a6l. C ’eft ôter d’une pierre ou
[d’un moëlon le bouzin & les moyes, & L’atteindre
avec la pointe du marteau jufqn’au vif.
E ÉCAILLES , f. f- pb Petits ornemens qui fe
taillent fur des moulures rondes , en manière
U ’écailles de poijfon. On les adapte aufli fur des
[ couvercles de vafe, de trépied , & on en décore
quelquefois la convexité des coupoles.
I La couverture du petit monument de Lyfiftrite
là Athènes , appelé vulgairement lanterne de Dé-
ïjnoflhène, a fon fommet ainfi fculpté. L’origine de ce
f genre d’ornement adapté à cette partie de i ’architec-
Iture, eft facile à reconnoître. En bien des pays, on
[taille ainfi les ardoifes , fur les toitures. Les tuiles
[de bois qu’on pratique ailleurs , s’ajuftent affez
{Volontiers en forme d’ écailles. Le dôme de la Sor-
Ibonne, à Paris, eft couvert d’ardoifes ainfi façonnées,
& cette partie convient affez bien aux parties
Iconvexes.
f Écailles ou éclats de marbre. Ce font les
[recoupes du marbre, qu’on pile & qu'on réduit en
[.'poudre, pour en faire du ftuc.
i Écailtes de roche. Ce font des fragmens de
roche delittés , dont on fe fort pour bâtir, mais
Surtout pour couvrir les maifons. Cette forte de couverture
folide , mais ruftique, s’obferve en quelques
Jvillages de France , furtout en Bourgogne.
I ÉCHAFAUD, f. m, ( confirutiion) On défigne
par ce mot des efpèces de planchers provifoires
Idont on fait ufage pour conftruire ou réparer les
édifices, pour élever des fardeaux , & pour des
.opérations extraordinaires.
ï La conftruélion des échafauds varie en raifon des
lobjets auxquels ils font deftinés. On en diftingue de
cinq fortes.
| i°. Les échafauds dont les maçons fe fervent pour
les conftru&ions ordinaires.
B 2°. Les échafauds de charpente.
B 3°. Les échafauds de menuiferie.
g 4°. Les échafauds mobiles.-
I 5°. Les échafauds volans Ou fufpendus».
1 . »
Echafauds de maçon*
I Les échafauds dont les maçons fe fervent ord'i*
|ttairement pour la conftru<ft ion des murs,- des che~
inunees, pour les ravallemens ou ragrémensfont
I f » avec de grandes perches, ou pièces de bois
1 e brin de 24 à ,30 pieds de longueur, fur 5 a ^
| Ï °U^ S ^ros » & d’autres plus petits qu’on nomme
Les grandes perche® ou écoperches fe pofent debout;
on en fixe le pied avec un taffeau de plane,
& on y attache avec des cordages, un ou plufieurs
rangs de boulins placés de niveau. Une partie de
ces boulins , difpcfée dans le fens de la longueur de 1’ échafaud, fert à entretenir les écoperches. L’autre
partie, formant la largeur, fert a relier Véchafaud
avec le mur, & à pofer les planches ou madriers,
pour porteries ouvriers & les matériaux dont ils
ont befoin. Ces derniers boulins font fcellés d’un
bout dans le mur, & de l ’autre attachés aux éco-
pérches.
Lorque les échafauds font placés dans des rues
étroites, pour éviter d’obftruer le paffage, au lieu
de faire porter le pied des écoperches kir le pavé,
on les pofefur le premier rang des boulins, à 8 ou
10 pieds de hauteur , & on foutient le bout des boulins
fur lesquels pofent les écoperches, par le moyen
d’autres écoperches plus petites & inclinées qui
battent contre la mur. Le tout fe maintient folide-
ment, à l’aide des cordages & du plâtrev
On voit fouvent dans les rues de Paris, des échafauds
arrangés de cette manière, qui forment fept à
huit étages l’un fur l’autre, & qui étonnent par leur
légèreté & leur hardieffe. Il eft bon d’obferver cependant
que ces échafauds doivent tenir à quelque
chofe de folide, & qu’ils n’ont pas affez de conflf-
tance pour être tout-à-fait ifolésquand ils s’élèvent
à plus de deux étages.
Dans les pays oh le plâtre manque, il faut plus de
précautions pour arrêter les boulins ; il eft à propos
qu’ils traverfent le mûr.
Echafauds de charpente.
Ce s échafauds font formés de pièces de hors taillées
exprès pour la conftruélion de grands édifices Ÿ
pour élever de grands fardeaux, pour former de
grands amphithéâtres propres aux fêtes, aux céré-*
monies publiques, & autres objets qui ne demandent
pas de conftruclion permanente. Ils font ordinairement
compofés d’un ou de plufieurs rangs de.poteaux
affemblés dans des fablières, contrevent és par
des liens, des contrefiches, des croix de S*.-André 9
& d’entretoifes difpofées en raifon du degré de foli-:
dite qu’exige l’objet de leur deftination.
Echafauds de menuiferie.
Cette efpèce comprend des échafauds d’aftem-
■ blage plus légers que les précédens, faits en bois»
dreffés & équarris, combinés de manière à pouvoir
fe démonter & fe remonter pour les opérations qui
doivent fe répéter plufieurs fois. Toutes les pièces
doivent être contremarquées & numérotées, & garnies
de ferrures légèrespour empêcher les piinci-
: pales pièces de fe fendre-ou de fe rompre- , avec des
crochets chevilles , boulons, clavettes. Tout cela?
a pour objet de fixer & de -maintenir les alïèna-
1 blagps