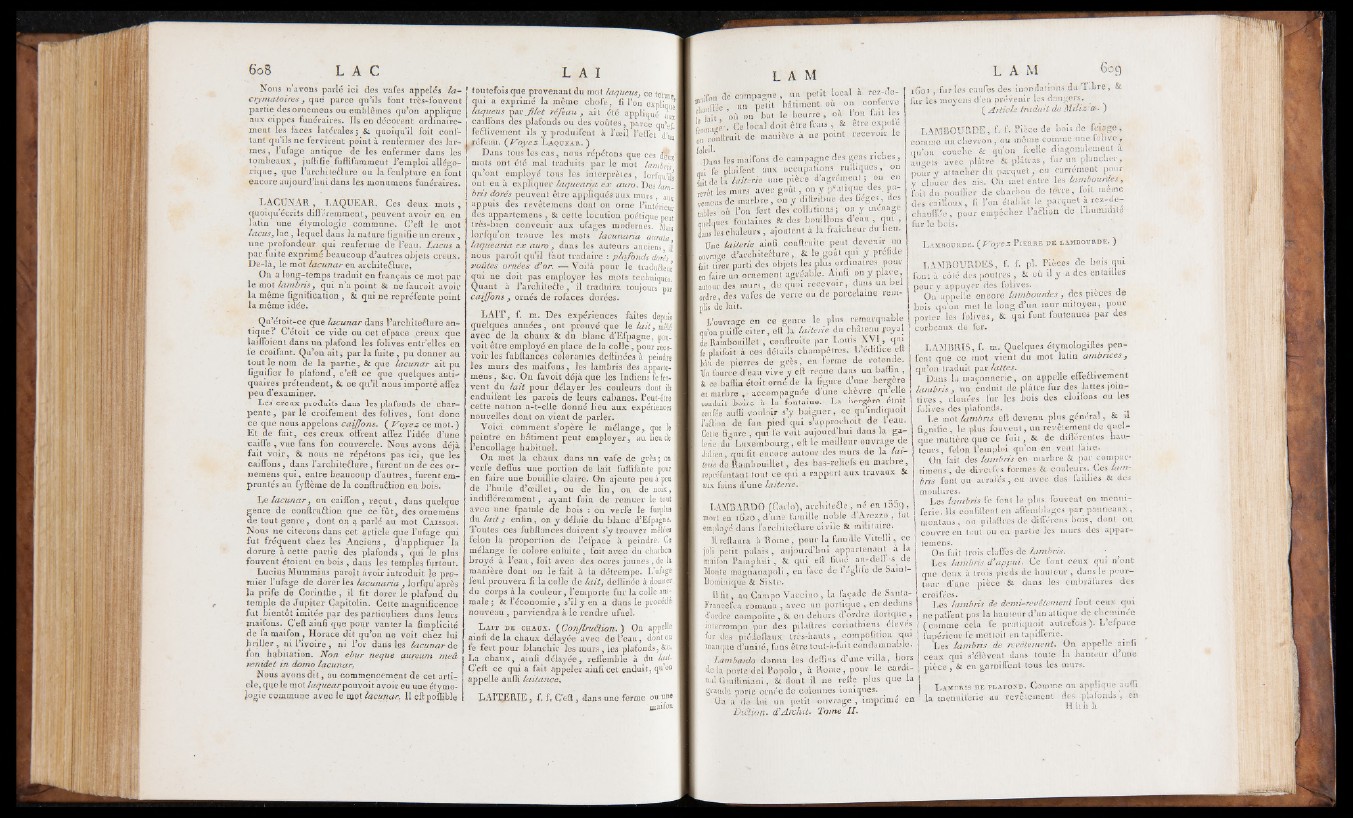
Nous n’avons parlé ici des vafes appelés la -
crymatoiresy que parce qu’ils font 1res-fouvent
partie des ornemens ou emblèmes qu’on applique
aux cippes funéraires. Us en décorent ordinairement
les faces latérales j & quoiqu’il foit confiant
qu ils ne feryirent point à renfermer des larmes
, l’ufage antique de les enfermer dans les
tombeaux j juftifie fuffifamment l’emploi allégorique,
que l ’arckiteâure ou la fculpture en font
encore aujourd’hui dans les monumens funéraires.
LACUNAR , LAQUE AR, Ces deux mots,
quoiqu écrits difïéremment, peuvent avoir eu en
latin une étymologie commune. C’eft le mot
lacus, lac , lequel dans la nature lignifie un creux,
une profondeur qui renferme de l ’eau. Lacus a
par fuite exprimé beaucoup d’autres objets creux,
De-là, le mot lacunaren archite&ure,
On a long-temps traduit en français ce mot par
le mot lambrisy qui n’a point & ne fauroit avoir
la même lignification , & qui ne repréfente point
la même idée,
Qu’étpit-ce que lacunar dans l’arcbile&ure antique?
C’étoit ce vide ou cet efpace preux que
laiffoient dans un plafond les folives entr’elles en
le croifant. Qu’on aitÿ par la fuite , pu donner au
tout le nom de la partie, & que lacunar ait pu
lignifier le plafond, c’eft ce que quelques anti-'
quaires prétendent, & oe qu’il nous importé allez.
peu d’examiner.
Les creux produits dans les plafonds de charpente
, p ar le croifement des folives, font donc
ce que nous appelons caiffons. { Voyez ce mot. )
Et de fait, ces creux offrent affez l’idée d’une
caiffe , vue fans fon couvercle. Nous avons déjà
fait voir, & nous ne répétons pas ic i, que les
caiffons, dans l’architeêlure, furent un de ces ornemens
qui, entre beaucoup d’autres, furent empruntés
au lyftème de la conftruêtion en bois.
Le lacunary ou caiffon, re çu t, dans quelque :
enre de conftru&ion que ce fût, des ornemens ;
e tout genre , dont on a parlé au mot Caisson; !
Nous ne citerons dans cet article que l’ufage qui :
fut fréquent chez les Anciens , d’appliquer la
dorure à cette partie de§ plafond^ , qui le plus
fouvent étoienl en bois , dans les temples fnt'tout.
Luciuç Mummius parojt avoir introduit Je pro-*
mier 1 ufage de dorer les lacunaria y lorfqu’après
Ja prife dé Corinthe , il fit dorer le plafond du
temple de Jupiter Capitolin. Cette magnificence
fut bientôt imitée par des particuliers dans leurs
tnaifons. Ç’eft ainfi que pour vanter la fimplicité
ide fa maifon , Horace dit qu’on ne voit chez lui
b r ille r , ni l’ivoire , ni l’or dans les lacunar de
fon habitation. Non ebpr rieque aureum meâ
j-enidet in domo lacunar.
Nous ayons d it, au commencement de cet article,
que le mot laquear oit avoir eu une étymo-
Jogie commune avec le mot lacunar. I l èftpofiible
toutefois que provenant du mot laqueusy ce terme
qui a exprimé la même ckofe, fi l ’on expliau I
laqueus par f l e t réfeau y ait été appliqué aux !
caiffons des plafonds ou des voûtes, parc'e qu’ef I
fe&ivement ils y produifent à l’oeil l’effet d’uni
ré 1 eau. ( Voyez L aquear. )
Dans tous les cas, nous répétons que ces deux
mots ont été mal traduits par le mot lambris I
qu’ont employé tous les interprètes , lorlqu’ilgl
ont eu à expliquer laqueana e x auro. Des lam-I
bris dorés peuvent être appliqués aux murs , aux!
appuis des revêtemens dont on orne l’intérieurI
des appartemens , & cette locution poétique peutI
très-bien convenir aux ufages modernes. Mais I
lorfqu’on trouve les mots lacunaria aurata I
laquearïa e x auro y dans les auteurs anciens il ;
nous paroit qu’il faut traduire : plafonds dorés I
voûtés ornées d’ or. — Voilà pour le tradu&eur I
qui ne doit pas employer les mots techniques.
Quant à l’archite&e , il traduira toujours pari
caiffons y ornés de rofaces dorées.
L A IT , f. m. Des expériences faites depuis I
quelques années, ont prouvé que le lait y mêlé I
avec de la chaux & du blanc d’Efpagne, pou-1
voit être employé en place de la colle, pour rece-1
voir les fubftances qoloranlés deftinées à peindre J
les murs des maifons, les lambris des apparte-|
mens, &c. On favoit déjà que les Indiens fefer-1
vent du lait pour délayer les coulèurs dont ils I
enduifent les parois de leurs cabanes. Peut-être I
cette notion a-t-elle donné lieu aux expériences I
nouvelles dont on vient de parler.
Voici comment-s’opère le mélange, que le I
peintre en bâtiment peut employer, au lieu de I
l’encollage habituel.
Ou met la chaux dans un vafé de grès 5 on I
vèrfe deffus une portion de lait fuffifante pour I
en faire une bouillie claii-e. On ajoute peu à peu I
de l’huile d’oeillet, ou de lin, ou de noix,!
indifféremment, ayant foin de remuer le tout I
avec une fpatule de bois : on verfe le furplus I
du lait y enfin, on y délaie du blanc d’Efpagne. I
Toutes ces fubftances doivent s’y trouver mêlées
félon la proportion de l’efpace à' peindre. Ce I
mélange fe colore, enfui te , foit avec du charbon
broyé à l’eau, foit avec des ocres jaunes , de la I
manière dont on le fait à la détrempe. L’ufage I
feul prouvera fi la colle de laity deftinée à donner I
du corps à la couleur, l’emporte fur la colle a ni- I
maie 5 & l’économie , s’il y e n a dans le procédé I
nouveau, parviendra à le rendre ufiiel
L ait de chaux. ( Conjlruâtion. ) On appelle j
ainfi de la chaux délayée avec de l’eau, dont on I
fe fert pour blanchir les murs , les plafonds, &x, j
La chaux, ainfi délayée, reffemble à du lait
Ç’eft ce qui à fait appeler ainfi cet enduit, qu’on
appelle auffi laitance,
LAIT^ERJE j f. L C’e ft, dans une ferme ou une
maifon j
de campagne, un petit local a rez-de-
Ë m Ë un petit bâtiment, où on conlervc
f ia i t où ou bat le beurre , où l’on fart les
B H Ce local doit être frais I & être expo e
011cimltmi't de manière à ne point recevoir le
foleil. !.. 1 . ,
.Dans les maifons de campagne des gens riches ,
; le plaifent aux occupations rulliques ,• on
? :t de la laiterie une pièce d’agrément ; ou en
'«vêt les murs avec goût, on y de?, paremeas
de marbre , on y diftribae des lièges, des
„blés où l’on fert des collations; on y ménagé
impieues fontaines & des bottillons d eau , qui ,
dansleichalears , ajoutent à la.fraiclièiïr du lieu. ;
Une laiterie ainfi. conflxuite peut devenir un
ouvrage d’a r c h i t e f lu r e & le .goût qui y préfide
fait tirer parti des objets les plus urdinairos pour
en faire un ornement agréable. Ainfi on y place,
laiiîoiir des murs, de quoi recevoir, dans un bel
f ordre, desL vafes de vei yê ou de porcelaine remplis.
de. lait.
L’ouvrage en ce genre le plus remarquable
qu’on p.iiffe citer, ett la laiterie .du cliâleau foyal
de Rambouillet , conftruife par Louis X V I , qui ]
fe plaifoit à ces détails! champêtres, ll ’éditice eft
bâti de pierres de grès, en forme de rotonde. ',
Un lbùrce d’eau vive y eft reçue dans un baffin ,
Si ce baffin étoit orné de la figlire d’une berbère
€11 marbre accompagnée d’une chèvre quelle
conduit boire à la fontaine. La bèrgère étoit
cenfée auffi vouloir s’y baigner, ce qu’indiquoit
l’aftion. de, fon pied qui s’approchoit de leau.
Cette fi »ure , qui le voit aujourd hui dans la ga-,
le rie du Luxembourg, eft le meilleur ouvrage de
Julien., qui fit encore autour des murs de la lai-
taie de Rambouillet, des bas-reliefs en marbre,
repréfentant tout ce qui à rapport aux travaux St
aux foins d’une laiterie.
LÂMBARDO (Carlo), avchile&e, né en i 55c),
mort en 1620, d’une famille noble d Arezzo , tut
employé dans [’architecture- civile,& militaire.
Il reftaura à Rome , pour la famille V ite lli, ce
joli petit palais , aujourd’hui appartenant a la
maifon Painphdi , 8c. qui eft lime au-deff s de
Monte magnanapoli, en face de i égaie de Saint-
Doiniuique 8c Sixte.
Il fit, au Campo Vaccino , la façade de Santa-
Francefea roman a , avec un portique , en dedans
d’ordre compofite , 8t eu dehors d’ordre dorique , ;
interrompu par des pilaftres corinthiens élevés
fur des prédeftanx très-hauts , compétition qui
manque d’unité, fans êtve.tout-à-fait condamnable.
Lambardo donna les deifins d’une villa, hors
de la porte de! Popolo , à Rome , pour le cardinal
Giuftiniaui, & dont il ne relie plus que la
grande port e. ornée de colonnes ioniques.
On a de- lui un petit ouvrage , imprime en
Diction. dlArchit. Tome II.
1601 , fur les eau Tes des inondations du. l i b r e , 8c
fur les moyens d’en prévenir les dangers.
( Article traduit de Mihzia- )
LAMBOURDE f. f- Pièce de bois de feiage ,
comme un chevron , ou même comme une lolive #
qu’on couche 8c qu’on fcelle diagonalemenl a
augèt» avec plâtre & plâtras, fur un plancher,
pour7 attacher du parquet. ou carrément pour
y clouer des ais. On met entre les lambouïdes,
Voit du noujfier de charbon de terre, foit meme
i des cailloux, fi l’on établit le parquet à rez-cle-
chauffée , pour empêcher Faction de 1 humidité
fur le bois.
L ambourde. ( Voyez Pierre de lambourde. )
LAMBOURDES, f. f. p i Pièces de bois qui
font à côté des poutres , & ou il y a des entailles
pour y . appuyer des folives. • j
O11 appelle encore lambourdes 9 des pièces de
bois qu’on met le long d’un mur mitoyen, pour
porter les folives, & qui font l'outenues par des
corbeaux de ter.
! LAMBRIS, f. m. Quelques étymologiftes pen-
I fent que ce mot vient du mot latin anibricesy
qu’on traduit par lattes. - .
Dans la maçonnerie, on appelle effeôtivemenfc
lambris y un enduit de plâtre lur des^ lattes jointives
, clouées fur les bois des cloifons ou les
foli ves des plafonds. /
Le mol .lambris eft devenu plus général, & ü
fionifie, le plus fouvent, un revêtement de quelque
matière que ce fo it , & de différentes Jiau-
I teurs, félon l’emploi qu’on en veut faire.
On’ fait des lambris en marbre St par comparera
ens , de diverfes formes 8t. couleurs, (les lambris
font ou arraies, où avec des faillies St des
moulures. . • -
Les lambris fe font le plus, fouvent en mcniu-
I ferie. ïls côufiftenl en affemblages par panneaux,
mont ans, ou pilallresde différensbois, dont on
couvre en tout ou en partie les murs des appartemens.
On fait trois claffes de lambris.
Les lambris d’ appui. Ce font Ceux qui n’ont
que deux à trois pieds de hauteur , dans le pourtour
d’une pièce 8t dans les embrâlurés des
croi fçes. : v' .
Les lambris de demi-revêtement font ceux qui
né paffent pas la hauteur d’un at tique de cheminée
(comme cela fe pratiquoit autrefois). L elpace
fupérieur fe met toit en tapiffene.
Les .lambris de revêtement. On appelle ainfi
ceux qui s’élèvent dans toute la hauteur d une
pièce , 8t en garmllent tous les murs.
L ambris de plafpnd. Comme on applique auffi
la uienuitérie; au revêtement des- platonds , en
H h h h