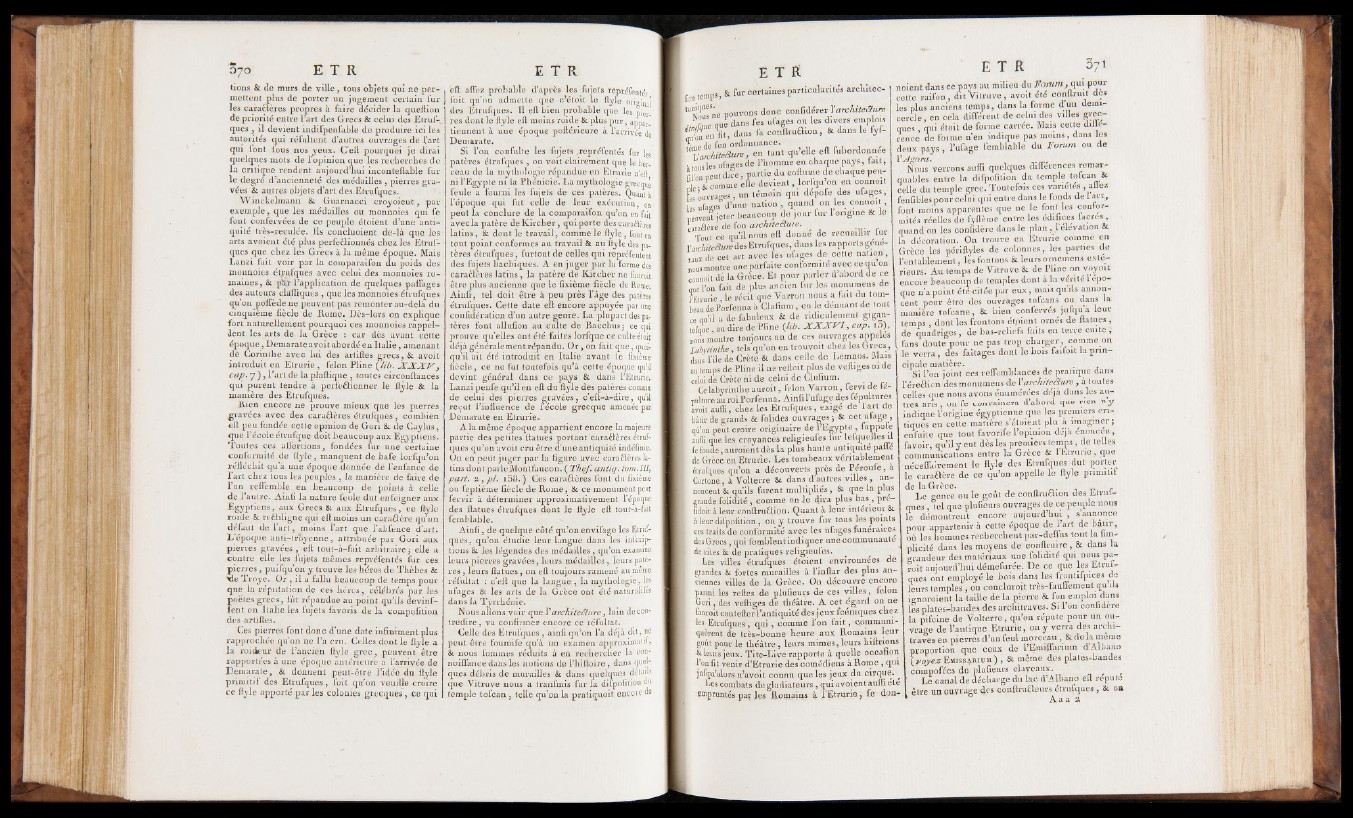
tions & de murs de v ille , tous objets qui ne permettent
plus de porter un jugement certain fur
les caractères propres à faire décider la queftion
de priorité entre Part des Grecs & celui des Etruf-„
ques j il devient indifpenfable de produire ioi les
autorités qui rélultent d’autres ouvrages de l’art
qui font fous nos yeux. C’eft pourquoi je dirai
quelques mots de l’opinion que les recherches de
la critique rendent aujourd’hui inconteftable fur
le degré d’ancienneté des médailles , pierres gravées
& autres objets d’art des Etrufques.
Winckelmann & Guarnacci ‘ croy oient , par
exemple, que les médailles ou monnoies qui le
font conlervées de ce peuple étoient d’une antiquité
très-reculée. Ils concluoient de-là que les
arts avoient été plus perfectionnés chez, les Etrul-
ques que chez les Grecs à la même époque. Mais
Lanzi fait voir par la comparaifon du poids des
monnoies étrufques avec celui des monnoies romaines,
& pli* l ’application de quelques paffages
des auteurs clàfîiques , que les monnoies étrufques
qu’on pofiedéne peuvent pas remonter au-delà du
cinquième fiècle de Rome. Dès—lors on explique
fort naturellement pourquoi ces monnoies rappellen
t les^rts de la Grèce : car dès avant cette
époque, Demarale avoit abordé en Italie, amenant
de Corinthe avec lui des artiftes grecs, & avoit
introduit en Elrurie , félon Pline {lib. 3
cap. 7 ) , l ’art de la plaftique , toutes circonftances
qui purent tendre à perfectionner le ftyle & la
manière des Etrufques.
Rien encore ne prouve mieux que les pierres,
gravées avec des caraCtères étrufques, combien
elt peu fondée cette opinion de Gori & de Gaylus,
que l’école étvufque doit beaucoup aux Egyptiens.
Toutes ces all'ertions, fondées fur une certaine
conformité de ftyle, manquent de bafe lorlqu’ on
réfléchit qu’à une époque donnée de l’enfance de
l ’art chez tous les peuples , la manière de faire de
l’un reiïèmble. en beaucoup de points à celle
de l’autre. Ainfi la nature feule dut enfeigner aux
Egyptiens, aux Grecs & aux Etrufques, ce lfyle
roide &. reCtiligne qui eft moins un caraCtère qu’un
défaut de l’art, moins l’art que l’abfence d’art.
L ’époque anti-lrbygnne, attribuée par Gori aux
pierres gravées , eft tout-à-fait arbitraire 5 elle a
xbnlre elle les iujets mêmes repréfentés fur ces
pierres, puilqu’on y trouve les-héros de Thèbes &
vie Troye. Or , il a fallu beaucoup de temps pour
que la réputation de ces héros, célébrés par les
poètes grecs, fût répandue au point qu’ils devinf-
ïent en Italie les Iujets favoris de la compofition
des artiftes.
Ces pierres font donc d’une date infiniment plus
rapprochée qu’on ne l ’a cru. Celles dont le ftyle a
la roideur de l ’ancien ftyle g re c , peuvent être
rapportées à une époque antérieure à l’arrivée de
Demarale, & donnent peut-être l ’idée du ftyle !
primitif des Etrufques, l’oit qu’on veuille croire !
ce ftyle apporté par les colonies grecques, ce qui j
eft afîez probable d’après les fujets repréfentés
foit qu’on admette que c’étoit le ftyle ongin.,|
des Etrufques. Il eft bien probable que les pier„
res dont le ftyle eft moins roide & plus pur, appaN
tiennent à une époque poftérieure à l’arrivée de
Demarate.
Si l’on confulte les fujets ..repréfentés fur ]es
patères étrufques , on voit clairement que le berceau
de la mythologie répandue en Etrurie n’eft
ni l’Egypte ni la Phénicie. La mythologie grecque
feule a fourni les fujets de ces patères. Qnantà.
l ’époque qui fut celle de leur exécution, ou
peut la conclure de la comparaifon qu’on en fait
avec la patère deKircher, qui porte des caraftèrej
latins, & dont le travail, comme le ftyle, font eu
tout point conformes au travail & au ftyle des patères
étrufques, furtoulde celles qui repré (entent
des fujets bachiques. A en juger par la forme des
caractères latins, la patère de Kircher ne fuuroit
être plus ancienne que le fixième fiècle de Rome,
Ainfi, tel doit être à peu près l’âge des patères
étrufques. Cette date eft encore appuyée par une
confidération d’un autre genre. La plupart des patères
font allufion au culte de Bacchusj ce qui
prouve qu’elles ont été faites lorl’que ce culte étoit
déjà généralement répandu. O r , on lait que, quoiqu’il
ait été introduit en Italie avant le fixième
fiècle, ce ne fut toutefois qu’à cette époque qu’il
devint général, dans ce pays & dans l’Etrurie..
Lanzi penl’e qu’il en eft du ftyle des patères commû,
de celui des pierres gravées, c’eft-à-dire, qu’il
reçut l’influence de 1 école grecque amenée par
Demarate en Etrurie-
A la même époque appartient encore la majeure
partie des petites ftatues portant caraCtères étrufques
qu’on avoit cru être d’une antiquité indéfinie.
Un en peut juger par la figure avec caraCtères latins
dont parle Montfaucon. ( TJieJ'. antiq. tom. III,
part. 2,, pi. 15Ö. ) Ces caraCtères l’ont du fixième
ou feptième fiècle de Rome, & ce monument peut
fervir à déterminer approximativement l’époque
des ftatues étrufques dont le ftyle eft tout-à-fait
femblable.
Ainfi, de quelque côté qu’on envifage les Elruf-
ques. qu’on étudie leur langue dans les infcrip-
tions & les légendes des médailles, qu’on examine
leurs pierres gravées, leurs médailles , leurs patères
, leurs ftatues, on eft toujours ramené au meme
réfui ta t : c’elt que la langue , la mythologie, les
ufages & les arts de la Grèce ont été naturalifés
dans la Tyrrjiénie.
Nous allons voir que V architecture , loin de contredire
, va confirmer encore ce réfultat.
Celle des Etrufques , ainfi qu’on l’a déjà dit, ne
peut être foumife qu’à un examen approximatif,
& nous l’ommes réduits à en rechercher la con-
noiffance dans les notions de l’hiftoire, dans quelques
débris de murailles & dans quelques détails
que Vitruve nous a lranfmis fur la difpofition du
temple toi’can , tç|le qu’on la pratiquait encore ue
| f ie,nps, & fur certaines particularités archilec- |
[toniques. ons donc conGdérer \architéOure
! mW „„P dans fes ufages ou les divers emplois
dans 1 conlfrnUion > & dans Ie
H. „ Ac (nu ordonnance.
\ Uwhiteéturv, en tant qu’elle eft fubordonnée
i, ies ufaves de l’bomme en chaque pays, tait,
Ü B deut direI partie dn coftume de chaque peu-
I I & comme elle devient, lorfqn’on en connoit
F ouvrages, un témoin qui dépofe des ulages,
Ips ufases d’une nation, quand on les connmt,
Lemrent jeter beaucoup de jour fur l’origine &. le
(cavalière de fon architecture.
Tout ce qu’il nous eft donné de recueillir tur
VmhitefluK des Etrufques, dans les rapports géné-
Iraux de cet art avec les ufages de cette natiojf,
montre une parfaite conformité avec ce qn on
coatioit dé la Grèce. Et pour parler d abord de ce
nnèl’on fait de plus ancien fur les monumens de
l’Ëlrnrie H récit que.Varron nous a lait du tombeau
de Porfenna à Clufium, en le dénuant de tout
ce au’il a de fabuleux & de ridiculement gigan-
tefcrae, au dire de Pline SÊÊ X X X V I , cap. \S),
xous montre toujours un de ces ouvrages appelés
labyrinthe, tels qn’ori en tronvoit cliez les Grecs,
dans nie de Crète & dans celle de Lemnos. Mais
au temps de Pline il ne'rèftoit plus de velligesnide
(celui dé Crète ni de celui de Clufium.
Gë-labyrintbe auroit, félon Varron, fervi de le-
pulture auroiPorl'enna. Ainfil’ufage des fépnltures
avoit auffi, chez les Etrufquesexigé de la rt de
bâtir de grands & folides ouvrages ; & cet uiage ,
qu’on peut croire originaire de l ’Egypte , inppole
auffi. que les croyances religieufes lur lelquelles il
fe fonde, auroient dès la plus Haute antiquité pané
de Grèce en Etrurie. Les tombeaux véritablement
étrufques qu’on a découverts près de Péroufe, a
Cortone, à Volterre 8t dans d autres villes , annoncent
& qu’ils furent multipliés j & que la plus
grande folidité , comme on le dira plus bas, pré- :
lidoit à leur conftruâion. Quant à leur intérieur &
à leur difpofition, 011 y trouve fur tous les points
ces traits de conformité avec les ufages funéraires
des Grecs, qui femblent indiquer une communauté
de rites & de pratiques religieufes.
Les villes etrufques étoient environnées de
grandes & fortes murailles à l’inftar des plus anciennes
villes de la Grèce. On découvre encore
parmi les reftes de plufieurs de ces villes , félon
Gori, des veftiges de théâtre. A cet égard on ne
fauroit contefter l’antiquité des jeux fceniques chez
les Etrufques, qui , comme l’on fa it , communiquèrent
de très-bonne heure aux Romains leur
goût pour le théâtre, leurs mimes, leurs hiftrions
& leurs jeux. Tite-Live rapporte à quelle oçcafion
l’on fit venir d’Etrurie des comédiens à Rome, qui
jufqu’alors n’avoit connu que les jeux du cirque.
Les combats de gladiateurs , qui avoient auiïi été
empruntés par les Romains à. l’Etrurie, fe donnoient
dans ce pays au milieu du Forum y qui pour
cette raifon, dit Vitruve , avoit été conllruit des
les plus anciens temps, dans la forme d’un demi-
cercle, en cela différent de celui des villes gi-ec-
ques , qui étoit de forme carrée. Mais cette différence
de forme n’en indique pas moins, dans les
deux pays, l’ufage femblable du Forum ou de
l’Agora.
Nous verrons auffi quelques différences remarquables
entre la difpofition du temple tofcan Bt
celle du temple grec. Toutefois ces variétés , allez
feu fi blés pour celai qui entre dans le fonds de I art.,
font moins apparentes que ne le font les conformités
réelles de fyftème entre les édifices facres ,
quand on les coniidère dans le plan, j élévation 8t
la décoration. On trouve en Etrurie comme en
Grèce les périftyles de colonnes, les parties de
l’entablement j les fontons & leurs ornemens extérieurs.
Au temps de Vitruve & de Pline on voyoït
encore beaucoup de temples dont à la vérité 1 époque
n’a point été citée par eux , mais quils annoncent
pour être des ouvrages tofcans ou dans la
manière tofcane, & bien confervés jufqu à leur
temps , dont les frontons étoient ornés de ftatues ,
de quadriges, de bas-reliefs faits en terre cuite ,
fans doute pour ne pas trop charger, comme on
le verra, des faîtages dont le bois faifoit la principale
matière. .
Si l ’on joint ces reffembiances de pratique dans
l’éreâion des monumens de l'architecture } à toutes
celles que nous avons énumérées déjà dans les autres
arts, on fe convaincra d’abord que rien n y
indique l’origine égyptienne que les premiers critiques
en cette matière s etoient plu a imaginer ;
enfuite que tout favorife L’opinion déjà énoncée ,
fa voir, qu’il y eut dès les premiers temps , de telles
communications entre la Grèce & l’E trurie, que
néceflkirement le ftyle des Etrufques dut porter
le caractère de ce qu’on appelle le ftyle primitif
de la Grèce. _
Le genre ou le goût de conftruthon des Rtrul-
ques , tel que plufieurs ouvrages de ce peuple nous
le démontrent encore aujourd’hui , s’annonce
pour appartenir à cette époque de l’art de bâtir,
où les hommes recherchent par-deffus tout la üm-
plicité dans les moyens de conftruire, & dans la
grandeur des matériaux une folidité qui nous -pa-
voit aujourd’hui démefurée. De ce que les Etrufques
ont employé le bois dans les fjronufpices de
leurs temple? , on concluroit très-faulTement qu ils
ignoroient la taille de la pierre &. fon emploi dans
les plates-bandes des architraves. Si l’on confidère
la pifeine de Volterre, qu’on réputé pour uu ouvrage
de l ’antique Etrurie, on y verra des architraves
en pierres d’un feul morceau, Sc de la meme
proportion que ceux de rEmiffarium d’Albano
{payez Emiss^riüm) , &. même des plates-bandes
compofées de plufieurs dayeaux.
1 Le canal de décharge du lac d’Albano eft réputé
être un ouvrage dos conftruêleurs étruiques , & oa
A a a %