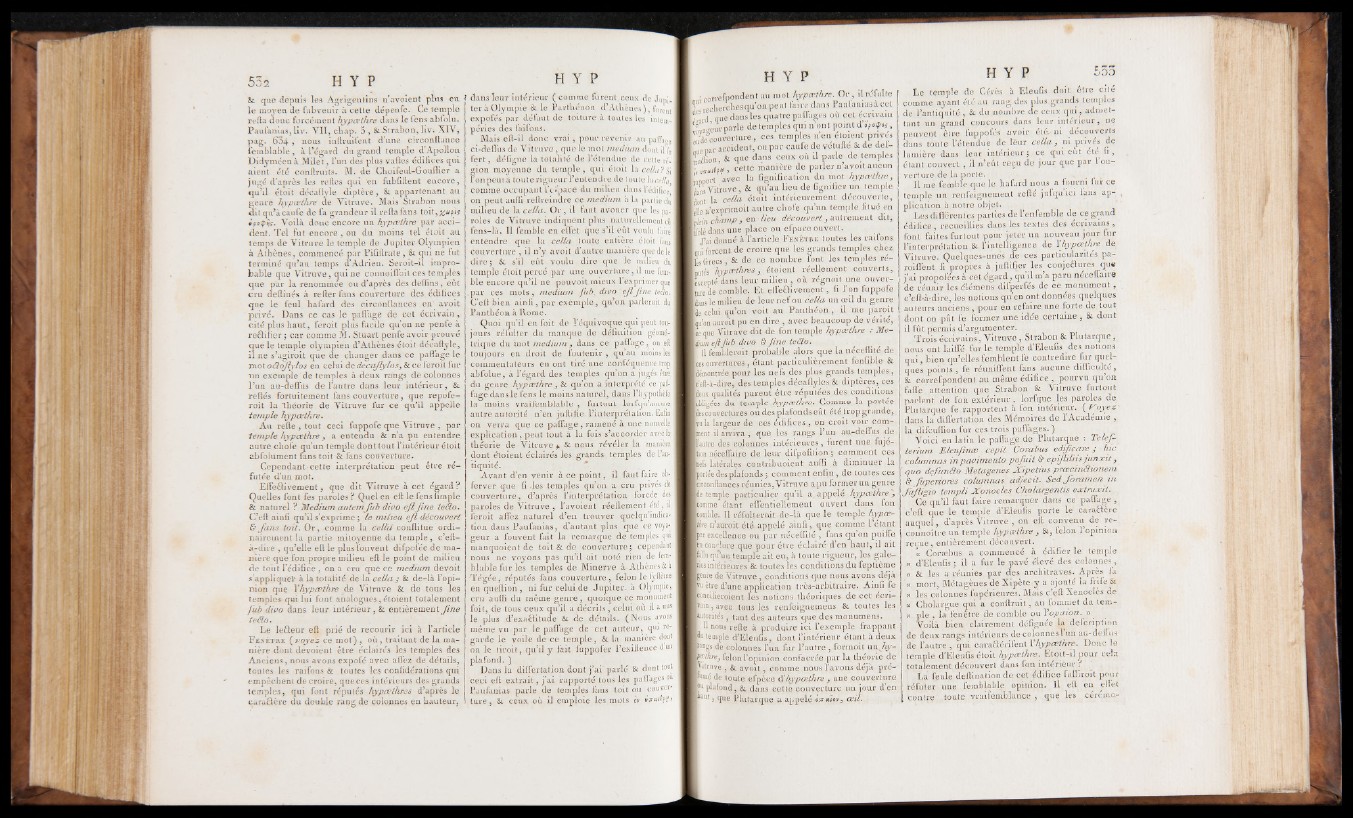
5 3 s H Y P
8c que depuis les Àgrigèntins n’avoient plus eu
le moyen de fubvenir à cette dépenfe. Ce temple
refta donc forcément hypoethre dans le fens abfolu.
PaufaniaSjliv. VII, cliap. 5 ,8c Strabon, liv. XIV,
pag. 634 j nous mlimitent d’une circonftance
ieinblable , à l’égard du grand temple d’Apollon
Didyméen à Milet, l’un des plus valtes édifices qui
aient été conftruits. M. de Ghoil’eul-Gouffier a
jugé d’après les reftes qui en fub liftent encore,
qu’il étoit décaftyle diptère, 8c appartenant au
genre hypoethre de Vitruve. Mais Strabon nous
dit qu’àcaufe de fa grandeur il refta fans toit,^«p'/?
èpo<p>js. Voilà doue encore un hypoethre par accident.
Tel fut encore , ou du moins tel étoit au
temps de Vitruve le temple de Jupiter Olympien
à Athènes, commencé par Pififtrale, & qui ne fut
terminé qu’au temps d’Adrien. Seroit-il improbable
que Vitruve, qui ne connoiflbitces templès
que par la renommée ou d’après dès de (lins, eût
cru deftinés à relier fans couverture des édifices
que le feul ha fard des circonftances en avoit
privé. Dans ce cas le paffage de cet écrivain,
cité plus haut, fer oit plus facile qu’on ne penfe à
reâifier $ car comme M. Stuart penfe avoir prouvé
que le temple olympien d’Athènes étoit décaftyle,
il ne s’agiroit que de changer dans ce paflage le
mot octojlylos en celui de decuflylos, & ce feroit fur
un exemple de temples à deux rangs de colonnes
l ’un au-defliis de l’autre dans leur intérieur, &
reliés fortuitement fans couverture, que repofe-
roit la théorie de Vitruve fur ce qu’il appelle
temple hypoethre.
An relie, tout ceci fuppofe que Vitruve , par
temple hypoethre, a entendu & n’a pu entendre
autre choie qu’un temple dont tout l’intérieur étoit
abfolument fans toit & fans couverture.
Cependant-cette interprétation peut être réfutée
d’un mot.
Effectivement, que dit Vitruve à cet égard ?
Quelles font fes paroles ? Quel en ell le fenslimple
& naturel ? Medium auterriJub divo e jljin e te cto.
C’ elt amfi qu’il s’exprime ; le milieu ejt découvert
& Jans toit. O r , , comme la cellU conllitue ordinairement
la partie mitoyenne du temple, c’ell-
à-dire , qu’elle eft le plusfouvent difpolee de manière
que fon-, propre milieu eft le point de milieu
de tout l ’édifice, on a cru que ce medium devoit
s'applique!" à la totalité de la ceUa y & de-là l’opinion
quç Yhypoethre de Vitruve 8c de tous les
temples qui lui font analogues, étoient totalement
Jub divo dans leur intérieur, & énlièrementyme
teâlo.
Le leéleur eft prié de recourir ici à l’article
Fenétke {voyez ce mot) , où , traitant de la manière
dont dévoient être éclairés les temples des
Anciens, nous avons expofé avec allez de détails,
toutes les raifons 8c toutes les c.onfidérations qui
empêchent de croire, que ces intérieurs des grands
temples, qui font réputés hypoethres d’après le
caractère du double rang de colonnes en hauteur,
H Y P
l dans leur intérieur ( comme furent,ceux de JupiJ
ter à Olympie 8c le Parthénon d’Athènes), furent I
expofés par défaut de toiture à toutes les intempéries
des fai fous.
Mais eft-il donc v rai, pour revenir au paflage
ci-delfus de Vitruve, que le mot medium dont ilfe
fe r t, défigne la totalité de l’étendue de cette région
moyenne du temple , qui étoit lace//«?Si|
fonpeutà toute rigueur l’entendre de toute la cella
comme occupant l’cîpacé du milieu dans l’édifice I
on peut aulïi reftreindre ce medium à la partie du I
milieu de la cella. Or , il faut avouer que les pa-1
rôles de Vitruve indiquent plus naturellement cS I
fens-là. Il femble en effet que s’il eût voulu faire I
entendre que la cella toute entière étoit fans I
couverture , il n’y avoit d’autre manière, que de le I
dire $ & s’il eût voulu dire que le milieu du I
temple étoit percé par une ouverture, il me feui-1
ble encore qu’il ne pouvoit mieux l’exprimer que I
.par ces mots, medium Jub, divo ejljine teèo. I
C’eft bien ainfi, par exemple, qu’on parlèrent du]
Panthéon à Rome.
Quoi qu’il en foit de l’équivoque qui peut tou- 1
jours réfulter du manque de définition géométrique
du mot medium , dans ce paflage, on eft j
toujours en droit de foutenir , qu’au moins les J
commentateurs en ont tiré une conféquence trop I
abfolue, à l’égard des temples qu’on a .jugés être ]
du genre hypoethre , & qu’on a interprété ce pal-1
fage dans le fens le moins naturel, dans l’hypolhèle |
la moins vraifemblable , furtout lorfqu’aucune |
autre autorité n’en juftifie l ’interprétation. Enfin j
on verra que ce paflage , ramené à une,nouvelle ]
explication , peut tout à la fois s’accorder avec la
théorie de Vitruve ^ 8c nous révéler la maniéré]
dont étoient éclairés les grands temples de l’antiquité.
|
Avant d’en venir à ce point, il faut faire ob-
ferver que fi des temples qu’en a cru privés de
couverture, d’après l’interprétation forcée des
paroles de Vitruve , l’avoient réellement été, il I
feroit affez naturel d’en trouver quelqu’indica-
tion dans Paufanias, d’autant plus que ce voyageur
a fouvent fait la remarque de temples qui
manquoient de toit 8c de couverture j cependant
nous ne voyons pas qu’il ait noté rien de leni-
blable fur les temples de Minerve à..Athènes & a
Tégée, réputés fans couverture, félon le lyftenie
en queftion , ni fur celui de Jupiter- a Olympie,
cru aufli du même genre , quoique ce monument
foit, de tous ceux qu’il a décrits, celui où il amis
le plus d’exactitude 8c de détails. (Nous avons
même vu par le paflage de cet auteur, qiu regarde
le voile de ce temple, 8c la manière dont
on le tiroit, qu’il y fait fuppofer l ’exillence d an
plafond. ) . .
Dans la dilfertation dont j’ai' parlé 8c dont tout,
ceci eft extrait, j’ai rapporté tous les p a fl âges ou
Paufanias parle de temples fans toit ou cou voiture
, 8c ceux ou il emploie les mots a «ifra/fy?»
H Y P
• correspondent au mot hypoethre. O r , il refaite
f recherches qu’on peut faire clans Paufanias à cet
P I que dans les quatre paffages où cet écrivain
^ valeur parle de temples qui n’ont point
U de couverture, ces temples n’en étoient privés
0 r accident, où par caufe de vétufté 8c de def-
tEuon, 8c que dans ceux où il parle de temples
5 cette manière de parler n’avoit aucun
P’ rt avec la fignification du mot hypoethre,
Hans Vitruve, 8c qu’au lieu de fignifier un temple
[dont la cella étoit intérieurement découverte,
felle û’exprimoit autre chofe qu’un temple fitué en
Llein champ, en-lieu découvert, autrement dit,
Ifolé dans une place f ou efpace ouvert, J ’a i donné à l’article F e n ê t r e toutes les raifops
foui forcent.de croire que les grands temples chez
Iles Grecs, 8c de ce nombre l’ont les temples ré-
[putés "hypoethresy.étoient réellement couverts,
excepté dans leur milieu , où régnoit une ouverture
dè comble. Et effectivement, fi- l’on fuppofe
(daus le milieu de leur nef ou cella un oeil du genre
|de celui qu’on voit au Panthéon , il me paroit 1
[qu’on auroit pu en dire , avec beaucoup de vérité,
Le que Vitruve dit de fon temple hypoethre : Me-
Mumeflfub divo & fine tecto.
| 11 femble roit probable alors que la née édité de
Les ouvertures;, étant particulièrement fenfible 8c
[démontrée pour les nefs des plus grands temples-,
lc’eft-à-dire, des temples décaftyles 8c diptères, ces
deux qualités purent être réputées des conditions
obligées du temple hypoethre. Comme la portée
[descouvertures ou des plafonds eût été. trop grande,,.
hula largeur de cës édifices^ on croit voir comment
il arriva , que les rangs l’un au-delfus de
l’autre des colonnes intérieures, furent une fujé-,
lion néceffaire de leur difpofilion $ comment ces
nefs latérales cou tribu oient aulïi à diminuer la
portée des piaf onds y comment enfin, de toutes ces
circonftances réunies, Vitruve a pu former un genre
[de temple particulier qu’il a ‘ appelé hypoethre ,
comme étant eflbntiellement ouvert dans fon
"omble. -Il réfultéroit de-là que le temple hypoe-
ihre n’auroit été. appelé ainfi, que comme l ’étant
par excellence ou par néceffilé , fans qu’on puifl’e
ïn conclure que pour être éclairé d’en haut, il ait
fallu qirun temple ait eu, à toute rigueur, les galeries
intérieures 8c toutes les conditions du feptième
genre de Vitruve, conditions que nous avons déjà
P être d’une application très-arbitraire. Ainfi fe
poncilieroient les notions théoriques de cet écrivain
, avec tous les renfeiguemens 8c toutes les
Autorités , tant des auteurs que des monumens.
[ H nous relie à produire ici l’exemple frappant
F temple d’Eleufis, dont l’intérieur étant à deux
ïangs de colonnes l’un fur l’autre , formoit uu^/îy-
pm/Ân?, félon l’opinion conf a crée par la théorie de
pitruve , 8c avoit, comme nous l’avons déjà pr.é-
jlumé de toute efpèce d’hypoethre , une couverture
jj*u plafond, 8c dans cette couverture un jour d’en
j que Plutarque a appelé eV«*iVv, oeil.
H Y P 335
Le temple de Cérès à Eleufis doit etre cité
comme ayant été au rang des plus grands temples
de l’antiquité, 8c du nombre de ceux qui, admettant
un grand concours dans leur intérieur, ne
peuvent être fuppofes avoir été^ ni découveits
dans toute l ’étendue de leur cella, ni privés de
lumière dans leur intérieur $ ce qui eut été^ f i ,
étant couvert, il n’eût reçu de jour que par l’ouverture
dé la porte. . .
Il mé. femble que le. hafard nous a fourni fur ce
temple un renfeignement relié julquici fans ap- ,
piicalion à notre objet.
Les différentes parties de l’enfemble de ce grand
édifice , recueillies dans les textes des eci’ivains ,
font faites furtout pour jeter un nouveau jour fur
l’interprétation 8c l’intelligence de Yhypoethre de
Vitruve. Quelques-unes de ces particularités pa-
roifî’ent fi propres à juftifier les conjeélures que
j’ai propofées à cet égard, qu’il m’a paru néeefl’aire
de réunir les élémens difperfés de cé monument,
c’eft-à-dire, les notions qu’en ont données quelques
auteurs anciens , pour en refaire une forte de tout
dont, on pût fe former une idée.certaine , 8c dont
il fût permis d’argumenter.
Trois écrivains, Vitruve , Strabon 8c Plutarque,
nous ont laifle fur le temple d’Eleufis des notions
qui, bien qu’elles femblent le contredire fur quelques
points , fe réunifient fans aucune difficulté,
8c correfpondent au même édifice, pourvu qu’on
fafle attention que Strabon 8c Vitruve lurtout
parlent de fon extérieur, lorfque les paroles de
Plutarque fe rapportent à fon intérieur. ( Vyyyez'
dans la diflertation des Mémoires de l’Académie ,
la. difeufiion fur ces trois paffages. )
Voici en latin le paflcige .de Plutarque : TeleJ~
terium Eleujinoe cepit Corabus édifie are y hic
columnas in pavimento pojiiit & epijlilusjunxit,
' quo defuncto Metagenes Xipetius proecinâlionem
& Juperiores columnas adjecit. Sed foramen m
fajUgio templi Xonocles Cholargentis extruxit.
Ce qu’il faut faire remarquer dans ce paffage ,
c ’eft que le temple d Eleufis porte le caraèlere
auquel, d’après Vitruve , on eft convenu de re-,
connoître un temple hypoethre , 8c, félon l’opinion
reçue, entièrement découvert.
« Coræbus a commencé à édifier le temple
» d’Eleufis ; il a fur le pavé élevé des colonnes ,
!» 8c les a-réuniés par des architraves. Après fa
'» mort, Mé ta gènes de Xipète y a ajouté la frife 8c
» les colonnes fupérieures. Mais c’efl Xenoclès de
» Cbolargue qui a co.nftruit, au fommet du lem-
» pie , la fenêtre de comble ou Yopaion. »
Voilà bien clairement défignée la çlefcription
de deux rangs intérieurs de colonnes 1 un au-deflus
de l’autre , qui caraclérifent Yhypoethre. Donc le
temple d’Eleufis étoit hypoethre. Etoit-il pour cela
totalement découvert dans fon intérieurV
La feule deftination de cet édifice fufliroit pour
réfuter une femblable opinion. Il eft en effet
contre toute vrail’emBbuice , que les .cérépio