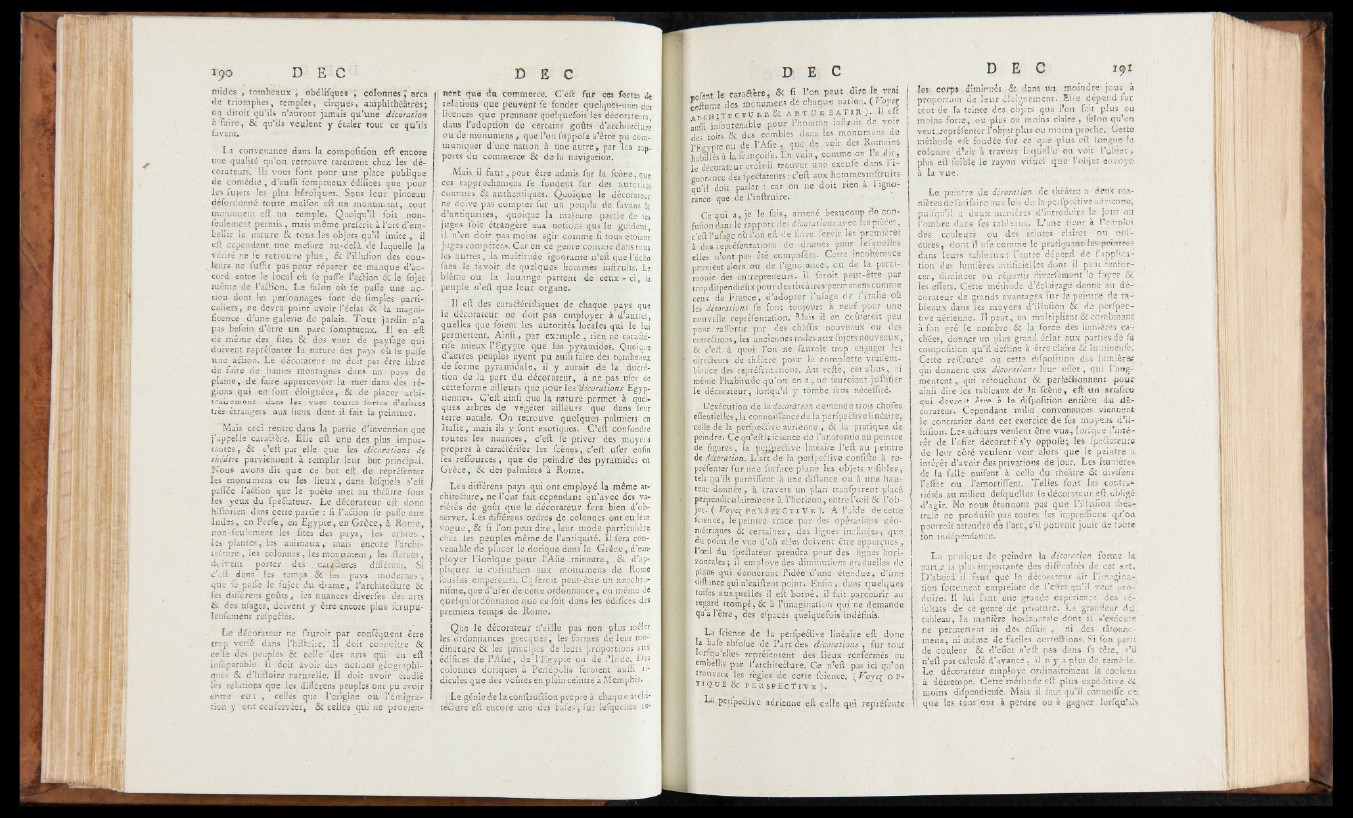
midés s tombeaux ; obélifques ; colonnes J arcs
de triomphes, temples, cirques, amphithéâtres;
on diroit qu’ils n’auront jamais qu’une décoration
â faire, & qu’ils veulent y étaler tout ce qu’ils
favent.
La convenance dans la compofition eft encore
une qualité qu’on retrouve rarement chez les décorateurs.
lis vous font pour une place publique
de comédie , d’aufîi fomptueux édifices que pour
les fujets les plus héroïques.. Sous leur pinceau
défordonné toute maifon eft un monument, tout
rponument eft un temple. Quoiqu’il fait non-
feulement permis , mais même prefcrit à i’art d'embellir
la nature & tous les objets qu’il imite , il
eft cependant une mefure au-delà de laquelle la
vérité r.e fe retrouve plus, & l’iiiufion des couleurs
ne fufRt pas pour réparer ce manque d’accord
entré le local oh fe paffe l’aclion & le fujet
meme de l ’aclion. Le faion oh fe paffe une action
dont les perfonnages font de fimples particuliers,
ne devra point avoir l’éclat &- la magnificence
d’une galerie de palais. Tout jardin n’a
pas befoin d’être un parc fomptueux. Il en eft
de même des fîtes & dés vues de payfage qui
doivent repréfenter la nature des pays ou fe paffe
une aétion. Le décorateur ne doit pas êtr-e libre
de faire de hautes montagnes, dans un pave de
plaine, de faire appercevoir la mer dans des régions
qui en font éloignées, & de placer arbitrairement
dans les vues toutes fortes d’arbres
très-étrangers aux lieux dont il fait la peinture.
Mais ceci rentre dans la partie d’invention que
j appelle caraélèrë. Elle eft une des plus importantes,
& c’eft par elle que les décorations de
théâtre parviennent à remplir leur but principal.
Nous avons dit que ce but eft de repréfenter
les monumens ou les lieux , dans iefqucls s’eft
paffée i ’aétion que le poète met au théâtre fous
les yeux du fpeètateur. Le décorateur- eft donc
hiftorien dans cette partie : fi l’action fe paffe aux
Indes, en Perfe, en Egypte, en Grèce, à Rome,
non-feulement les fites des pays, les arbres ,
les- plantes, les animaux, mais: encore 1’,architecture
, les colonnes, les monumens, les ftatués ,
doivent porter des . carrières diiïérens. Si
c e ft dans les temps & Iss. pays modernes',
que fe paffe le fujet du drame, l’architecture &
fes différens goûts, les nuances diverfes des arts
& des ufages, doivent y être encore plus ferupu-
Jeufement refpeélés.
Le décorateur ne fauroit par conféquent être
trop verfé dans l’hiftôire. Il doit connaître &
celle des peuples & celle 'des arts qui en eft
infèparable. 11 doit avoir- des notions géographiques
& d’hiftoire naturelle. Il doit avoir étudié
les relations que les différens peuples ont pu avoir
entre eux , celles que l'origine ouéd’émipra-
tton y ont confervées, & celles qui ne provien-
I neùt que du commerce. C ’éft fur ces fortes de
■ relations que peuvent fe fonder quelques-unes des
licences que prennent quelquefois les décorateurs
dans l’adoption de certains goûts d’arehkeÊtiîre
ou de monumens, que l ’on fuppofa s’être pu communiquer
d’une nation à une autre, par le s rapports
du commerce & delà navigation.
Mais il fa u t , pour être admis fur la fcène,que
ces rapproclièmens le fondent fur des autorités
connues Si authentiques, Quoique le décorateur
ne doive pas compter fur un peuple de favâns &
d’antiquaires, quoique la majeure- partie de les
juges ioit étrangère aux notions qui le guident,
il n’en doit pas moins agir comme fi tous étoient
juges compétens. Gar en ce genre comme dans tous
les autrès, la multitude ignorante n’eft que l ’écho
fans le favoir de quelques hommes inftruits. Le
blâme ou la louange partent de ceux - ci, le
peuple n’eft que leur organe.
Il eft des caraélériftiques de chaque pays que
le décorateur ne doit pas employer à d’autres,
quelles que foient les autorités locales qui le lui
permettent. Ainfi , par exemple , rien ne carafté-
riie mieux l’Egypte que lès pyramides. Quoique
d’autres peuples ayent pu aufii faire des tombeaux
de forme pyramidale, il y auroit de la diferé-
tion de la part du décorateur, à ne pas ufer de
; cette forme ailleurs que pour les ^décorations Egyptiennes.
G’eft ainfi que la nature permét à quelques
arbres de végéter ailleurs que dans leur
terre natale. On retrouve quelques palmiers en
Italie, mais ils y ,font exotiques. C ’eft confondre
toutes les nuances, c’eft fe priver- des moyens
propres à caraélérifer les fcènes, c’eft ufèr enfin
fes reffources, que de peindre- des pyramides en
Grèce, & des palmiers à Rome.
Les différens pays qui ont employé la même ar-
chiteéluré, ne l’ont fait cependant qu’avec des variétés
de goût que le décorateur fera bien d’ob-
seryer. Les différens ordres de colonnes ont eu, leur
vogue, & fi l’on peut dire, leur mode particulière
chez les peuples même de l’antiquité. Il fera convenable
de placer le dorique, dans la Grèce., d’emr
ployer l ’ionique pour l’Afie mineure, & ,d ’ap-.
pliquêr le Corinthien aux monumens de Rome
fous les empereurs. Ce feroit peut-être un anachro-
nifine, que d’ufer de cette.ordonnance, ou même de
quel qu’ordonnance que cefoit dans les édifices des
premiers temps de Rome.
Que le décorateur n’aille pas non plus'mêler
les ordonnances . grecques, lès formes de leur nio-
dinature & les principes de leurs proportions aux
édifices de l ’Afie, de l’Egyptè ou dé i’inde. Des
colonnes doriques à Perfépolis Teroient aufii ridicules
que des voûtes en plein ceintre à Memphis.
j Le génie de la conffruction propre à chaque arclu-
toékrre eft encore une des bafes, fur lefqueiies
„(sut m caraflère, & fi l’on peut dire le vrai
coftume des ihohumens de chaque n^tmr.,{Poytr
ARCHITECTURE & a ET DE B ATIR j . Il eft
au® infcutenable .pour l’homme, infirme de voir
des toits & des combles dans les monumens de
l-ECTOteou.de l’A fie , que.de.voir des Romains
habilles à la rrançoiie. En vain, comme on 1 a_d;t.,
le décorateur crôit-il trouver une exeufe dans 1 1-
enorance des fpeâateurs : c’eft aux hommesinftruits
qu’il doit parler, : car on ne doit rien à 1 ignorance
que de l ’inftruire.
Ce qui a, je le lais, amené beaucoup de çon-
fufion dans le rapport des dxoratiorisivec les pièces, ■ c’eft l’ufage oü loti eft de faire lervir les .premières
'à des iepréfentations de drames pour lefquelles
elles ifiont pas été compofées- Cette incohérence
provient alors ou de l’ignorance., ou de la parci-,
mor.ie des entrepreneurs. li feroit peut-être par
l trop dispendieux pour des théâtres'permanens comme
ceux de France, d’adopter l ’ufage de l’italie où
les décorations fe font toujours à neuf pour une
! nouvelle repréfentalïpn. Mais il en couteroit peu
[ pour raffortir par des châffis nouveaux ou des
; corrections, les anciennes toiles aux fujet s. nouveaux,'
. & c’eft à quoi l’on ne fauroit trop engager les
; directeurs de théâtre pour la complètte vraifem-
; blabce des- repréfentations. Au refté, cet abus , ni
ï me nie l’habitude qu’on en a , ne' fâuroientjuftifier
le décorateur, loriqu’ il y tombe farfs néceflîte.
L’exécution de la décorât ion demandé trois chofes
eflentielles, la connoiffance de la perfpeétive linéaire,
celle de la perfpeétive aérienne , & la pratique de
peindre. Ce qu’eftlafcience de l’anatomie au peintre
de figures, la peffpeéfive linéaire l ’eft au peintre
de décoration. L’art de la perspective confifte à repréfenter
fur une furface plane les objets vifibles ,
tels qu’ils paroiffent -à une diftance ou à une hauteur
donnée , à travers un plan tranfoarent placé
perpendiculairement à l’horizon, entre l’oe il & l ’objet.
( Voye^ p e r s p e c t i v e ).• A l’aidé de cette
leieneé, le peintre trace par-des opérations " géométriques
& certaines, des lignes inclinées^' que
du point de vue d’ou elles doivent être âpperçues,
l’oeil du fpeétateur prendra pour des lignes horizontales;
il employé des diminutions graduelles de
plans qui donneront l’idée'd’une étendue, d’une
diftiince qui îfexiftent point. Enfin , dans quelques
toifes.auxquelles il eft borné, il fait parcourir au
regard trompé, & à l'imagination qui ne demande
qu a l’être, des efpacès quelquefois indéfinis.
La fcience de la perfpeétive linéaire eft donc
la bafe abfolue de l ’art des décorations , fur tout
lorfqu’elles repréfentent des- lieux renfermés ou
embellis par l’ architeéture. Ce n’eft pas ici qu’on
trouvera les règles de cette fcience. ( Voyè^ o p t
i qu e & p e r s p e c t i v e ). \
La perfpective aérienne eft celle qui repréfente
les corps diminués Si dans un moindre jour à
proportion de leur éloignement. Elle dépend fur
tout de la teinte des objets que l’on fait plus ou
moins forte, ..ou plus ou moins claire , félon qu’on
veut-repréfenter l’objet plus ou moins proche. Cette
méthode eft fondée fur ce que plus eft longue la
colonne d’air à travers laquelle on voit l’ob jet,
plus eft foible le rayon vifuel que l’objet envoyé
a la vue.
Le peintre de décoration de théâtre a deux manières
de tarifaire aux lois de la perfpeénveaérienne»
puifqu’il à deux manières d’introdmre le jour ou
l’ombre dans fes tableaux. L ’une tient à l’emploi
des couleurs ou des teintes claires “ou obi-
cures, dont il ufê comm,e lé ’pratiquent» les-perntre?
dans leurs tableaux; l’autre dépend de l’application
des lumières artificielles dont il peut renforcer,
diminuer ou répartir diverfement le foyer
les effets. Cette méthode d’éclairage donné au décorateur
de. grands avantagés fur le peintre de tableaux
dans les moyens d'itlufion & de perfpective
aérienne. Il peut, en multipliant & combinant
à fon gré le nombre & la force des lumières cachées,
donner un plus grand éclat aux parties de fa
. compofition. qu’il deftine à être claire & iumineufe.
Cette reffourcè ou cette difpofition dus lumières
qui donnent .aux décorations leur- effet, qui l ’augmentent
, qui retouchent & perfectionnent pour
ainfi dire les tableaux de la fcène, eft-un artifice
qui devroit être à la difpofition entière du décorateur.
Cependant mille convenances viennent
le contrarier dans cet exercice de fes moyens d’il-
iufion. Les.a&eurs veulent être vus, iorfque l’intérêt
de l’ effet dé’çoratif s.’y oppofe; les fpeftateurs
de leur coté veulent voir alors que le peintre a
intérêt d'avoir des privations de jour. Les lumières
de la falie nuifent à celle du théâtre & divifent
l’effet ou l’amortiffcnt. Telles font les contrat
viétés au milieu defquelLes le décorateur eft obligé
d’agir. Ne nous étonnons pas que TsiUifion théâtrale
ne produife pas toutes les impreilîcns qu’on
pourroit attendre de i’art, s’il pouvoit jouir de toute
foii indépendance.
La pratique de peindre la décoration forme la;
partie ia oins importante des difh.c.ultés de cet art*
D ’abord il faut que le décorateur ait l’imagination
fortement empreinte de l’effet qu’il veut produire.
Il lui faut une grande expérience des ic-
fiiltats de ce genre de peinture. La grandeur dû
tableau, la manière horizontale dont il s’exécute
ne permettent ni des efiais , ni des tâtonne-
mens, ni même de faciles correâions. Si fon parti
de couleur 6c d’effet n’eft pas dans fa tête, s’il
n’ eft pas calculé d’avance , il n’y a plus de remède.
Le décorateur employa ordinairement là couleur
à détrempe. Cette méthode eft plus expéditive ik
moins difpendieufé. Mais il faut qu’il cor.noilTe ce
que les tpns^ont à perdre ou a gagner îorfqu’ iîs