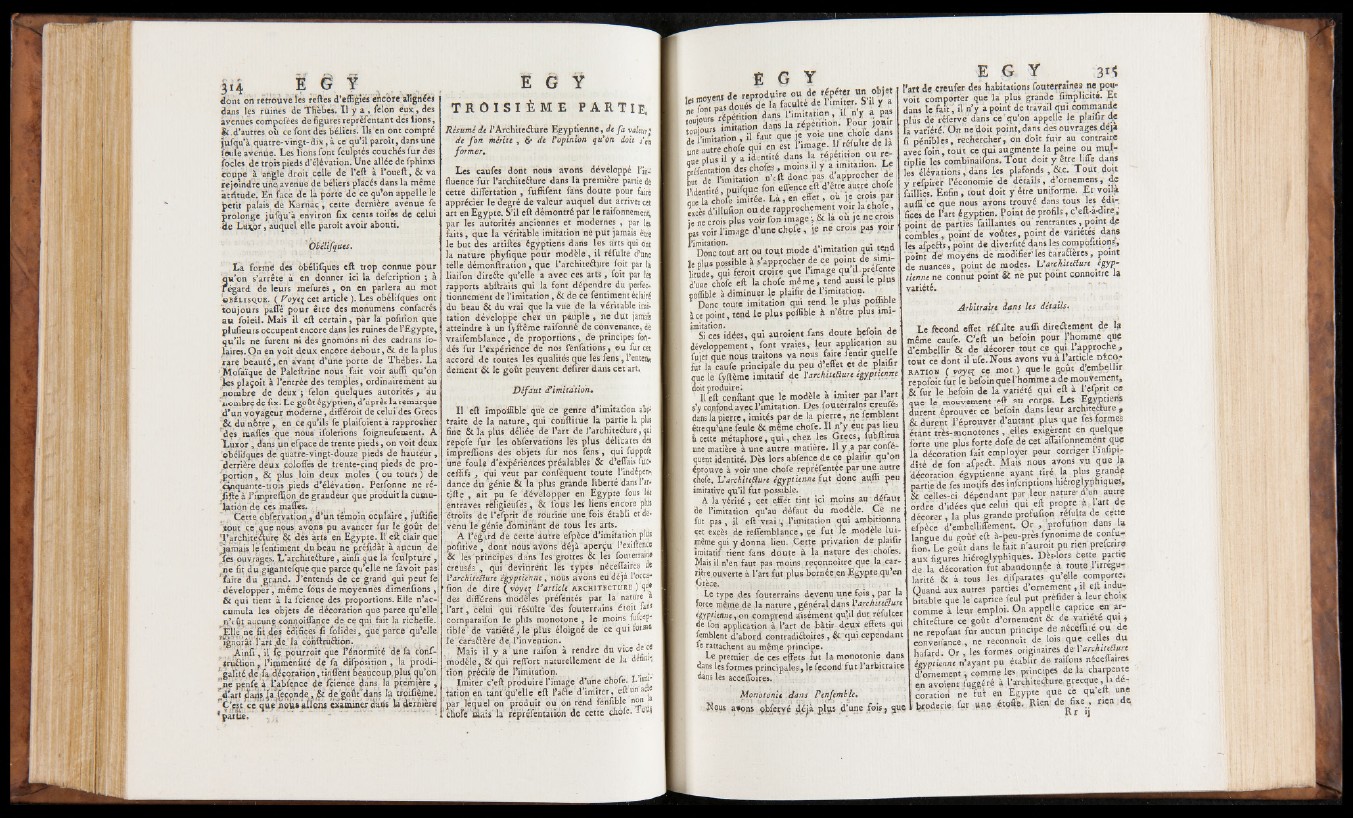
m ï f ? ...
dont oh retrouve les reftes d’effigîes encore, alignées
dans les ruines de Thèmes. Ï1 y à , félon eux, des
avenues compofées de figures repréfentant des lions,
& d’autres où ce font des béliers. Ils en ont compté
jjufqu’à quatre-vingt-dix, à ce qii’il paroit, dans une
foule avenue. Les lions font fculptés couchés fur des
focles de trois pieds d’élévation. Une allée de fphinxs
coupe à angle droit celle de l’eft a i’oueft, & va
rejoindre une avenue de béliers placés dans la meme :
attitude. En face de la porte de ce qu’on appelle le
bètit palais de Karnàc, cette dernière avenue fe
prolonge juîqu’à environ fix cents toifos de celui i
de La\or, auquel elle paroît avoir abouti.
Obélifqucs.
Ë& formé des ôbétifques eft trop connue pour
"u’on s’arrête à en donner ici la defcription $ à
égard de leurs mefures , on en parlera au mot
obélisque. ( Foye{ cet article ). Les obélifques ont
toujours pâlie pour être des monumens confacrés
au foieil. Mais il eft certain, par la pofition que
plufieuis occupent encore dans les ruines de l’Êgypte, |
qu’ils ne furent ni dés gnomons ni des cadrans fo- ;
laircs. On en voit tleux encore debout, & de la plus j
rare beauté , en ayant d’une porte de Thèbes. La !
lilofàïque de Paleftriiie nous fait voir aùffi qu'on ;
les plaçoit à l'entrée des temples, ordinairement au
jiombre de deux j félon quelques autorités, au
iiçmbre de fix. Le goût égyptien, d’après la remarque
d'un voyageur moderne, différoit de celui'des Grecs
du nôtre , en ce .qu’ils fe plaifoient à rapprocher
^des, maffes que nous ifoleriohs foigneufenaent. A
Xùxor, dans un efpace de trente pieds, on voit deux
obélifqups de.quàtrervingt-dbuze pieds de hauteur,
"derrière deux colofies de trente-cinq pieds de proportion,
& plus loin deux inbles ( ou tours ) de
^cviquante-trois pieds d*éléyation. Perfonne ne ré-
jÈfie à\l’fmpréiÇbjn.îde grandeur que produit la cumu-
"Xtiôn f ie 'ç ç s^ lp s . :
te y te çbferyation , d’un témoin ocplairé, juftifie
tout ce',que nousr avons pu avancer fur le goût de-
TarçÎMte&ûre «St rdes artsen. Egypte., Il eftclair que]
jamais leiehtimeht.dii;beau ne. préfidât à aucun de;
jes; > #àn-que la Iculpture ,|
ne fit du,gïgantefque que parce qu'elle ne lavoit pas)
laîre du 'grand. J’entends de ce. grand qui peut fe]
développer,' même fous de moyennes dîmenfions ,j
& qui tient à la fciencp des proportions. Elle n’ac-j
cumula les objets de décoration que parce qu’elle)
n’eût aucunexonnoiffançe de ce qui.fait la ricfielTe.;
tlle'ne fiç &s édifices' fi folides, que parce qu’elle)
* ignqr£t l’art ÿé ï I?.' cohff rùèfibn. . .
Àiqfi , if fë'jpbutroit’ que Pënormité de fa c'qnf--
Ximfion. j'imiqenfité de fa dffpôsitjpn » la prodi-^
égalité.de f%]d^çQration, tinfleni beaucoup, plus, qu’on,
’’ne" fienfe V l ’abfpnce dè jfcience dans, la première
*2?grt ffans |a ïeçonde, H
rÇ’p|t ce que nous iffoiis eiaminèi dans la dwhière
•parue.’
E G Y
T R O I S I È M E PARTIE,
Résumé de /’Archite&ure Egyptiènne, de fa valeur*
de fort mérite , 6* de Vopinion qu'on doit s eh
former.
Les caufes dont nous avons développé Ifp
fluence fur l’architeéfure dans la première partie dè
cette diflertation , fuffifent fans doute pour faire
apprécier le degré de valeur auquel dut arriver cet
art en Egypte. S’il eft démontré par le raisonnement,
par les autorités ançiènnes et modernes , par les
faits, que la véritable imitation ne put jamais êtrfc
le but des artiftës égyptiens dans les arts qui ont
la nature phyfique pour modèle, il réfulte d’une
télle démonftration, que l ’architeéture Soit par là
liàifon dire&e qu’ellè a avec ces arts, foit par lés
rapports abftràits qui la font dépendre du perfectionnement
dé l’imitation, & de ce fentiment éclairé
du beau & du vrài que la vue de la véritable irai-
tation développe chez un paùjplè , ne dut jamais
atteindre à un fyftême raifonné de convenance, de
vraifemblancè, de proportions, de principes fondés
fur l ’expérience de nos fenfatioiis, ou fur ce{
accord de toutes les qualités que les fens, l’enteftjj
dénient & le goût peuvent délirer dàiis cet art.
Défà'ut limitation•
Il eft impo'ffible que ce gertre d'imitation ab$*
traite de la nature, qui couftitue la partie la plus
fine & la plus déliée de l’art de l'architeHufe, qui
repofe fur les obfervàtions lès plus délicates des
imprèlïions des objets fur nos fens, qui fûppofe
une foule d’ èxpérièrices préalables & d’eflais fuc-
celfifs , qui veut par conféquent toute l’indépendance
du génie & la plus grande liberté dans l’ai-
tjifte , ait pu fe développer en Egypte fous les
entraves, rèligïêüfës, & fous les liens encore ’pi»
étroits de l ’e^nt de rdutîne une. fois établi et devenu,
le'génîe'dômihànt de tous les arts.
À l'egard de c é tie lu trë éfpèce d’imitation pliis
pofinve , dont nous avbns déjà aperçu l’exiftence
& lesJpnricïpes dans les grottes & les fou terrain»
Creusés ,, qui devinrent lés types néceffaires de
Varchiteélure égyptienne , hoùs avons eu déjà rocca-
fion de dire (voyez l’ article architecture ) qw
des différens modèles préfèntés par la nature a
l’ar t, celui qui résulte °des foüterrains ëtoit fans
comparaifon le pltis monotone , le moins fufeep*
tible: de yariétë ^ le plus éibigné de ce qui for»«
le cafaélèrë def l’invention.
Mais il y a une raifon à rendre du vice de cfi
m o d è le ,q u i reffort naturellement de la dénni-j
'tîon. jpi^écifé 'de. l’imi,tation.. ,
Imiter c’eft produire l’image d’une chofe.
,tation en tant qii’elle eft l’àâe d’imiter, êftun acte
par lequel on prqduit ou on rend îenfible non a
1 cliofc 'iaais’ la rèpréfentation de cette chofe. 1
E a Y
rrovens i e reproduire ou.de rdpdter un.objet
Z * X douéf de la faculté de l'imuer. S «1 y a
** :„u,/répétition dans l ’imitation , il a y | g » ;
toîdours imitation dans la répémion. Pour B
j . Citation . il faut que je voie une
t e autre chofe qui en est 1 image, irrefaite de la
plus il y 'a identité dans la p é t it io n , ou re-
S t a t i o n des chpfrs, moins .1 y a tmitatton. Le
C de l’imitation n’eft donc pas 4 approcher d e ,
identité, puifque fon effenceeft d’etre autre chqfe
i l a chofe imitée. L à , en effet, ou | crota par
Ixcès d’illufton ou de rapprochement voir la ehqfe,
je ne crois plus voir,fon image -, & la ou je ne cro\s .
pas voir l ’image d’une chpfe, je ne crois pas jpirj
[’imitation. • . . „ j
Donc tout art ou tout mode d imitation qui tend
le plus possible à s’approcher de ce point de ami-1
litude, qui feroit croire que l’image qu il .prql.ente
d’une chofe eft la chofe niême, tend aussi le plus
nolfible à diminuer l,e plqifir de l’imitation. _ !
1 Donc toute imitation qui tend le plus pqÿihle j
à ce point, tend le plus poilibie à n être plus ^miimitation.
, r . ,
Si ces idées, qui auroient dans doute bçloin de
développement, font vraies, leur application au
fujet que nous traitons va nous faire fentir quelle
fut la caufe principale du peu d’ effet et de pjaifir
que le fyftème imitatif de l'architcSlure égyptienne
doit produire; . ,. . n i
Il eft confiant que le modèle a imiter par 1 art
dy confond av.ee l ’imitation. Des {outerrains creufes
dans la pierre, imités par de la pierre, ne femblent,
être qu’une feule & même chofe. I l n’y eut pas lieu
Û cette métaphore, q u i, chez les Grecs, fubftitua
une matière à une autre matière. Il y.a par cçnfé-
quent identité. Dès lors abfence de ce plaifir qu on
éprouve à voir une chçfe repréfentee par une autre
çhofe. h'archite&ure égyptienne fut donc auffi p?u
imitative qu’il fut possible.
A la vérité, -çet effet tint ici moins au défaut
de l’imitation qu’au défaut du modèle. . ,Gé ne
fut pas, il - eft v r a i l ’imitation qui ambitionna
cet excès d,e reffeipbjance, ce fut le modèle lui-
même qui y donna lieu. Aette privation de plaifir
ïraitatif tient fans doute à la nature des'chofes.
Mais il n’en faut pas ni oins reçonr.oître que layar-
rièreouyçrte à l’art fut plus bornée enEgypte^qu’en
.Grèce,' .' ;i il . ■ \
Le type des foüterrains devenu une fois, par la
force mê.me de la nature , général dans\ajchiteçlurt
îëypûittne n comprend aisément qu’ il dut refulter
de fon’ application à l’art de -bâtir deux .effets qui
femblent d’abord contradiéloires, &"qui cependant
fe rattachent au même principe.
Le premier de ces effets fut la monotonie d^ns
dans les formes principales , le fécond’fut l ’arbitraire
dans les acCeffoires.
Monotonie dans renfemble*
$ous ayons çbferyé delà plus d’une fois j
E G Y 3^
l'att de creufer des habitations foutefraines ne poq-
voit comporter que"’là plus grande fimplicité. Et
dans le hit', il h’y a point de travail qui commande
plus de réierve'dans ce' qu’on appelle le plaifir <£
fa variété.'Oh ne doit point, dans des ouvrages déjà
fi pénibles, rechercher, on doit fuir au contraire
avec foin, tarit ce qui augmente la peine ou mut-
tiplie les combinailons, Xout doit y etre Lue dans
les élévations, dans les plafonds , &c. Tout.dojt
y refpirer l’économie de details, d’ornemens, de
faillies. Enfin j thut doit y être uniforme. Et voilà
auffi ce que nous àŸohs trouvé dans tous ies édv-,
ficés dé l’art égyptien. Point de profils, c’eft-à-dire,'
pbint 'de parties faillantes'ou'rentrantes , point dp
côrriblès , point' de vofités, point de vàtiétK dans
tés afpééis, point de diverfite dans les compositions ,
point ife1 nio'yéns dé 'modifier' les taraflères, point
de nuances, point de .modes. U architecture égyptienne
ne connut point St ne put point cpnnoitre la
variété.
Arbitraire dans les détails.
Le fecond effet réfiltc auffi dire clément de lg
même caufe. C’eft un befoin pour l’homme qùp
d’embellir & de; décoter tout ce qui, l’approche,
tout ce dont il ufé.Nôus avons vua l’atticle Dtco,-
ratiom ( voyei ce mot ) que le goût d’embellit
repofoit fur le befôîn que l’homme a de mouvement,
f i fur ie befoin de la variété qui eu à l’olptit ce
que le mouvement eft au corps. Les Egyptiens
durent éprouver ce befoin dansieur arclntecrure ,
St durent l ’éprouver 4*autant plus que les foptnes
étant tris-monoton.es, elles exigèrent eh quelque
forte une plus forte dole 4e cet affaifonnemént que
la'décoration fait employer pour corriger i limpidité
de fon afpeft. Mais nous avons vu que la
'décoration égyptienne ayant tijé la plus grande
partie de fes mot,ifs des inîcriptions hiéroglyphiques,
& celles-ci dépendant p ar leur nature-d’un autr?
ordre d’idées que celui qui eft propre a l art de
décorer , la plus grande profufion reiulta de cette
éipèce d’embelliffement. Gr , profufion dans la
langue du goût? eft à-peu-près fynomme de contu-
fion. Le goût dans le fait n’aurqu pu rien prefenre
aux figures hiéroglyphiques. Dès-lors cette partie
4e la décoration fut abandonnée a toute ,1 irrégularité
& à tous les 4ifparafes qu’elle, comporte.
Ouand aux autres parties d’ornement, il eft indubitable
que le caprice feul put préfi4er a leur choix
comme à leur emploi. On appelle caprjce en ar-
chiteélure ce goût d’ ornement St. de variété qui ,
ne repofaat fut aucun principe de necelbte ou de
convenance, ne reconnoît de. lois,que celles du
hafard. Or , les formes originaires de\ architecture
égyptienne n’ayant pu établit ,de taifons néceffaires
lomement , c9mme les, principes de ,1a charpente
en avoient fqggér,é à l’a[rçl}ite#ute, grecque ,1a décotation
ne fut en Egypte que ce q u e ft une
; broderie- fut une étoffe. Ei?n de fixe , tien de,
mr.n.. - - l i t lj