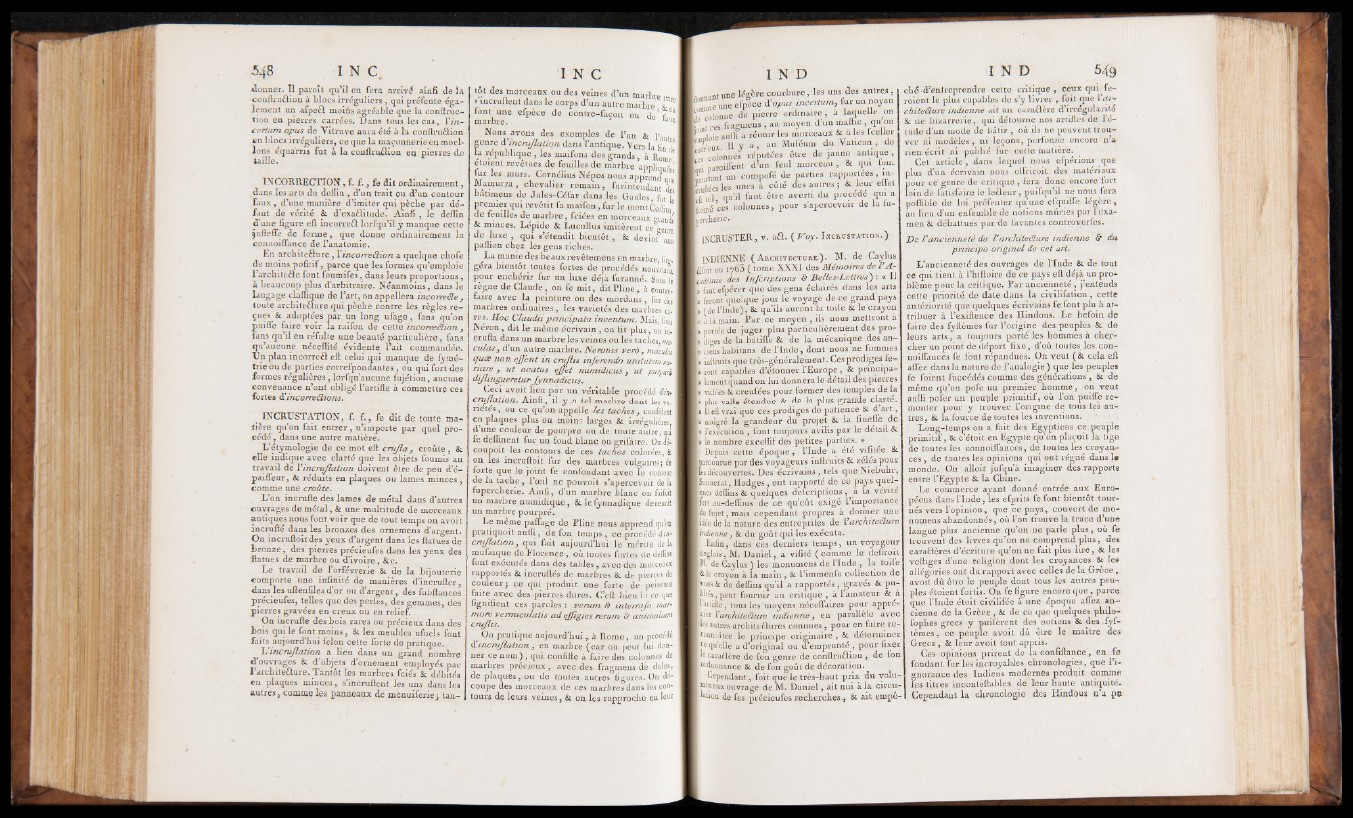
548 I N C.
donner. Il paroît qu’il en fera arrivé ainfi de la
conftruèlion à blocs irréguliers , qui préfente également
un afpeèl moins agréable que la conftruc-
tion en pierres carrées. Dans tous les cas, l'incertum
o,pus de Yitruve aura été à la conftruéKon
en blocs irréguliers, ce que la maçonnerie en moellons
équàrris fut à la confirmation, en pierres de
taille.
INCORRECTION, f. f . , fe dit ordinairement, •
dans Jes arts du deffin , d’un trait ou d’un contour
fau x , d’une manière d’imiter qui pècbe par dé- j
faut de vérité & d’exaéKtude. Ainfi , le deffin :
d’une figure eft incorrect lorfqu’il y manque cette
jufteffe de forme, que donne ordinairement la
connoiffance de l’anatomie.
En architeHure, l’incorrection a quelque cbofe
de moins pofitif, parce que les formes qu’emploie
l ’arcbiteâe font foumxfes, dans leurs proportions,
a beaucoup plus d’arbitraire. Néanmoins, dans le
langage claffique de l’art, on appellera incorrecte,
toute architecture qui pèphe contre les règles reçues
& adoptées par un long ufage, fans qu’on
puiffe faire voir la raifon de cette incorrection,
fans qu’il en réfulte une beauté particulière, fans
qu’aucune néceffité évidente l’ait commandée.
Un plan incorreCt eft celui qui manque de fymé-
frie on de parties correfpondantes, ou qui fort des
fo rmes régulières, lorfqu’aucune fujétion, aucune
convenance n’ont obligé l’artifte à commettre ces
fortes d’incorrections.
INCRUSTATION, f. f . , fe dit de toute matière
qu’on fait entrer, n’impôrte par quel procédé
, dans une autre matière.
L ’étymologie de ce mot eft crujla , croûte , &
elle indique avec clarté que les objets fournis au
travail de l’incruftation doivent être de peu d’é-
paiffeur, & réduits en plaques ou lames minces,
comme une croûte.
L’on incrufte des lames de métal dans d’autres
ouvrages de métal, & une multitude de morceaux
antiques nous font voir que de tout temps on avoit
incrufté dans les bronzes des ornemens d’argent.
On incruftoit des yeux d’argent dans les ftatues de
bronze, des pierres précieufes dans les yeux des
ilatues de marbre ou d’ivoire, &c.
Le travail de l’orfèvrerie & de la bijouterie
comporte une infinité, de manières d’incrufter,
dans lesuftenfilesd’or ou d’argent, des fubftances
préciëules, telles que des perles, des gemmes, des
pierres gravées en creux ou en relief.
On incrufte des bois rares ou précieux dans des
bois qui le font moins, & les meubles ufuels font
faits aujourd’hui félon cette forte de pratique.
incruftation a lieu dans un grand nombre
d’ouvrages & d’objets d’ornement employés par
l ’architecture. Tantôt les marbres fciés & débités
en plaques minces, s incruftent les uns dans les
autres, comme les panneaux de menuiferie; tan-
I N C
tôt des morceanx ou des veines d’un maître I
s incruftent dans le corps d’un autre mai-lire & "
fout une efpèce de contre-facon ou de ’ 'f.ca l
marbre. | Illllx I
Nous avons des exemples de l’un & i’aüh, I
genre d’incruftation dans l’antique. Vers la fin !\ I
la république , les maifons des grands, à Rom ? I
étaient revêtues de feuilles de marbre appliqué I
lur les murs. Cornélius Népos nous apprend „„„ I
Mamurra, chevalier romain, furintendant L I
batimens de Jules-Céfar dans les Gaules fut I» I
premier qui revêtit fa maifon, fur le mont Coelim I
de feuilles de marbre, fciées en morceaux grands I
Si minces. Lépide & Lucullus imitèrent cegenre I
de luxe , qui s’étendit bientôt ., & devint I
paffion chez les gens riches.
La manie des beaux revêtemëns en marbre, fmr. I
géra bientôt toutes fortes de procédés nouveaux. I
pour enchérir fur un luxe déjà furanné. Sous lé I
règne de Claude , on fe mit, dit P line, à contre-1
faire avec la peinture ou des mordans, fur des I
marbres ordinaires, les variétés des marbres ra-1
res. Hoc Claudii principatu inventum. Mais, fous I
Néron, dit le même écrivain., on fit plus, on w. I
crufta dans un marbre les veines ou les taches, ma- I
culas , d un autre marbre. Neronis verà, maculas I
quoe non effient in cruflis inf 'erendo umtatem va- I
nare , ut ovatus effet numidicus ut purpura I
djfhngueretur Jynnadicus.
Ceci avoit lieu par un véritable procédé dï/j- I
crufiation. Ainfi, il y a tel marbre dont les va-r I
riétés, ou ce qu’on appelle les taches, confident I
en plaques plus ou moins larges & irrégulières. I
d’une couleur de pqurpre ou de toute autre, qui I
fe. deffinent fur un fond blanc ou grifàtre. On dé-, I
coupoit^ les contours de ces taches- colorées, & I
on les incruftoit fur des marbres vulgaires j de I
forte que le joint fe confondant avec le contout I
de la tache-, l’oeil ne pou voit s’apercevoir de la I
fupercberie. Ainfi, d’un marbre blanc on faifoit I
un marbre numidique, &. lefynnaçfique deveaoit I
un marbre pourpré.
Le meme paffage de Pline nous apprend qu’ou I
pratiquoit auffi, de fon temps-, ce procédé d in- I
crufiation, qui fait aujourd’hui le mérite de la I
mofaique de Florence, où toutes fortes de deffins I
font exécutés dans des tables, avec des morceaux I
rapportés & incruftés de marbres & de pierres-de I
couleur 5 ce qui produit une , forte d e peinture I
faite avec des pierres dures. C’eft bien la ce que I
lignifient ces paroles : verum & interrufo mar- I
more vermiculatis ad effigies rerum & animalium I
cruflis.
On pratique aujourd’h u i,. à Rome, un procédé I
d’incruftation,. en marbre (car on peut lui don-
ner ce nom) , qui confifte à faire des colonnes de
marbres précieux , avec des- fragmens de dales,
de plaques, ou de toutes autres figures-On de- I
coupe des morceaux de ces marbres dans les con-B
i tours de leurs jveines, & on les rapproche en 1gu£
INDIENNE ( A rchitecture). M. de Caylus
jjjlifoit en 1763 ( tome XXXI des M é m o i r e s d e L H -
iadémie d e s ï n f c n p t i o n s & B e l l e s - L e t t r e s ■ ) : « Il
lu faut efpérer que des gens éclairés dans les arts
L feront quelque jour le voyage de ce grand pays
» (de l’Inde), &■ qu’ils auront la toile & le crayon
L à la main. Par. ce moyen , ils nous .mettront à
, portée de juger plus particulièrement des pro-
„ diges de la bâtiffe & de la mécanique des an-
» ciens babitans de l’Inde, dont nous ne fommes
L iuflruits que très-généralement. Ces prodiges fé-
» ront capables d’étonner l’Europe, & principa-
» lement quand on lui donnera le détail des pierres
p vidées & creufées pour former des temples de la
p plus valte étendue & de la plus grande clarté,
p II eft vrai que ces prodiges de patience & d ar t,
p malgré la grandeur du projet & la fineffe de
» l’exécution , font toujours avilis par le détail &
jp le nombre exceffif des petites parties. »
r Depuis cette époque, l’Inde a été vifitée 8t
parcourue par des voyageurs inftruits & zélés pour
les découvertes. Des écrivains ,. tels que Niebuhr,
(Sonnerat, Hodges , ont rapporté de ce pays quelques
deffins & quelques delCriptions , à la venté
fort au-deffous de ce qu’eût exigé l ’importance
|du fujet, mais cependant propres à donner une
Idée de la nature des entrepriles de Y! a r c h i te c tu r e
[indienne , & du goût qui les exécuta.
Enfin, dans ces derniers temps, un voyageur
anglais, M. Daniel, a vifité (comme le defiroit
M. de Caylus ) les monumens de l’Inde , la toile
l&le crayon à la main, & l’immenfe collection de
[Vues & de deffins qu’il a rapportés , gravés & publiés
, peut fournir au critiqué , à l’amateur & a
ïl’arlifte , tous les moyens néceffaires pour apprécier
Ya r c h ite é lu r e i n d i e n n e , en parallèle avec
[les autres, architectures connues , pour en faire re-
| connoîire le principe originaire , & déterminer
ce qu’elle a d’original ou d’emprunté , pour fixer
le caraélère de fon genre de conftruCtion , de fou
ordonnance 8c de fon goût de décoration.
Cependant, foit que le très-haut prix du volumineux
ouvrage de M. Daniel, ait nui à la circu-
btion de fes précieufes recherches., & ait empe-
I N D 549
ché d’entreprendre cette critique, ceux qui fe-
roient le plus capables de s’y livrer , foit que Y architecture
indienne ait un caraCtère d’irrégularité
8c de bizarrerie, qui détourne nos artiftes de l’étude
d’un mode de bâtir , ou ils ne peuvent trouver
ni modèles -, ni leçons , perfonne encore n’a
rien écrit ni publié fur cette matière.
Cet article, dans lequel nous efpérions que
plus d’un écrivain nous ollriroit des matériaux
pour ce' genre de critique , fera donc encore fort
foin de fatisfaire le leCleur, puifqu’ii ne nous fera
poffible de lui préfenter qu’une efquilfe légère ,
au lieu d’un enfemble de notions mûries par l’examen
& débattues par de lavantes conlroverfes.
De U ancienneté de V architecture indienne & du
principe originel de- cet art.
L’ancienneté des ouvrages de l’Inde & de tout
ce qui tient à l’hiftoire de ce pays eft déjà un problème
pour la critique. Par ancienneté, j’entends
cette priorité de date dans la civilifation, cette
antériorité que quelques écrivains fe font plu à attribuer
à l’exiftence des Hindous. Le befoin de
faire des fyftèmes fur l ’origine des peuples & de
leurs arts, a toujours porté.les hommes à chercher
un point de départ fixe, d’où toutes,les con-
noiffances fe font répandues. .On veut (& cela eft
affez dans la nature de l ’analogie ) que les peuples
fe foient fuccédés comme des générations , & de
même qu’on pofe un premier homme, on veut
auffi pofer un peuple primitif, où l’on puiffe remonter
pour y trouver l’origine de tous les au-*
très, & la fource de toutes les inventions.
Longtemps on a fait des Egyptiens ce.peuple
primitif, & c’étoit en Egypte qu’on plaçoit la tige
de toutes les connoiffances, de toutes les croyances
, de toutes les opinions qui ont régné dans le
monde. On alloit jufqu’à imaginer des rapports
entre l’Egypte & la Chine.
Le commerce ayant donné entrée aux Européens
dans l’Inde, les efprits fe font bientôt tournés
vers l’opinion, que .ce pays, couvert de monumens
abandonnés, où l’on trouve la trace d’une
langue plus ancienne qu’on ne parle plus, où fe
trouvent des livres qu’on ne comprend plus, des
caraètères d’écriture qu’on ne fait plus lire , & les
veftiges d’une religion dont les croyances & les
allégories ont du rapport avec celles de la Grèce p
avoit du être le peuple dont tous les autres peuples
étoient fortis. On fe figure encore que , parce
que l ’Inde étoit civilifée à une époque affez ancienne
de la G rèce, 8t de ce que quelques philo-
fophes grecs y puifèrent des notions 8t des .fyftèmes
, ce peuple avoit dû être le maître des
Grecs , & leur avoit tout appris.
Ces opinions prirent de la confiftance, en fe
fondant fur les incroyables chronologies, que l ’ignorance
des Indiens modernes produit comme
les titres inconteftables de leur haute antiquité.
Cependant la chronologie des Hindous n’a p»