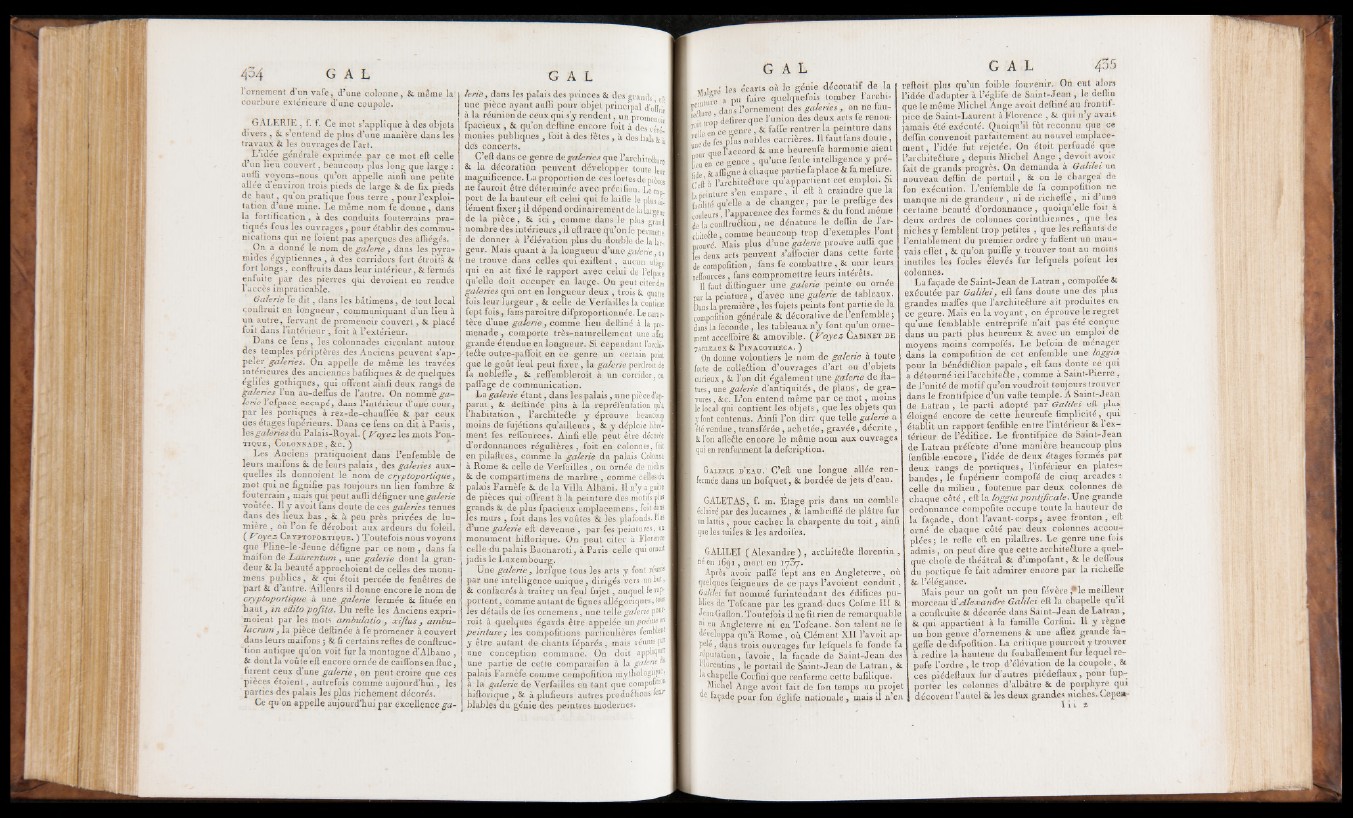
1 ornement d un vafe. d’une colonne , & même la
courbure extérieure d’une coupole.
GALERIE , f. f. Ce mot s’applique à des objets
divers , & s’entend de plus d’une manière dans les
travaux & les ouvrages de l’art.
L’idée générale exprimée .par ce mot eft celle
d’un lieu couvert , beaucoup plus long que large :
auffi voyons-nous qu’on appelle ainfi une petite
allée d’environ trois pieds de large & de fix pieds
de haut, qu on pratique lous terre , pour l’exploitation
d’ane mine. Le même nom fe donne, dans
la fortification , à des conduits fouterrains pratiqués
fous les ouvrages, pour établir des communications
qui ne foient pas aperçues des afliégés.
On a donné le nom de galerie dans les pyramides
égyptiennes, à des corridors fort étroits &
fort longs , conftruits dans leur intérieur, & fermés
enfuite par des pierres qui dévoient en rendre
l ’accès impraticable.
Galerie fe d it , dans les bâtimens, de tout local
confirait en longueur, communiquant d’un lieu à
un autre, fervant de promenoir couvert, & placé
foit dans 1 intérieur , l ’oit à l ’extérieur.
Dans ce fens, les colonnades circulant autour
des temples périplères des Anciens peuvent s’appeler
galeries. On appelle de même les travées
intérieures des anciennes bafîliques & de quelques
églifes gothiques, qui offrent ainfi deux rangs de
galeries 1 un au-deffus de l’autre. On nomme galerie
1 efpace occupé, dans l’intérieur d’une cour,
par les portiques à rez-de-chauffée & par ceux
des étages fupérieurs. Dans ce fens on dit à P avis,
les galeries du Palais-Royal. ( Voyez les mots P ort
iqu e, C olonnade , &c. )
Les Anciens pratiquoient dans l’enfemble de
leurs maifons & de leurs palais , des galeries auxquelles
ils donnoient le nom de cryptoportique,
mot qui ne lignifie pas toujours un lien fombre &
fou terrain , mais qui peut auffi défigner une galerie
voutee. Il y avoit fans doute de ces galeries tenues
dans des beux bas , - & à peu près privées de lumière
, ou l’ on fe déroboit aux ardeurs du foleil.
( Voyez Cryptoportique. ) Toutefois nous voyons
que Pline-ïe-Jeune défigne par ce nom , dans fa
niaifon de Laurentum , une galerie dont la grandeur
& la beauté approchoient de celles des monu-
mens publics, & qui étoit percée de fenêtres de
part & d’antre. Ailleurs il donne encore le nom de
ciyptaportique à une galerie fermée & fituée en
haut, in edito pojita. Du refte les Anciens expri-
moient par les mots ambulatio , xiflus , ambu-
lacrum} la pièce dellinée à fe promener à couvert
dans leurs maifons j & fi certains relies de cônftrue-
tion antique qu’on voit fur la montagne d’Albano ,
& dont la voûte elt encore ornée de caiffons en llu c ,
furent ceux d’une galerie, on peut croire que ces
pièces étoient, autrefois comme aujourd’hui, les
parties des palais les pins richement décorés.
Ce qu on appelle aujourd’hui par excellence galerië,
dans les palais des princes & des grands a
une pièce ayant auffi pour objet principal d’oflV
à la réunion de ceux qui s’y rendent, un promcno'
fpacieux , & qu’on deftine encore foit à des c-.éré
manies publiques , foit à des fêles, à des bals & ~
des concerts.
C’eft dans ce genre de galeries que l ’archited ur& i
&. la décoration peuvent développer toute leur
magnificence. La proportion de c e s fortes de pièce»
ne fauroit être déterminée avec précifiou. Le rapport
de la hauteur eft celui qui fe iaifl'e le plus
férnent fixer ; il dépend ordinairement de la largeur
de la p iè c e , & i c i , comme dans le plus grand
nombre des int érieurs , il eft rare qu’on fe permette
de donner à l’élévation plus du double de la lar- !
geur. Mais quant à la longueur d’une ga lerie ou
ne trouve dans celles qui exiftent, a u cu n u(a?e
qui en ait fixé le rapport avec celui de l’efpace
qu’elle doit occuper en large. On p e u t citer des
galeries qui ont en longueur deux , trois & quatre
fois leur la r g e u r , & celle de Verfailles la contient
lept f o is , fans paroi Ire difproportionnée. L e caractère
d’une galerie , comme lieu deftiné à la promenade
, c o m p o r t e très-naturellement une allez
grande étendue en longueur. Si cependant larcin-
teête outre-paffoit en ce genre un c e rtain point
que le goût feul peut fix e r , la galerie perdroit de
fa nobîefîe, & reffembleroit à un corridor, ou
paffage de communication.
La galerie étant, dans les palais, une pièce d’apparat
, & deftinée plus à la repréfentation qu’à
i habitation , l’arcbiteête y éprouve beaucoup
moins de fujétions qu’ailleurs , & y déploie librement
fes reffources. Ainfi elle peut être décorée
d’ordonnances régulières , foit en colonnes, foit
en pilaftres, comme la galerie du palais Colonna
à Rome & celle de Verfailles , ou ornée de niches
& de compartitoens de marbre , comme celles du
palais Farnèfe & de la Villa Albani. Il n’y a guère
de pièces qui offrent à là peinture des motifs plus !
grands & de plus fpacieux emplacemens, foit dans j
les murs , foit dans les, v.oûtes & lés-plafonds. Plus
d’une galerie eft devenue ., par fes peintures, un
monument biftorique. On peut citer à Florence j
celle du palais Baonaroti, à Paris celle qui ornoit
jadis le Luxembourg.
Une galerie, lorfque tous les arts y font réunis
par une intelligence unique, dirigés vers un but,
& confacrés à traiter un feul fujet, auquel fe rap- •
portent , comme autant de figues allégoriques, tous
les détails de fes ornemens, une telle g a lerie pour-
roit à quelques égards être appelée un poënie en
peinture ; les compofitions particulières femblent
y être autant de chants féparés, mais réunis pu
une conception commune. On doit appbqaer
une partie de cette comparaifon à la galerie w
palais Farnèfe comme compofition mythologue6>
à la galerie de Verfailles en tant que compob|î0D
hiftorique , & à plufieurs autres produêbons fe®*
blables du génie des peintres modernes.
Makré les écarts où le génie décoratif de la
' ture a pu faire quelquefois tomber l’archi-
ql g (jans l’ornement des galeries , on ne fau-
,e. “ ’ defirerque l’union des deux arts fe renou-
J°lle en ce genre, & fade rentrer la peinture dans
VCpde fes plus nobles carrières. Il faut fans doute ,
uu r ue raccord & une heureufe harmonie aient
| J en ce genre , qu’une feule intelligence y pré-
fide & affigne à chaque partie fa place & fa mefure.
O’eft à l’archite'âure qu’appartient cet emploi. Si
i peinture s’en empare, il eft à craindre que la
facilité quelle a de changer,' par le preftige des
couleurs, l’apparence des formes & du fond meme
de la conftru&ion, ne dénature le deflin de l’ar-
çbiteâecomme beaucoup trop d’exemples l’ont
prouvé. Mais plus d’une galerie prouve auffi que
les deux arts peuvent s’affocier dans cette forte
de compofition, fans fe combattre , &- uiiir leurs,
i reffources , fans compromettre leurs intérêts.
! Il faut diftinguer une galerie peinte ou ornée
par la peinture , d’avec une galerie de tableaux.
Dans la première, les fujets peints font partie de la
compofition générale & décorative dePenfemblej
i dans la fécondé , les tableaux n’y font qu’un ornement
■ peu
acceffoire & amovible. ( Voyez Cabinet de
' TABLEAUX & PlNACQTHECA. )
i On donne volontiers le nom de galerie à toute
[forte de collection d’ouvrages d’art ou d’objets
[ curieux , & l’on dit également une galerie de fta-
[ tues, une galerie d’antiquités, de plans', de gra-
rvures, &c. L’on entend même par ce m o t, moins
le local qui contient les objets , que les objets qui
l y font contenus. Ainfi l’on dirr que telle galerie a
■ été vendue, transférée, achetée, gravée, décrite,
I & l’on affeâe encore le même nom aux ouvrages
[ qui en renferment la defcription.
Galerie d’eau.' C’eft une longue allée ren-
! fermée dans un bofquet, 8c bordée de jets d’eau
GALETAS, f. m. Etage pris dans un comble
K éclairé par des lucarnes , & lambriffé de plâtre fur
I un lattis, pour cacher la charpente du tq it, ainfi,
I que les tuiles & les àrdoifes.
GALILEI (A lexan d re ), architecte florentin
reftoif plus qu’un foible fouvenir. On eut alors
l’idée d’adapter à l ’églife de Saint-Jean , le deffin
que le même Michel Ange avoit deftiné au frontif-
pice de Saint-Laurent à Florence , & qui n’y avait
jamais été exécuté. Quoiqu’il fût reconnu que ce
deffin convenoit parfaitement au nouvel emplacement
l né en 1691, mort en 1737.
I Après avoir paffé fept ans en Angleterre, où
r quelques feigneurs de ce pays l’avoient conduit
Galilei fut nommé fnrintendant des édifices pu
I blics, de Tofcane par les grand-ducs Cofme III &
' Jean Gaflon. Toutefois il ne fit rien de remarquable,
| ni en Angleterre ni en Tofcane. Son talent ne fe
I développa qu’a’Rome , où Clément XII l’avoit ap-
pelé, dans trois ouvrages fur lefquels fe fonde le
réputation, lavoir, la façade de Saint-Jean de;
florentins, le portail de Saint-Jean de Latran,
la chapelle Corfini que renferme cette bafilique.
Michel Ange avoit fait de fon temps un projet
«e façade pour fon égiife nationale, mais il
, l’idée fut rejetée. On étoit perfuadé que
l’archite&ure , depuis Michel Ange , devoit avoir
fait de grands-progrès.. On demanda a Galilei un
nouveau deffin de portail, & on le chargea’ de
fon exécution. L ’enfemble de fa compofition ne
manque ni de grandeur , ni de ricbefîe , ni d’une
certaine beauté d’ordonnance, quoiqu’elle foit à
deux ordres de colonnes corinthiennes , que les
niches y femblent trop petites , que les reffauls de
l ’entablement du premier ordre y fafîent un mauvais
effet, & qu’on puifîe y trouver tout au moins
inutiles les focles élevés fur lefquels pofent les
olonnes.
La façade de Saint-Jean de Latran, compofée 8t
exécutée par Galilei, eft fans doute une des plus
grandes maffes que l’archi teêture ait produites en
ce genre. Mais en la voyant, on éprouve le regret
qu’une femblable entreprife n’ait pas été conçue
dans un parti plus heureux 8c avec un emploi de
moyens moins compofés. Le befoin de ménager
dans la compofition de cet enfemble une loggia
pour la bénédiêhon p a p a le e f t fans doute ce qui
a détourné ici l’architecte , comme à Saint-Pierre ,
de l ’unité de motif qu’on voudroit toujours trouver
dans le frontifpice d’un vafte temple. A Saint-Jean
de Latran , le parti adopté par Galilei eft plus
éloigné encore de cette heureufe fimplicité, qui
établit un rapport fenfible entre l’intérieur & l’extérieur
de l’édifice. Le frontifpice de Saint-Jean
de Latran préfente d’une manière beaucoup plus
fenfible -encore, l’idée de deux étages formés par
deux rangs de portiques, l’inférieur en plates-
bandes , le fupérieur compofé de cinq arcades :
celle du milieu, foutenue par deux colonnes de
chaque côté, eft la loggia pontificale. Une grande
ordonnance compofite occupe toute la hauteur de
la façade, dont l'avant-corps, avec fronton, eft
orné de chaque côté par deux colonnes accouplées
; le refte eft en pilaftres. Le genre une fois
admis , on peut dire que cette architeâure a quelque
çkofe de théâtral & d’impofant, & le défions
du portique fe fait admirer encore par la richeffe
% l’élégance. . - _
Mais pour un goût un peu févère j*le meilleur
morceau Alexandre Galilei eft la chapelle qu’il
a conftrijite & décorée dans Saint-Jean de Latran,
& qni appartient à la famille Corfini. Il y règne
un bon genre d’ornemens & une allez grande £a-
geffe de difpofition. La critique pourrait y trouver
À redire la hauteur du foubaflement fur lequel re-
pofe l’ordre , le trop d’élévation de la coupole, &
ces piédeftaux fur d’autres piédeftaux, pour fup-
l’te.r les colonnes d’albâtre 8c de porphyre
décorent l’autel 8c les deux grandes niches. Cepe*