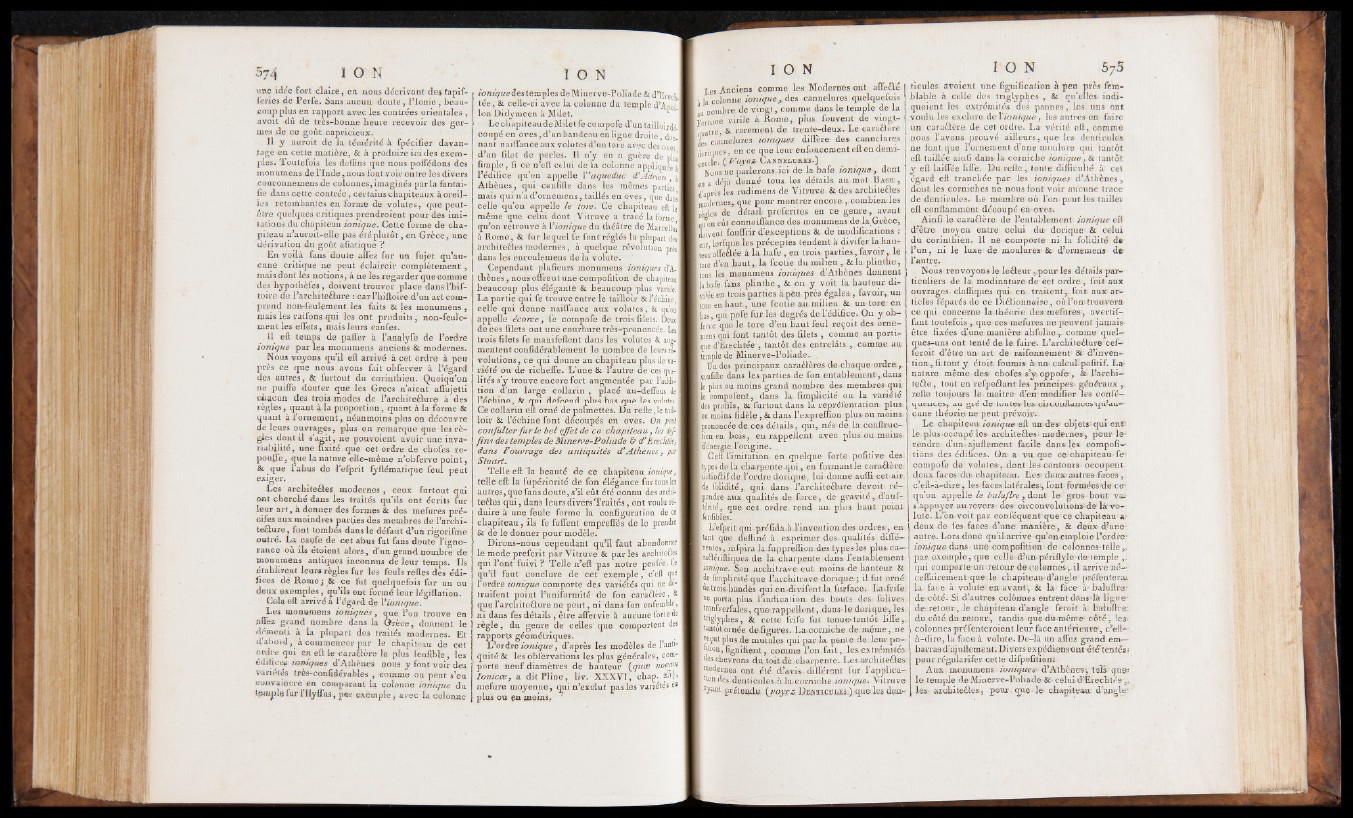
574 I Q N
une idée fort claire, en nous décrivant des fapif-
ieries.de Perfe.. Sans aucun doute, Plonie, beaucoup
plus en rapport avec les contrées orientales ,
avoit du de très-bonne heure recevoir des germes
.de ce goût capricieux.
Il y aiiroit de la témérité à fpécifier davantage
en cette matière, & à produire ici des exemples,
Toutefois les delfins que nous poifédons des
monumens de l’Inde, nous font voir entre les divers
,couronneineos.de colonnes,imaginés parla fantai-
fie dans cette contrée, certains chapiteaux à oreilles
retombantes en forme de volutes, que peut-
être quelques critiques prendroient pour des imitations
du chapiteau ionique. Cette forme de chapiteau
n’auroit-elle pas été plutôt, en Grèce, une
dérivation du goût aliatique ?
En voilà fans doute allez fur un fujet qu’aucune
critique ne peut éclaircir complètement,
mais dont les notions, à ne les regarder que comme
des hypothèfes, doivent trouver place dans l’h-if-
toire de l’architeêlure : caiThiftoire d’un art comprend
non-feulement les faits & les monumens ,
mais les raiions qui les ont produits, non-feulement
les effets, mais leurs caufes.
Il eft temps de palier à l’analyfe de l ’ordre
ionique parles monumens anciens & modernes.
Nous voyons qu’il eft arrivé à cet ordre à peu
près ce que nous-avons fait obfevver à l ’égard
des autres, & furtout du corinthien. Quoiqu’on
ne puilfe douter que les Grecs n’aient affujetti
chacun des trois modes de l ’architeêlure à des
règles, quant à la proportion, quant à la forme &
quant à l’ornement, néanmoins plus on découvre
de leurs ouvrages, plus on remarque que les règles
dont il s’agit , ne pouvoient avoir une invariabilité,
une fixité que cet ordre de ehofes re-
poufte, que la nature elle-même n’obferve point,
& que l’abus de l ’efprit lyftématique feul peut
exiger.
Les architeêles modernes , ceux furtout qui
ont cherché dans les traités qu’ils ont écrits fur
leur art, à donner des formes & des mefures précises
aux moindres parties des membres de l ’archi-
teêlure, font tombés dans le défaut d’un rigorifme
outré. La caçfe de cet abus fut fans doute l’ignorance
ou ils étoient alors , d’un grand nombre de
monumens antiques inconnus de leur temps. Ils
établirent leurs règles fur les feuls refies des édifices
dé Rome \ & ce fut quelquefois lnr un ou
(leux exemples, qu’ils ont formé leur légiflation.
Cela eft arrivé à l ’égard de Yionique. '
Les monumens ioniques, que. Ton trouve en
affez grand nombre dans la Grèce, donnent le
démenti à la plupart des. traités modernes. Et
d’abord,. à commencer par le chapiteau de çet
ordre qui en eft le eara&ère le plus fenfible, les
•édifieeâ ioniques df Athènes nous y font voir des,
variétés très-confidérables , comme on peut s’en
eoitvaincre en comparant la colonne ionique du
t^mjple fur niyffus, par exemple, a vec la colonne
I O N
ionique des temples de Min erve-Poliade & d’Ei ecü
tée, & celle-ci avec la colonne du temple d’Anol I
Ion Didymeen à Milet.
Le chapiteau de Milel fe compofe d’un tailloir dé ^
coupé en oves, d’un bandeau en ligne droite, don,|
nànt hail'fance aux volu tes d’un tore avec des oves I
d’un filet de perles. Il n’y en a guère de pM
firnple, fi ce n’eft celui de la colonne applique à|
l ’édifice qu’on appelle Y’aqueduc d’Adrien J
Athènes, qui confifte dans les mêmes parties I
mais qui n’a d’ornemens, taillés en oves, que dans!
celle qu’on appelle le tore. Ce chapiteau eft le
même que celui dont Vitruve a tracé la forme
qu’on retrouve à l’ionique du théâtre de Marcellus
à Rome, & fur lequel fe font réglés la plupart des
architeêles modernes, à quelque révolution près
dans les enroulemens de la volute.
Cependant plufîeurs monumens ioniques d’Athènes
, nous offrent une compofition de chapiteau I
beaucoup plus éléganlè & beaucoup plus variée,
La partie qui fe trouve entre le tailloir & l’échine, I
celle qui donne n alliance aux volutes, & qu’on I
appelle écorce, fe compofe de trois filets. Deux
de ces filets ont une courbure très-prononcée. Les
trois filets fe manifeftent dans les volutes & aug-1
mentent confidérablement le nombre de leurs ré* I
voletions, ce qui donne au chapiteau plus de variété
ou de richeffe. L’une & l’autre de cesqua-
li tés s’y trouve encore fort augmentée par l’addi- H
tion d’un large collarin , placé rau-deffou$ de
l’échine, & qui defeend plus bas que les volutes. I
Ce collarin eft orné de palmettes. Du relie,le tail- Il
loir & l’échine font découpés en oves. On yp«rf|
confulter fur le bel effet de ce chapiteau , les défi
fins des temples de Minerve-Poliade & d’Erechtée,
dans l ’ouvrage des antiquités d’Athènes, par
' Stuart.
Telle eft la beauté de ce chapiteau ionique A
telle eft la fiipériorité de fon élégance fur tous lei l
autrçs, que fans doute, s’il eût été connu des archi-1
teêles qui, dans leurs divers Traités, ont voulu ré-1
duire à une feule forme la configuration de ce |
chapiteau, ils fe fulfent emprefl’és de le prendre
& de le donner pour modèle.
Dirons-nous cependant qu’il faut abondonner
le mode preferit par Vitruve & parles architeêles
qui l’ont fuivi ? Telle n’eft pas notre penfée. Ce
qu’il faut conclure de cet exemple, c’elt que
l’ordre ionique comporte des variétés qui rie de-
truifent point Puniformité de fon caractère, &
que l’architeêlure ne peut, ni dans fon enfemble,
ni dans fes détails, être aflèrvie à aucune forte de
règle, du genre de celles que comportent des
rapports géométriques.
L ’ordre ionique, d’après les modèles de l’antiquité
& les oblèrvations les plus générales, comporte
neuf diamètres de hauteur (quoe noMM
Îonicae, a dit Pline, liv. XXXVI, chap. 23)*
mefure moyenne , qui n’exclut pas les varjétç* ea
plqts ou çn moins, *
I O N
Les Anciens comme les Modernes ont affeêfé
v ja colonne ionique*, des cannelures quelquefois
|r üombi-e de vingt, comme dans le temple de la
Fortune virile à Rome, plus fouvent de vingx-
fluatre & rarement.de trente-deux.. Le caraêlère
l]es cannelures ioniques diffère des- cannelures
briques, en ce que leur enfoncement eft en dexni-
Iceiicie. (; Voyez- Cannei/uhes.)
Jlous ne oarierons ici de la bafe ionique, dont
on a déjà donné tous les détails au mot Base ,
d’après les rudimens de Vitruve & des architeêles
[modernes,.que pour montrer encore, ,;Gombien. les
règles de détail preferit es en ce genre, avant
[fluon eût connoiifance.des monumens de la Grèce;
doivent fouffrir d’exceptions & de modifications :
car lorfque les préceptes tendent à divifer la.hau-
leur afteâée à la- bafe , en trois: parties , f a v o i r l e
Itore d’en haut,, la feotie du milieu , & la plinthe,
|ous. les, monumeus ioniques d’Athènes donnent
la bafe fans plinthe,, & on y voit fa hauteur di-
yiféeen trois parties à peu. près égales-., favaiiyun
[tore en haut, une feotie au milieu & un-tore en
las, nui pofefur les degrés de l’édifice. On y oh-
jfeive que le tore d’en haut feul reçoit des-orne-
[mens qui font tantôt des filets , comme, au porti-
Ique d’Erechtée , tantôt des entrelâts.,. comme, au
[temple de Minerve-Poliade.., _
Un des principaux Garaêlères-de chaque ordre,,,
[confifte dans les parties de fon entablement',,dans:
[le plus ou moins grand nombre des- membres?qui:
jle compofent, dans- la (implicite, ou. la variété
ides profils, & furtout dans la repré Tentation plus:;
eu moins fidèle dans,llexpredIion plus* ou moins,
prononcée de ces détails,, qui, nés- de: hrxonftriiG—
[tion en bois:, en rappellent avec plusiou moins,
| d’énergie, forigine.
C’eft l’imitation en quelque forte pofitive. des:
types de là charpente-qui, en formant le caraêiè-re
Idiltinêtif de l’ordre dorique, lui donne auffi cet air.
de fohdité, qui dans l’architeêlure.- devoit ré-
pondre aux, qualités-de force,, de gravité,, d’aufi-
téritéy que cet ordre rend au< plus haut point
fenfibles.
L’efprit qui préfida-à.l’inyention des ordres, en .
tant que deftiné à , exprimer des. qualités , ditfé-
jientes, infpira laTuppreftion des types les plus: car-
liafiéviftiques de la charpente dans l’entablement
Iionique. Son architrave; eut moins de hauteur. 8s
[ de fimplicité que Baixhitrave doriq.ue;$ il fut orné:
de troi&.liandès qui en-divifentla fur face;- La>frife;
porta, plus l’indication, des bouts- des: folives.-
tcanfyerfàles-, q.ue^rappellent, dans- le dorique^ les
hriglyphes, & cette frife fut tenuei tantôt: lifte ,,
tantôt-ornée de.fig-ures. LauOomÎGhe. de:même, .ne
i îeçut plus de mutules qui panla. pente de leur po^-
fifiou,fignifientcomme l’on fait, .les.extrémités-
des chevrons du toit.dè.cliaiqiente; Les aixhiteâtes:
inodernes ont. été d’avis dilièrent fur l’applica—
- tWQ‘des..denticules, à la, eorniolde ionique. Vitruve
aJ^ûfipréteadu. (pqyez- Dxisi'icüiÆs^jqpe' fès den.-
I O N 5 j 5
ticules avoient une lignification à peu près fero*
blable à celle des triglypbes ,. & qu’elles? indi-
quoient les extrémités des pannes,, les’ uns ont
voulu-les exclure de T ionique, les autres en faire
un caraêtère de cet ordre. La vérité eft , comme
nous: l ’avons prouvé ailleurs, que les denticules
ne font que l’ornement d’une moulure qui tantôt
eft taillée ainfi dans la corniche ionique, & tantôt
y eft laifiée lifte. Du relie, toute difficulté k cet
égard eft tranchée par les ioniques d’Athènes,
dont les corniches ne nous font voir aucune trace
de denticules.. Le membre où l ’on, peut les tailler
eft c.onftamment découpé en-oves;
Ainfi le caraêlère de l’entablement ionique eft
dfêtre moyen entre celui dut dorique & celui
du corinthien. Il ne comporte- n i la? folidité de
l’un, ni le luxe'de moulures? & d’orne mena de:
l’autre.
Nous renvoyons le: leêleur,.pour les détails particuliers
de la« modinature de ©et ordre?,, foi-t aux
ouvrages- claffiques qui* en. traitent,, foit aux articles
féparés de ce Diêtionnaine, où l’onurouver^
ce qui concerne lai théorie des mefures., avertif—
fant toutefois ,,que?ces-mefures.ne peuvent jamais*
être fixées d’une, manière? abfolhe ,. comme quelques
uns ont tenté de le faii>e. L ’archite^ùre-cef—
leroit d’être un- art- de- raifonnement & d’invention.,
fi. tout y. étoit. fournis* à un calcul? pofttif. La?
nature même de» chofes? s’y» oppofer, &■ llarchi-
teêle, tout en refpeêhmt’les principes-* généraux
jrefte. toujours lë- maître- d’em modifier- les coiifé—
: quences5 au gré de toutes les circouftances qu^au-
cune théorie ne peut prévoir;
Le chapiteau ionique eft un?de»' oHjets-qui ont’
;le;plus*ocGupé les', arohiieâesi modernes?, pour le*
rendre-d’un, ajuftement facile dansriès oômpofi—
lions des édifices. Qn> a vu? que oe?chapiteau fé*
compofe dô volutes-,.dont l'esi contouïs- occupent
deux faces:du chapiteau. Less deux> autres».face^ ,,
c’eftT-à^drre , les? fàcesdatérales^ font, formées^d© ce“
qu’on appelle le balû/lre, dont le? gros - bout vai
«’.appuyer au-revers? des> circonvolutions -dé là-vo-
lutë. L’on,voit par oonféquent’que ce chapiteau a<
deux de fes faces : d’une manière, & deux» d^une-
autre. Lor-s donc qu’il arrive qu’on emploie l’ordre*
ionique dans * une compofition: de ? colonnes-telle,,
par exemple, que oellé (Bumpériftyle de-temple
qui comporte-iwii..retour decolonnesyil arrive né—
ceffairement^quele ch apiteau-d’ang] e pré fente r alla
face à, volute: en avant^. & la? face- à-baluftre?
de côté. Si d’autres colonnes^entrent drins^lh ligne*
den-elour,,le chapiteau.d’angle fèroit à baluftre
du.côté.dnire-tourî, tandis que dù-meme1 côté ; lesï
colonnes pré fen ter oient leur face antérieure^ c’eft-*^
à-dire,..la face à volute. De-là un allez granR embarras
d’àjuoftement. Divers expédiens,oiït~é.t éventés;
po ur régularifer cet te difpofitiorri
Aux. monumens ioniques<■ d’Athènes^, tel» qneî
le temple de Minerve^Boliade 8f- celui d-Èrechtée ,,
les.. - ar chiteêles., pour , que- les chapiteau: d’angle: