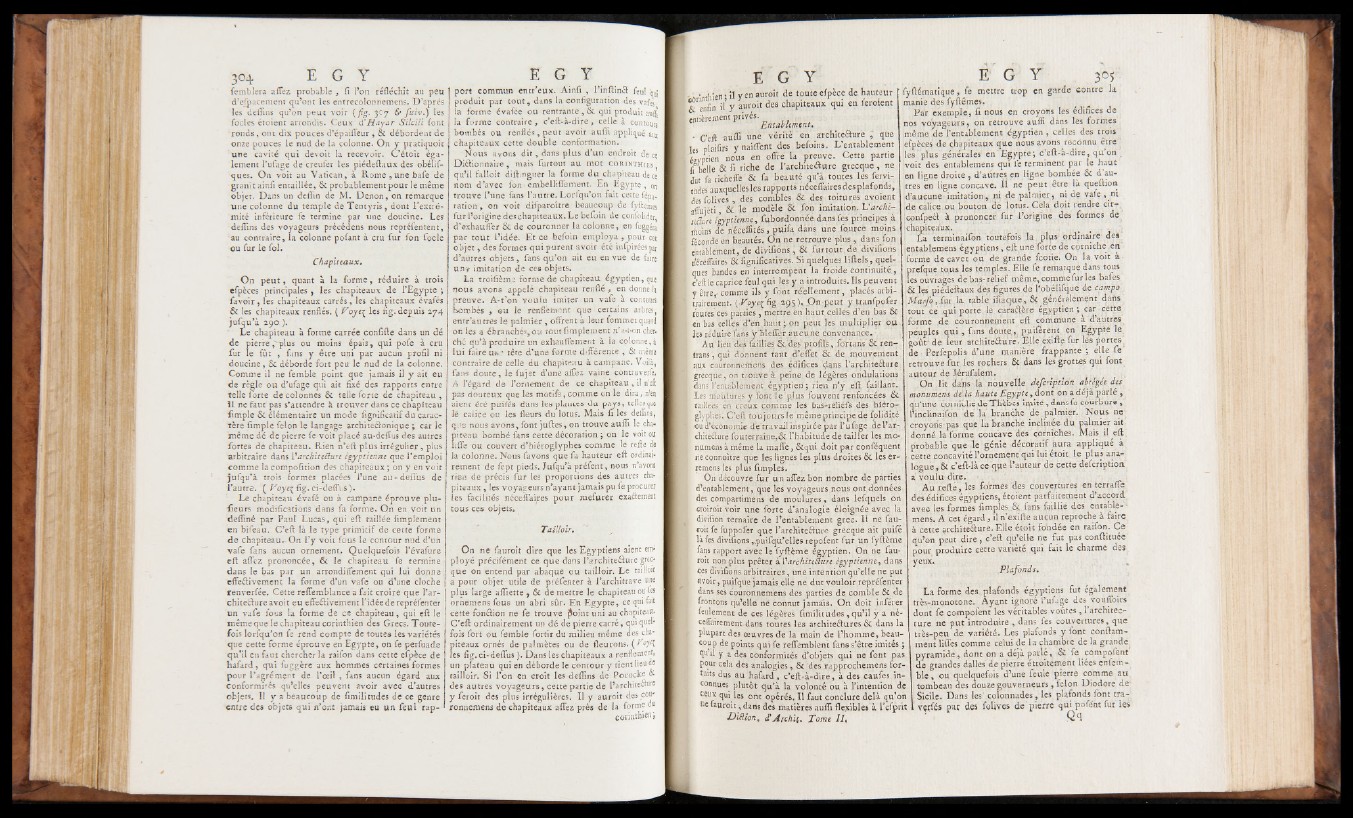
femblera aflez probable , fi l’on réfléchit au peu
d’ejpacement qu’ont les entrecolonnemens. D ’après
les deffins qu’on peut voir {fig- 3C7 6» fuiv.') les
focles étoient arrondis. Ceux à' Hayar Silcili font
ronds, ont dix pouces d’épaiffeur , & débordent de
onze pouces le nud de la colonne. On y pratiquoic
une cavité qui de voit la recevoir. C ’étcit également
l’ufage de creufer les piédeftaux des obélif-
ques. On voit au Vatican, à Rome, une bafe de
granit ainfi entaillée, & probablement pour le même
objet. Dans un deffin de M. Denon, on remarque
une colonne du temple deTentyris, dont l ’extrémité
inférieure fe termine par une doucine. Les
deffins des voyageurs précédens nous repréfentent,
au contraire, la colonne pofant à cru fur fon focle
ou fur le fol.
Chapiteaux.
On p eu t, quant à la forme, réduire à trois
efpèces principales , les chapiteaux de l’Egypte ;
fa v o ir , les chapiteaux carrés, les chapiteaux évafés
& les chapiteaux renflés. ( V<oye% les fig. depuis 274
jufqu'à 290 ).
Le chapiteau à forme carrée confifte dans un dé
de pierre^plus ou moins épais, qui pofe à cru
fur le fût , fans y être uni par aucun profil ni
doucine, & déborde fort peu le nud de la colonne.
Comme il ne femble point que jamais il y ait eu
de règle ou d’ufage qui ait fixé des rapports entre
telle forte de colonnes & telle forte de chapiteau ,
i l ne faut pas s’ attendre à trouver dans ce chapiteau
fimple & élémentaire un mode fignificatif du caractère
fimple félon le langage architectonique ; car le
même dé de pierre fe voit placé au-deflus des autres
fortes de chapiteau. Rien n’ell plus irrégulier , plus
arbitraire dans Varchitecture égyptienne que l ’emploi
comme la compofition des chapiteaux ; on y en Voit
jufqu’à trois formes placées l’une au - deflus de
l’autre. ( Voye^ fig. ci-deflus).
Le chapiteau évafé ou à campane éprouve plû-
fieurs modifications dans fa forme. On en voit un
deffiné par Paul Lucas, qui eft taillée Amplement
en bifeau. C ’eft là le type primitif de cette forme
de chapiteau. On l’y voit fous le contour nud d’un
vafe fans aucun ornement. Quelquefois l’évafure
eft aflez prononcée, & le chapiteau fe termine
dans le bas par un arrondiffement qui lui donne
effectivement la forme d’un vafe o.u d’une cloche
renverfée. Cette reflemblance a fait croire que l’ar-
chiteCture avoit eu effectivement l’idée de repréfenter
un vafe fous la forme de ce chapiteau, qui eft le
même que le chapiteau corinthien des Grecs. Toutefois
lorfqu’on fe rend compte de toutes les variétés
que cette forme éprouve en Egypte, on fe perfuade
qu’il en faut chercher la raifon dans cette efpèce de
hafard, qui fuggère aux hommes certaines formes
pour l’agrément de l’oeil , fans aucun égard aux
conformités qu’elles peuvent avoir avec d'autres
objets. 11 y a beaucoup de fimilitudes de ce genre
entre des objets qui n’ont jamais eu un feul rapport
commun entr’ eux. Ainfi , Finftinet" feul
produit par tout, dans la configuration des vafes
la forme évafée ou rentrante , &. qui produit auffi
la forme contraire, c’eft-à-dire, celle à contours
bombés ou renflés, peut avoir auffi appliqué aux
chapiteaux cette double conformation.
Nous ayons d it, dans plus d’un endroit de ce
Dictionnaire, mais furtout au mot corinthien
qu’il falioit diftinguer la forme du chapiteau de ce
nom d’avec fon embelliffement. En Egypte, on
trouve l’une fans l’autre. Lorfqu’ on fait cette fépa-
ration', on voit difparoître beaucoup de fyftèmes
fur l’origine des chapiteaux. Le befoin de confolider,
d’exhaufler & de couronner la colonne, en fuggéra
par tout l’idée. Et ce befoin employa, pour cet
objet, des formes qui purent avoir été infpiréespat
d’autres objets, fans qu’on ait eu en vue de faire
unv imitation de ces objets.
La troifième forme de chapiteau égyptien, que
nous avons appelé chapiteau renflé , en donne la
preuve. A-t’on voulu imiter un vafe à contours
bombés , ©a le renflement que certains arbres,
enfr’autres le palmier , offrent à leur fomrnet quand
on les a ébranchés,ou fout Amplement n’a-t-on cher*
chc qu'à produire un exhauffement à la c o lo n n e , à
lui faire u*-? tête d’une forme différente , & même
contraire de celle du chapiteau à campane. Voilà,
' fans doute, le fujet d’une aflez vaine controverfe,
A l’égard de l’ornement de ce chapiteau, il n’ell
pas douteux que les motifs, comme on le dira, n’en
aient été puifés dans les plantes du pays, telles que
lé calice ou les fleurs du lotus. Mais fi les deffins,
qj-s nous avons, font juftes, on trouve auffi le chapiteau
bombé fans cette décoration ; on le voit ou
liffe ou couvert d'hiéroglyphes comme le relie de
la colonne. Nous favons que fa hauteur eft ordinairement
de fept pieds. Jufqu’à préfent, nous n’avons
rien de précis fur les proportions des autres cha- .
piteaux, les voyageurs n’ayant jamais pu fe procurer
les facilités néceflaires pour mefurer exactement
tous ces objets,
Tailloir.
On ne fauroit dire que les Egyptiens aient employé
précifément ce que dans l’architeCture grecque
on entend par abaque ou tailloir. Le tailloir
a pour objet utile de prélenter à l'architrave une
plus large affiette, & de mettre le chapiteau ou les
ornemens fous un abri sûr. En Egypte, ce qui fait
cette fonétion ne fe trouve point uni au chapiteau*
C ’eft ordinairement un dé de pierre carré, qui quel-
fois fort ou femble fortir du milieu même des chapiteaux
ornés de palmètes ou de fleurons. ( Vo)t\
les fig. ci-deflus ). Dans les chapiteaux a renflement,
un plateau qui en déborde le contour y tient lieu de
tailloir. Si l’on en croit les deffins de Pococke &
des autres voyageurs, cette partie de l’architecture
y feroit des plus irrégulières. Il y auroit des _cou-
ronnemens de chapiteaux aflez près de la forme du
corinthien;
b i j jà & î J1 y en auroit de toute efpèce de hauteur
& enfin il’ y au™1 des chapiteaux qui en feroient
.„nèretnentpri ^
f . auffi une ' vérité en architecture , que
les plaifirs y naiflent des befoins. L ’entablement
égyptien nous en offre la preuve. Cette partie
{f belle & fi riche de Farchite&ure grecque, ne
dut fa richeffe & fa beauté qu’à toutes les fervi-
tüdes auxquelles les rapports néceflaires des plafonds,
desfolives, dés combles & des toitures avoient
a*flujéti, & le modèle & fon imitation. Varchi--
ticlure égyptienne, fubordonnée dans fçs principes à
! moins de néceffités, puifa dans une fo.urcë moins,
féconde en beautés, On ne retrouve plus , dans fon
entablement, de divifions, & furtput.de divifions
nêcéflaire*. & fignificatives. Si quelques liftels, quel-
I ques bandes en interrompent la froide continuité,
ç’eft le caprice feul qui les y a introduits. Ils peuvent
y être,, comme ils y font réellement, placés arbi-
I trairement, (?Voye^ fig. 295;), On peut y tranfpofer
toutes ces parties, mettre en haut celles d’én bas &
en bas celles d’en .haut; on peut les multiplier ou
.les riduireTans y'&lefler aucune convenance.
Au'lieu des faillies '&"dçs profils, fortans & ren-
trans, qui donnent tant d’effet & de mouvement
aux epuronnemèns des édifices dans l’arçhiteClure
grecque, on trouve à peine de légères ondulations
dans l’entablement égyptien ; rien n’y eft (aillant.
Les moulures y font le plus fouyent renfoncées &
tailléesr éri' cireux conime les bas-réliéfs des hiéroglyphes.
C’eft tou jours le même principe de folidité
ou d’économie dé travail inspirée par l’ ufage del’ar-
[■ chitéCture fouterraine,& l’habitüde de tailler les mo-
numens à même la maffe > &qui doit par conféquent
; lie connoître que les lignes les plus droites & les er-
: remens les plus fimples.
O11 découvre fur un aflez bon nombre de parties
d’entablement, que les voyageurs, nous ontdonnées.
des compartimens de moulures, dans lefquels on
croiroit voir une forte d'analogie éloignée avec la
i divifion ternaire de l’entablement grec. Il ne fau-
[ roit fë fuppofer que l'architeCture grecque ait puifé
là les divifions ,;puifqu’elles repofent fur un fyftème
fans rapport avec le fyftème égyptien. On ne fauroit
non plus prêter à Varchitetture égyptienne, dans
[ ces divifions arbitraires, une intention qu’elle ne put
i avoir, puifqùe jamais elle ne dut vouloir repréfenter
dans ses couronnemens des parties de comble & de
frontons qu’elle ne connut jamais. On doit inférer
Seulement de ces légères fimilitudes , qu’ il y a né-
ceffairement dans toutes les architectures & dans la
plupart des oeuvres de la main de l’homme, beaucoup
de points qui fe reflemblent fans s’être imités ;
qu il y a des conformités d’objets qui ne font pas
pour cela des analogies, & des rapproçhemens fortuits
dus au hafard, c’eft-à-dire, à des caufes inconnues
plutôt qu’à la volonté ou à l’intention de
ceux qui les ont opérés. Il faut conclure delà qu’on
fie fauroit, dans des matières auffi flexibles à Fefprit
Diflion, d’Archit. Tome 11,
fyftématique, fe mettre trop en garde contre la
manie des fyftèmes.
Par exemple, fi nous en croyons les édifices de
nos voyageurs, ou retrouve auffi dans les formes
:même de l’entablement égyptien, celles des trois
efpèces de chapiteaux que nous avons reconnu être
les plus générales' en Egypte; c ’eft-a-dire, qu on r
ivoit des entablemens qui fe terminent par le haut
en ligne droite , d’autres, en ligne bombée & d’autres
en ligne concave. Ü ne peut etre là queftion
d’aucune imitation,* ni de palmier, ni de vafe, ni
de calice.ou bougon dè lotus. Cela doit rendre cir—.
iconfpeCt à prononcer fur l ’origine des formes de
'chapiteaux. .
Là terminailon toutèfois la plps ordinaire des
lentablemens égyptiens, eft.une forte de corniche en
iforme de cavet ou de grande feotie. On la voit a-
prefque t,qus les temples. Elle fe remarque dans tous
les ouvrages de bas- relief même, comme fur les bafes
1 & les piédeftaux des figures de Fobélifque de campo
i M'arfi, fur la table; ifia qu e ,& généralement" 4ans
; tout ce qui porte le câpCtère égyptien ;^car cette
"forme .de couronnement eft commune a d’autres
peuples q u i , fans doute,, puilerent. en Egypte le
goût1 de leur architecture. Elle ëxifte fur lés portes
de Perfepolis d’ une manière frappante"; elle fe
• retrouve fur le? rochers & dans les grottes qui font
autour de lérufalem.
On lit dans la nouvelle defeription abrégée des
' monumtn>s de.la haute Egypte ^ dont on a déjà parle ,
j qu’une corniche <le Thèbes iiriite, dans fa courbure ,
'l’inclinaifon de la brançh.e de.palmier. Nous ne
croyons pas que la branche inclinée du palmier ait
donné la forme concave des corniches. Mais il eft;
probable que le génie décoratif aura appliqué à
cette concavité l’ornement qui lui étoit le plus analogue
,& c’eft-là ce qne Fauteur de cette defeription
a voulu dire.
Au refte, les formes des couvertures en terraffe
des édifices égyptiens, étoient parfaitement d’accord
avec les formes fimples.„& fans, faillié des entable- ■
mens. A cet égard, il n’exifte aucun reproche à faire
à cette architecture. Elle étoit fo'ndée en raifon. Ce
qu’on peut dire, c’eft qu’elle ne fut pas conftituée
pour produire cette variété qui fait le charme des
yeux.
Plafonds.
La forme des. plafonds égyptiens fut egalement
très-monotone. Ayant ignoré l’ufage des vouffoirs
dont fe compofent les véritables voûtes , l’architecture
ne put introduire, dans les couvertures, que
très-peu de variété. Les plafonds ,y font conftam-
ment liffes comme celui de la chambre de la grande
pyramide, dont on a déjà parlé, & fe compofent
de grandes dalles de pierre étroitement liées enfem-
b le , ou quelquefois d’une feule pierre comme au
tombeau des douze gouverneurs, félon Diodore de
Sicile. Dans les' colonnades, les plafonds font tra-
I vççfés par des folives de "pierre qui pofënt furies
' On