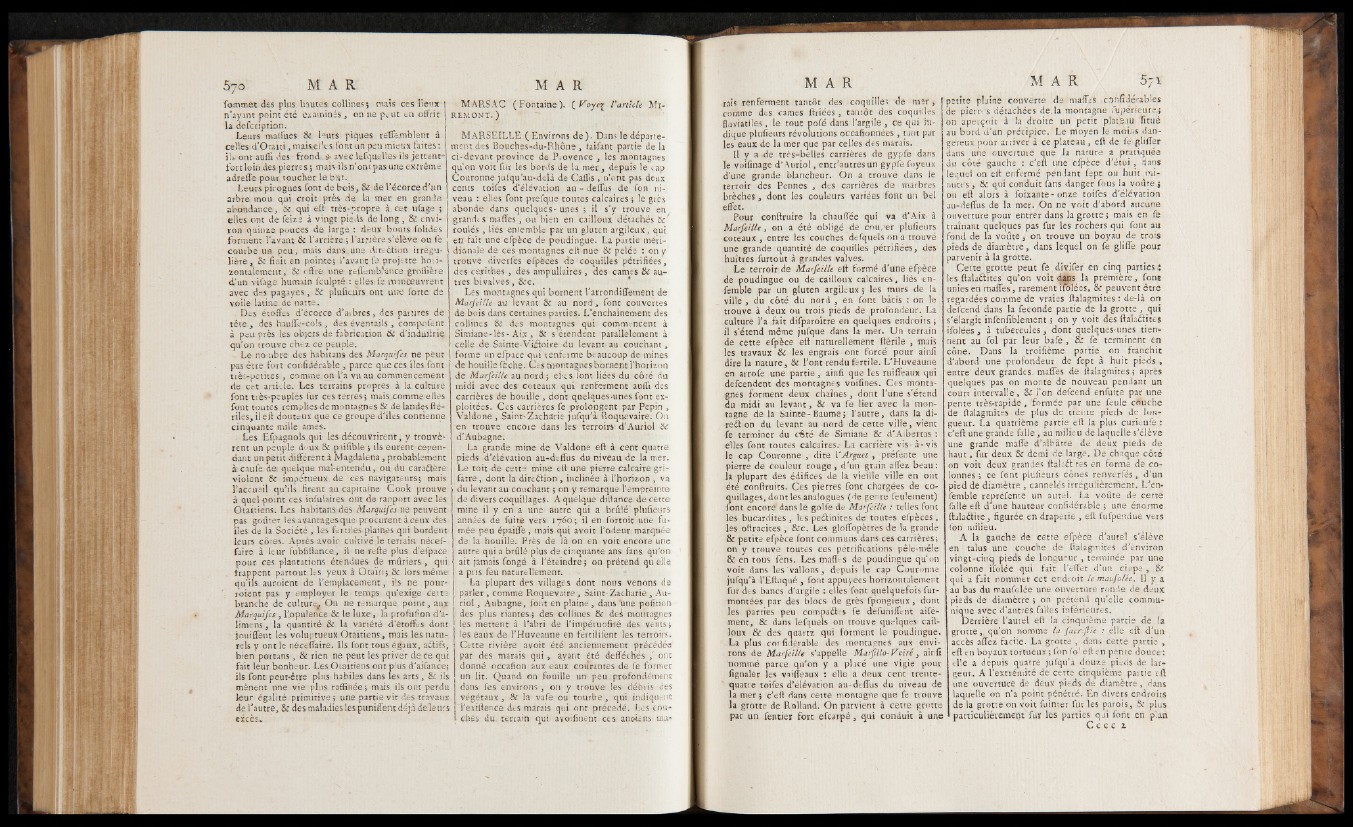
Commet des plus, toutes collines; triais ces lieux
n’ayant point été examinés , on ne peut en offrir
la. defeription.
Leurs maffues & leurs piques relïdmblent à
celles d’Oraïti, mais,el?es font un peu mieux faites:
il* ont au {fi des frond..» avec léfquelles ils jettent*
fort loin des pierre s j maïs ils n'ont pas une extrême
adreffe pour toucher le bMt.
Leurs pirogues font de bois, & de l’écorce d’ un
arbre, mou qui croît près de la mer en grande
abondance, & qui eft très-propre à eet ufage ;
elles ont de feize à vingt pieds de lo n g , & environ
quinze pouces de large : deux bouts folides
forment l'avant & l'arrière ; l'arrière s'élève ou fe
courbe un peu, mats dans-,.une dineétiun irréguliè
re . & finit en pointe, l'avant fe- projette ho 1-
zontalement, & offre une refiembbance groflîère
d’un vilàge humain fculpté : elles fe manoeuvrent
avec des pagayes, & pluûeûrs ont utîe forte de
voile latine.de natte.
Des étoffes d'écorce d'arbres, des parures de
tête., des hauffe-cols, des éventails, compofent
à peu près Les objets, de fabrication & d'indufîrie,
qu’on trouve chez ce peuple.
- Le nombre des habitans des Marquifes, ne peut
pas être fort confidérable, parce que ces. îles font
très-petites , comme^on l'a vu au commencement
de cet article. Les terrains propres à la. culture
font très-peuplés fur ces terres; mais comme elles
font toutes remplies de montagnes & de landes fté-
riles, il eft douteux que ce groupe d'îles. contienne
cinquante mille âmes.
. Les Efpagnols qui les découvrirent, y trouvèrent
un peuple dou x& paifible ; ils eurent cependant
un petit différent à Magdalena , probablement
MARSAC (Fontaine). ( Voye£ l'article Mi-
REMONT.)
MARSEILLE (Environs d e ) . Dans le département
à caufe d& quelque malentendu, ou du caractère
violent & impétueux de 'ce s navigateurs; mais
L'accueil qu*ils. firent au capitaine Cook prouve
à quel point ces infuiairçs ont de rapport avec les
Otaïtiens. Les habitans-des Marquifes.ne peuvent
pas goûter lesavantagesque procurent à.ceux des
îles de la Société , les fertiles plaines qui bordent
Leurs côtes. Après avoir cultivé.le terrain nécef-
faire à leur fubfiftance, il ne refte plus d’efpace
pour ces plantations étendues de mûriers, qui.
frappent partout, les yeux à O tait i; & lors même
qu’ils, auroient de l’emplacement, ils. ne pourraient
pas y employer le temps qu’exige cette
branche de cultur^.On ne remarque, point, aux
Marquifes-, ^opulence & le lu xe , la profufion d'ali
mens , la quantité & la variété d'étoffes dont
jouiffent les voluptueux Otaïtiens., mais les naturels
y ont le néceffaire. Ils font tous égaux, aélifs,
bien portans:, & rien ne peut les priver de. c e qui
fait leur bonheur. L'es Otaïtiens ont plus d’aifance;
ils font peut-être plus habiles dans les arts, & ils
mènent une vie plus raffinée; mais ils ont perdu
leur égalité primitive ; une partie vit des travaux
de l'autre, & des maladies les piuiiifent déjà deletirs
des Bouches-du-Rhône, faifant partie de la
ci-devant province de Provence , les montagnes
qu’on voit fur les bords de la mer, depuis le c ap
Couronne jufqu'au-delà de Caflis, n’ont pas deux
cents toifes d’élévation au - deffus de fon niveau
: elles font prefque toutes calcaires ; le grès
abonde dans quelques-unes ; il s'y trouve en.
grandes ma fies, ou bien en cailloux détachés 6c/
roulés, liés enlemble par un gluten argileux, qui
en fait une efpèce de poudingue. La partie méridionale
de ces montagnes eft nue & pelée : on y
trouve divevfes efpèces de coquilles pétrifiées,
des cerithes , des ampullaires , des cames & autres
bivalves , &rc.'
Les montagnes qui bornent l’arrondiffement de
Marfeille au levant & atf nord, font couvertes
de bois dans certaines parties. L'enchaînement des
collines & des montagnes qui commencent à
Simiane-lès- A ix , & s'étendent parallèlement à
celle.de Sainte-Vi$oire du levant au couchant,
forme un efpace qui renferme beaucoup de mines
de houille fèche. Ces montagnes bornent l’horizon
de Marfeille au nord; eiks font liées du côté du
midi avec des coteaux qui renferment auffi des
carrières de houille, ddnt quelques-unes font exploitées.
Ces carrières fe prolongent par Pépin ,
Valdone, Saint-Zacharie jufqu'à Roquevaire.. On
en trouve encore dans les terroirs d’Auriol 6c
d'Aubagne.
La grande mine de Valdone eft à cent quatre
pieds d’élévation au-deffus du niveau de la mer.
Le toit de cette mine eft une pierre calcaire gri-
fàtre, dont la direction , inclinée à l'horizon , va
du levant au couchant ; on y remarque l’empreinte
de divers coquillages. A quelque diftance de cette
mine il y en a une- autre qui a brûlé' plufieurs
années de fuite vers 1760; il en fortoit une fu*
mée peu épaiffe, mais qui avoir- l’odeur marquée
de la houille. Près de là on en voit encore une
autre qui a brûlé plus de cinquante ans fans qu’on
ait jamais fongé à l’éteindre ; on prétend qu elle
a pris feu naturellement.
La plupart des villages dont nous venons de
parler , comme R.oquevaire , Saint-Zacharie Au-
r io l, Aubagne, font en plaine, dans'une pofition
des plus riantes.; des collines & de£ montagnes
les mettent à l'abri de l'impétuoftté des vents;
les eaux de l'Huveaune en fertilifent les terroirs.
Cette rivière avoir été anciennement précédée
par des marais qui , ayant été defféchés ƒ ont
donné occafion aux eaux courantes de fe former
un lit. Quand on fouille un peu. profondément
dans fes environs, on y trouve les débris des
végétaux, & la vafe ou. tourbe, qui indiquent
Texifteh.ee des marais qui ont précédé. Les couches
du. terrain qui avoifinent ces anciens ma,-
rais renferment tantôt des coquilles de mer,
comme des cames ftriées, tantôt des coquilles
fluviatiles ,.Ie tout pofé dans l'argile, ce qui indique
plufieurs révolutions occafionnées , tant par
les eaux de la mer que par celles des marais.
Il y a de très-belles carrières de gypfe dans
le voifinage d’ Auriol, entr'autresun gypfe foyeux
d’une grande blancheur. On a trouvé dans le
terroir des Pennes , des carrières de marbres
brèches, dont les couleurs variées font un bel
effet.
Pour conftruire la chauffée qui va d’ Aix* à
Marfeille, on a été obligé de couder plufieurs
coteaux, encre les couches defquels on a trouvé
une grande quantité de coquilles pétrifiées, des
huîtres furtout à grandes valves.
Le terroir de Marfeille eft formé d'une efpèce
de poudingue ou de cailloux calcaires, liés en-
femble par un gluten argileux ; les murs de la
v ille , du côté du nord , en font bâtis : on le
trouve à deux ou trois pieds de profondeur. La
culture l’a fait difparoïtre en quelques endroits ;
il s’étend même jufque dans la mer. Un terrain
de cette efpèce eft naturellement ftérile , mais
les travaux & les engrais ont forcé pour ainfi
dire la nature, & l’ont rendu fertile. L'Huveaune
en arrofe une partie, ainfi que les ruiffeaux qui
defeendent des montagnes voifines. Ces montagnes
forment deux chaînes , dont l'une s'étend
du midi au levant, & va fe lier avec la montagne
de la Sainte-Baume; l’autre, dans la di-
reéEon du levant au nord de cette v ille, vient
fe terminer du c£té de Simiane & d'Aibertas :
elles font toutes calcaires.'La carrière vis-à-v is
le cap Couronne , dite Y Arguet, préfente une
pierre de couleur rouge, d’un grain affez beau:
la-plupart des édifices de la vieille ville- en ont
été conftruits. Ces pierres font chargées de coquillages,
dont les analogues (de genre feulement)
font encore dans le golfe de Marfeille : telles font
les bucardites, les peélinites de toutes efpèces,
les oftracites , & c . Les gloffopètres de la grande
& petite efpèce font communs dans ces carrières;
on y trouve toutes ces pétrifications pêle-mêle
& en tous fens. Les maffes de poudingue qu'on
voit dans les vallons, depuis le cap Couronne
jufqu'à l’Eftaqué , font appuyées horizontalement
fur des bancs d'argile : elles font quelquefois fur-
montées par des blocs de grès fpongieux, dont
les parties peu compactes fe défuniffent aifé-
ment, & dans lefquels on trouve quelques cailloux
& des quartz qui forment le poudingue.
La plus cor fidéjable des montagnes aux environs
de Marfeille s’appelle Marfillo-Veiré, ainfi
nommé parce qu'on y a placé une vigie pour
fignaler les vaiffeaux : elle a deux cent trente-
quatre toifes d'élévation au-dtffus du niveau de
la mer ; c’ eft dans cette montagne que fe trouve
la grotte de Rolland. On parvient à cette grotte
par un fentier fort efearpé, qui conduit à une
petite plaine couverte de maffrS cnnfidérables
de pierres détachées de.la montagne fypérieure.;
on aperçoit à la droite un petit plat$au ïïtue
au bord d’un précipice. Le moyen le moins dangereux
pour arriver à ce plateau, eft de fe gliffer
dans une ouverture que la nature a pratiquée
du côté gauche : c'eft une efpèce d’étui , dans
lequel on eft enfermé pendant fept ou huit minutes
, 6c qui conduit fans danger fous la voûte j
on eft alors à foixante - onze toifes d'élévation
au-deffus de la mer. On ne voit d'abord aucune
ouverture pour entrer dans la grotte ; mais en fe
traînant quelques pas fur les rochers qui font au
fond de la v o û te , on trouve un boyau de trois
pieds de diamètre, dans lequel on fe gliffe pour
parvenir à la grotte.
Cette grotte peut fe divifer en cinq parties !
les ftalaétites qu’on voit d p s la première, fon«
unies en maffes, rarement îiolées, & peuvent être
regardées comme de vraies ftalagmites : de-là on
defeend dans la féconde partie de la grotte , qui
s'élargit infenfiblement ; on y voit des ftalaétites
ifolées, à tubercules, dont quelques-unes tiennent
au fol par leur b a fe , & fe terminent en
cône. Dans la troifième partie on franchit
d’abord une profondeur de fept à huit pieds ^
entre' deux grandes, maffes de ftalagmites ; après
1 quelques pas on monte de nouveau pendant un
court intervalle, 6c l’on defeend enfuite par une
pente très-rapide, formée par une feule couche
de ftalagmites de plus de trente pieds de longueur.
La quatrième partie eft la plus curieufe :
c'eft une grande falle, au milieu de laquelle s'élève
une grande maffe d'albâtre de deux pieds de
haut, fur deux & demi de large. De chaque côté
on voit deux grandes ftalaét tes en forme de colonnes
; ce font plufieurs cônes renverfés, d'un
pied de diamètre , cannelés irrégulièrement. L'én-
femble repréfente un autel. La voûte de certe
falle eft d'une hauteur confidérable; une énorme
ftalaétite, figurée en draperie, eft fufpendue vers
fon milieu.
A la gauche de cette efpèce d'autel s'élève
en talus une couche de ftalagmites d’environ
vingt-cinq pieds de longueur, terminée par une
colonne ifoiée qui fait l’effet d'un cippe , &
qui a fait nommer cet endroit le maufolée. Il y a
au bas du maufolée une ouverture ronde de deux
pieds de diamètre ; on prétend qu'elle communique
avec d'autres fa) le s inférieures.
Derrière l’autel eft la cinquième partie de la
grotte, qu’on nomme la facrljlie : elle eft d’ un
accès affez facile. La grotte , dans cette partie ,
eft en boyaux tortueux ; fon fol eft en pente douce :
elle a depuis quatre jufqu'à douze pieds de largeur.
A l’extrémité de cette cinquième partie eft
une ouverture de deux pieds de diamètre, dans
laquelle on n'a point pénétré. En divers endroits
de la grotte on voit fuinter fur les parois, & plus
1 particulièrement fur les parties qui font en plan