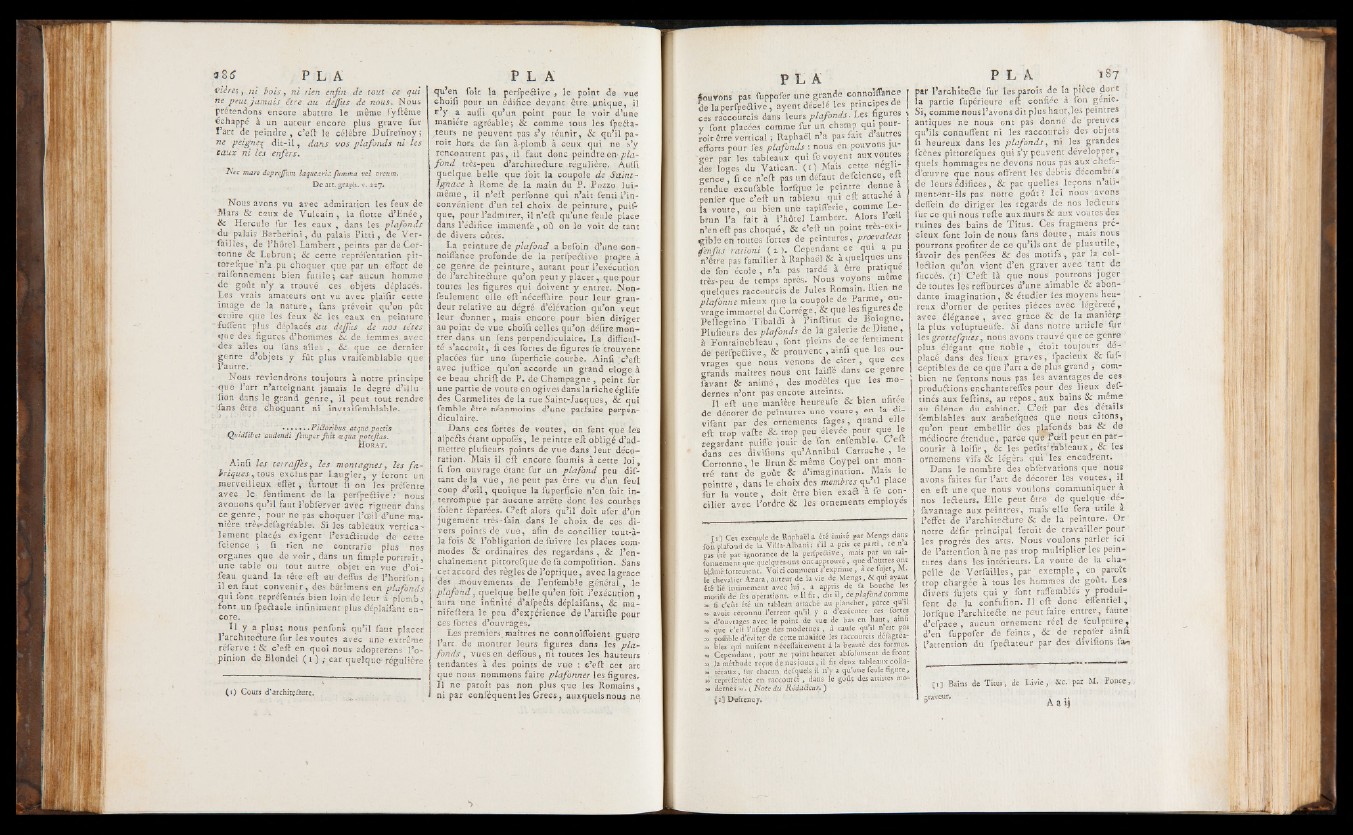
■ vieres 3 ni bois y ni rien enfin de tout ce qui
ne p eut jam a is être au deffus- de nous. Nous
prétendons encore abattre le même fyftême
échappé à un auteur encore plus grave fur
l ’art de peindre, c’eft le célèbre Dufrei'noy;
ne peigne% d it - il, dans vos plafonds ni-les
taux' ni les enfers.
■ Nfc mare depreffum laqueariz fumma vel orcum.
De art. graph. v. 227.
Nous avons vu avec admiration les feux de
Mars & ceux de V u lca in , la flotte d’Enée,
& Hercule fur les, eaux , dans les plafonds
du palais Barberini, du palais P it t i, de Ver-
failles, de l’hôtel Lambert, peints par de Cor-
tonne & Lebrun; & cette représentation pit-
torefque'n’a pu choquer que par un effort de
raifonnement bien futile ; car aucun homme
de goût n’y a trouvé ces objets déplacés.
Les vrais amateurs ont vu avec plaifir cette
image de la nature, fans prévoir qu’on pût
croire que les feux & les eaux en peinture
■ •fuilent plus déplacés au dejfus de nos têtes
que des figures d’hommes &: de femmes avec
des ailes ou fans ailes , & que ce dernier
genre d’objets y fût plus vraifemblable que
l’autre.*
Nous reviendrons toujours à notre principe
que l’art n’atteignant jamais le degré d’ ülu -
lion dans le grand genre, il peut tout rendre
' fans ê t r e , . choquant ni invraifemblable.
_......... •••••-. Picîo'ribus, atqiie poetïs
Quidlibet audendi femperfu.it caqüa petejïas.
Horat.
Ainfi les terraffes, les montagnes, les f a briques,
tous exclus par Laugier, y feront un
merveilleux effet, furtout fi on les préfente
avec le- fentiment de la pèrfpe&ive : nous’
avouons qu’ il faut l ’obferver avec rigueur da'hs
ce genre, pour ne pas choquer l’oeil d’ une manière
tres-défagréable. Si les tableaux vertical
lement placés exigent l’exaélitude de cette
fcience ; fi rien ne contrarie plus nos
organes que de voir , dans un fimple portrait,
une table ou tout autre objet en vue d’oi-
feau quand la tête eft au deffus de l’horifon ;
il en faut convenir, des.bâfimens en plafonds
qui font repréfèntés bien loin de leur à plomb ,
font un fpeélacle infiniment'plus dépîaifant encore.
I l y a plus; nous penfons qu’ il faut placer
l ’archite&ure fur les voûtes avec une extrême
referve : & c’ eft en quoi nous adopterons l’opinion
de, Blondel ( 1 ) ; car quelque' régulière
(1) Cours d’archiïç&ure.
qu’ en foit la perfpeétive le point de vue
choifi pour un édifice devant être pnique, il
n’ y a aufli qu’ un point pour le voir d’une
manière agréable; & comme tous les fpeéla-
^eurs ne peuvent pas s’ y réunir, & qu’ il pa-
roit hors, de l’on à-plomb à ceux qui ne s’y
rencontrent pas, il faut donc peindre en>plafond
très-peu d’architeélure régulière. Aulfi
quelque belle que foit la coupole de Suint-
Ignace à Rome de la main du P. Pozzo lui-
même , il n’efl: perfonne qui n’ait fenti l’ inconvénient
d’un tel choix de peinture, puifc
que, pour l’admirer, il n’efl: qu’une feule place
dans l’édifice immenfe, où on le voit de tant
de divers côtés.
La peinture .de plafond a befoin d’ une con-
noiffance profonde de la perfpeélive propre à
ce genre de peinture, autant pour l’exécution
de l ’architeâure qu’on peut y placer, que pour
toutes les figures qui doivent y entrer. Non-
feulement elle eft nécelfaire pour leur grandeur
relative au dégré d’élévation qu’on veut
- leur donner , mais encore pour bien diriger
au point de vue choifi celles qu’on défire, montrer
dans un Cens perpendiculaire. La difficulté
s’accroît, fi ces fortes de figures le trouvent
placées fur une fuperfiçie courbe. Ainfi ‘c’efl:
avec juftice qu’on accorde un grand eloge à
ce beau chrift de P. de Champagne , peint fur
une partie de voûte en ogives dans la riche églife
des Carmélites de la rue Saint-Jacques, & qui
femble être néanmoins d’une parfaite perpendiculaire.
Dans ces fortes de voûtes, on Cent que les
afpeéls étant oppofés, le péintre eft obligé d’admettre
plufieurs points de vue dans leur décoration.
Mais il eft encore fournis à cette lo i,
fi Ion ouvrage étant fur un plafond peu dictant:
de la vu e , ne peut pas étiré vu d’un feul
coup d’oeil, quoique la fuperfiçie n’ en foit interrompue
par aucune arrête dont les courbes
foiënt féparées. Ç’ eft alors qu’il doit ufer d’ un
jugement très-fain dans le choix de ces divers
points de vue, afin de concilier tout-à-
la fois & l’obligation dé fuivre les places commodes
& ordinaires des regardans , & l ’enchaînement
pittorefque de fa compofition. Sans
cet accord des règles de l’optique, avec la grâce
des mouvements de l’enfembie général., le
plafond y quelque belle qu’ en foit l’éxéc.ution ,
aura une infinité d’ afpe&s déplaifans, & ma-
nifeftera le peu d’expérience de l’artifte pour
ces fortes d’ouvrages.
Les premiers, maîtres ne connoiffoient guere
l’art, de montrer leurs figures dans les p la fonds
, vues en deffous, ni toutes les hauteurs
tendantes à des points de vue : e’eft cet art
que nous nommons faire plafonner les figures.
Il ne paroît pas non plus que les Romains,
ni par conféquent les Grecs ? auxquels nous ne.
S
pouvons' pas fuppofer une grande connoiffance |
de laperfpeftive, ayent décelé les principes de |
ces raccourcis dans leurs plafonds. Les figures j
y font placées comme fur un champ qui pour-
roit être vertical ; Raphaël n’ a pas fait d autres
efforts pour fes plafonds : nous en pouvons ju-
V e r par les tableaux quife voy en t aux voûtes
des loges du Vatican. ( 1 ) Mais cette négligence
, fi ce n’efl: pas un défaut defcience, elt
rendue excufable lorfque le peintre donne a
penlër que c’ eft un tableau qui eft attache a
la voûte, ou bien une tapifferie, comme Lebrun
l ’a fait à l’ hôtel Lambert. Alors 1 oeil
n’en eft pas choqué, & c’eft un point très-exigible
en toutes fortes de peintures, proevaleat
fenfus rationi ( a ) . Cependant ce qui a pu
n’être pas familier à Raphaël & a quelques uns
de Ion école, n’ a pas tardé à être pratique
très-peu de temps après. Nous voyons meme
quelques raccourcis de Jules Romain. Rien ne
plafonne mieux que la coupole de Parme, ouvrage
immortel du Corrége, & que les figures ce
Pellegrino Tibaldl à l’ inftitut de Bologne.
Plufieurs des plafonds de la galerie deDiane,
à Fontainebleau , font pleins de ce fentiment
de pérfpeâive , & prouvent , ainfi que les ouvrages
que nous venons de citer , que ces
grands maîtres nous ont laiifé dans ce genre J
lavant & animé , des modèles que les modernes
n’ont pas encôte atteints. ^ ,
Il eft une manière heureufe & bien ufitee..
de décorer de peintures une voûte, en la di-
vifant par des ornements fages, quand elle
eft trop vafte & trop peu élevée pour que le
regardant puiffe jouir de fon enfemble. C elt
dans ces divifions qu’Annibal Carrache , le
Cortonne, le Brun & même Çoypel ont montré
tant de goût & d’imagination. Mais le
peintre , dans le choix des membres qu’ il place
fur la voûte , doit être bien exaét à fe concilier
avec l’ordre & les ornements employés
- rr] Cet exemple de Raphaël a été-imité par Mengs dans
fon plafond de la Villa-Albani ; s’ il a pris ce parti, ce n a
pas été pat ignorance de la peifpe&ive ^ mais par un rai-
fonoement que quelques-uns ont approuvé, que d autres ont
blâmé fçrtement. Voici comment s’exprime , a ce lujet, M.
le chevalier Azara, auteur de la vie de Mengs , & qui ayant
été lié intimement avec lui , a appris de fa bouche les
motifs die fes opérations, v II fit , dit i l , ce plafond comme
» fi c’eût été un tableau attaché au plancher, parce qu’il
s» avoir reconnu l’erreur qu’il y ? d’exécuter ces fortes
y* d’ouvrages avec le point de vue de bas en ^hauc, ainfi
» que c’ell l’ufage des modernes , à caufe qu’il n’ est pas
» poflîble d’éviter de cette manière les raccourcis défagtea-
blés qui nuifent nécéflairement à la beauté des formes.
» Cependant, pour ne point heurter abfolumcnt de front
s» la méthode reçue de nos jours, il fit deux tableaux colla-
» téraux, fur chacun, defquels il n’y a qu’une feule figure,
»j r,epféfcntée en raccourci, dans le goût des artistes ino-
m derrifes ’»’. ( Note du Rédacteur. )
£2] Dufrenoy.
par l’arcbîteéle fur les parois de la pièce font ;
la partie fupérieure eft confiée à fon génie.
Si, comme nous l’avons dit plus haut,les peintres
antiques ne nous ont pas donné de preuves
qu’ ils connuffent ni les raccourcis des objets
fi heureux dans les plafonds, ni les grandes
fcènes pittorefques qui s’y peuvent développer,
quels hommages ne devons nous pas aux chefs-
d’oeuvre que nous offrent les débris décombres
de leurs édifices, & par quelles leçons n’ali*«
mentent-ils pas notre goût? Ici nous avons
delfein de diriger les regards de nos lecteurs
fur ce qui nous refte aux murs & aux voûtes des
ruines des bains de Titus. Ces fragméns précieux
font loin de nous fans doute, mais nous
pourrons profiter de ce qu’ ils ont de plus u tile,
favoir des penfées & des motifs, par la. col-
leélion qii’on vient d’ en graver avec tant de
fuccès. (1) C’eft là que nous pourrons juger
de toutes les reffources d’ une aimable & abondante
imagination , & étudier les moyens heureux
d’orner de petites pièces avec légèreté,
avec élégance , avec grâce & de la manier#
la plus- voluptueuse. Si dans notre article fur
les grottefques, nous avons trouvé que ce genre
plus ' élégant que noble , étoit toujours déplacé
dans dès lieux graves, lpacieux & fui-:
ceptibles de ce que l’ art a de plus grand , combien
ne Tentons nous pas les avantages de ces
produ&ions er.chantereffes pour des lieux del-
tinés aux feftins, au repos , aux bains & meme
au filënce du cabinet. C’ eft par des détails
femblables aux arabefques que nous citons,
qu’on peut embellir des plafonds bas & de
médiocre étendue, parce què ï^oèVl peut en parcourir
à loifir, & les petits'tableaux., & les
ornemens vifs & légers qui les encadrent.
Dans le nombre des obfervations que nous
avons faites fur l’art de décorer les voûtes, il
en eft une que nous voulons communiquer a
nos leéleurs. Elle peut être de quelqtie-de-
favantage aux peintres, mais elle fera utile a
l’effet de l’archite&ure & de la peinture. Or
notre défir principal feroit de travailler pour
les progrès des arts. Nous voulons parler ici
de l’attention à.ne pas trop multiplier les peintures
dans les intérieurs. La voûte de la chapelle
de Verfailles, par exemple, en paroît
trop chargée à tous les hommes de goût. Les
divers fujets qui y font raflembles y produi-
fent de la confufion. Il eft donc ëflentiel,
lorfque l’architeae ne peut faire entrer, faute
d’efpace , aucun ornement reel de fçulpture,
d’en fuppofer de feints, & de repol’er ainfi,
l’ attention du fpeaateur par des divifions fa«
[ 1] Bains de Titus, de Livle ,■ &c. par M. Ponce,
sraveur, • *v
p A a 1î