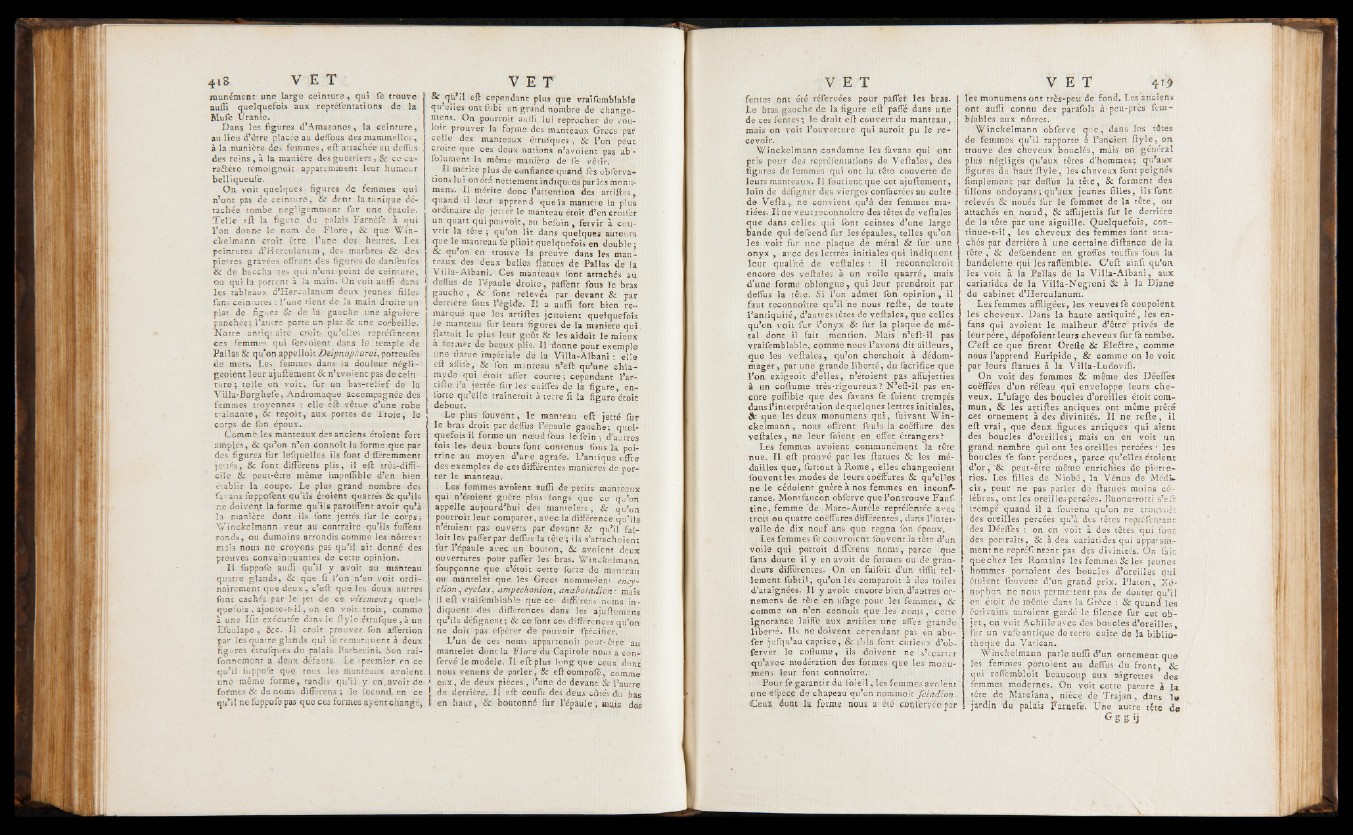
anunémenc une large ceinture, qui fê trouve
aulîi quelquefois aux repréfentations de la
Mufe Uranie.
Dans les figures d’Amazones, la ceinture,
au lieu d’être placée au defious des mammelles,
à la manière des femmes, eft attachée au defius .
des reins, à la manière des guerriers, & ce caractère
témoignoit apparemment leur humeur
belliqucufe.
On voit quelques figures de femmes qui
n’ ont pas de ceinture, & dent la tunique dé1
tachée tombe négligemment fur une épaule.
T e lle eft la figure du palais Farnèfe à qui
l ’on donn-e le nom de F lo re , & que Win-
ckelmann croit être l’une des heures. Les
peintures d’Herculanum, des marbres & des
pierres gravées offrent des figures de danfeufes
& de bacchantes qui n’ont point de ceinture,
ou qui la portent à la main. On voit au {fi dans
les tableaux d’Herculanum deux jeunes filles
fans ceintures : l ’ une tient de la main droite un
plat de figues 8c de la gauche une aiguiere
panchée; l ’autre porte un plat & une corbeille.
Notre antiquaire croit- qu’ elles représentent
ces femmes qui fervoient dans le temple de
Pallas 8c qu'on appeUoit Deipnopuorai, porteufes
de mets. Les femmes dans ia douleur négli-
geoient leur ajuftement & n’ avoient pas de cein -
tu re ; teile.on voit, fur un bas-relief de la
Villa-Borghefe, Andromaqite accompagnée des
femmes troyennes : elle eft vêtue d’une robe
traînante, & reçoit, aux portes de Tro ie , le
corps de l’on époux.
Comme les manteaux des anciens étoient fort
amples, & qu’ on n’ en connoît la forme que par
des figures fur lefquelles ils font différemment
jettes, & font différens plis, il eft très-difficile
8c peut-être même importable d’en bien
établir la coupe. Le plus. grand nombre des
fa vans fuppofent qu’ ils étoient quarrés & qu’ ils
ne doivent la forme qu’ils parôiffent avoir qu’ à
la manière dont ils font jettés fur le corps;
\V inckeîmann veut au contraire qu’ils fuffent
ronds, ou dumoins arrondis comme les nôtres:
mais nous ne croyons pas qu’ il ait denné des
preuves convainquantes de cette opinion.
I l fuppofe auffi qu’ il y avoit au manteau
quatre glands, & que fi l’on n’ en voit ordinairement
que deux, c’eft que les deux autres
font cachés par le jet de ce vêtement,* quelquefois
, ajoute-t-il, on en voit trois, comme
à une Ifis exécutée dans le ftyle étrufque, à un
Efculape , & c. I l croit prouver fon aflertion
par les quatre glands qui fe remarquent à deux
figures etrufques du palais Barberini. Son rai-
fonrvement a deux défauts. Le îpremier en ce
qu’ il fuppofe que tous les manteaux avoient
une même forme, tandis qu’ il y en.avoit de
formes & de noms différens; le fécond, en ce
qu’ il ne fuppofe pas que ces formes ayent changé,
& ^qh’ il eft cependant plus que vraifemblable
qu elles ont fubi un grand nombre de change-
mens. On pourroit aufii lui reprocher de vouloir
prouver la forme des mantèaux Grecs par
celle des manteaux étrulques -, & l’ cm péut
croire que ces deux nations n’avoient pas ab-
folument la même manière de fe vêtir.
U mérite plus de confiance quand fes obferva-
tionslui on été nettement indiquées parles mon u-
mens. Il mérite donc l’attention des artiftes,
quand il leur apprend que la manière la plus
ordinaire de jetter le manteau étoit d’ en c roi 1er
un quart qui pou voit, au befoin , fervir à couvrir
la tête ; qu’on lit dans quelques auteurs
que le manteau fe plioit quelquefois en double ;
8c qu on en trouve la preuve dans les manteaux
des deux belles ffatues de Pallas de la
Villa-Albani. Ces manteaux font attachés au
defius de l’épaule droite, paffent fous le bras
gauche , & font relevés par devant & par
derrière fous l’égide. I l a aufii fort bien remarqué
.que les artiftes jettoient quelquefois
le manteau fur leurs figures de la manière qui.
flattoit le plus leur goût & les aidoit le mieux
a former de beaux plis. I l donne pour exemple
une rtarue impériale de la Villa-Albani : elle
eft affile, & fon manteau n’eft qu’une chla-
myde qui étoit affez courte; cependant l’ar-
tifte l’a jettée furies cuiffes de la figure, en-
forte qu’elle traîneroic à terre fi la figure étoit
debout.
Le plus fouvent, le manteau eft jette fur
le bras droit par delfus l’épaule gauche; quelquefois
il forme un noeud fous le fein ; d’autres
fois les deux bouts font contenus fous la poitrine
au moyen d’ ure agrafe. L’ antique offre
des exemples de cés différentes manières de porter
le manteau.
Les femmes avoient aufii de petits manteaux
qui n’éroient guère plus-longs que ce qu’on
appelle aujourd’hui des manteîets, & qu’on
pourroit leur comparer, avec la différence qu’ils
n’étoient pas ouverts par devant & qu’ il falloir
les palier par defius la tête ; ils s’atrachoient
fur l’épaule avec un bouton, & avoient deux
ouvertures pour pafler les bras. Winckelmann
foupçonne que c’étoit cette forte de manteau
ou niantelet que les Grecs nommoient enev-
clion, cyclas, ampechonion, anaboladion \ mais
il eft vraifemblable que ce:- différens noms indiquent
des différences dans les ajuftemens
qu’ils défignent; 8c ce font ces différences qu’on
ne doit pas efpérer de pouvoir fpécifier.
L’ un de ces noms appartenoir peut-être au
niantelet dont la Flore du Capitole nous a con-
fervé le modèle. Il eft plus long que ceux dont
nous venons de parler, & eft oompofé, comme
eux , de deux pièces, l’une de devant 8c l’autre
de derrière. Il eft coufu des deux côtés du bas
en haut, & boutonné fur l’épaule; mais dos
fentes ont été réfervées pour parte f les bras.
Le bras gauche de la figure eft parte dans une
de ces fentes; le droit eft couvert du manteau ,
mais on voit l’ouverture qui auroit pu Je recevoir.
Winckelmann condamne les favans qui ont
pris pour des repréfentations de Veftales, des.
figures de femmes qui ont la tête couverte de
leurs manteaux. I l foutientque cet ajuftement,
loin de défigner des vierges çonfacrées au culte ;
de V e fta , ne convient qu’ à des femmes mariées.
Une veutreconnoîtfe des têtes de veftales 1
que dan-s celles qui font ceintes d’une large
bande qui defeena fur les épaules, telles qu’o n -
les voit fur une plaque de métal & fur une
onyx , avec des lettres initiales qui indiquent
leur qualité de veftales : il reconnoîtroit
encore des veftales à un voile qnarré, mais
d’une forme oblongue, qui leur prendroic par
defius la tête. Si l’on admet fon opinion , il
faut reconnoître qu’il ne nous refte, de toute
l ’antiquité, d’autres têtes de veftales, que celles
qù’on voit fur l’onyx & fur la plaque de métal
dont il fait mention. Mais n’ eft-il pas
vraifemblable, comme nous l’avons dit ailleurs,
que les veftales, qu’on cherchoit à dédommager,
par une grande liberté, du facrifice que
l ’on exigeoit d’elles, n’étoient pas afiujetties
à un coftume très-rigoureux? N ’efi-il pas encore
poffible que des favans fe foient trompés
dans l’ interprétation de quelques lettres initiales,
9c que les deux monumens q ui, fuivant W in ckelmann
, nous offrent feuls la coëfture des
veftales, ne leur foient en effet étrangers?
Les femmes avoient communément la tête
nue. I l eft prouvé par les ftatues & les médailles
que, lurtout à Rome, elles changeoient
fouvent les modes de leurs coëffures & qu’ elles
ne le cédoienr guère à nos femmes en inconf-
tance. Montfaucon obferve que l’on trouve Fauf-
tine, femme 'de Mare-Atirèle repréfentée avec
trois ou quatre coëffures différentes, dans l’ intervalle
de dix neuf ans que régna fon époux.
Les femmes fe couvroient fouvent la tête d’ un
voile qui portoit différens noms, parce que
fans doute il y en avoit de formes ou de grandeurs
différentes. On en faifoit d’un tîfiii te llement
fubtil, qu’on les comparoit à des toiles
d’araignées. J1 y avoit encore bien, d’autres or-
nemens de tête en ufage pour les femmes, 8c
comme on n’ en co-nnoît que les noms, cette
ignorance laiffe aux artiftes une afiez grande
liberté. Ils ne doivent cependant pas en abii-:
fer jufqu’ au caprice, & s’ ils font curieux d’ob-
ferver le coftume, ils doivent ne s’écarter
qu’avec modération des formes que les monu-
jnens leur font connoître.
Pour fe garantir du fô le il, les femmes avoient
une efpèce de chapeau qu’on nommoit fçiadion.
Ceuç dont la forme nous a été çôrçlbryée par
les monumens ont très-peu de fond. Les anciens
ont aufii connu des- parafols à-peu-près fem-
blables aux nôtres.
Winckelmann obferve q u e , dans les têtes
de femmes qu’ il rapporte à l’ancien f ty le , on
trouve des cheveux bouclés, mais en général
plus négligés qu’aux têtes d’hommes; qu’aux
figures du.haut f ty le , les cheveux font peignés
fimplement par defius la tête, & forment des
filions ondoyans; qu’aux jeunes filles, ils font
relevés & noués fur le fommet de la tête, ou
attachés en noeud, & affujettis fur le derrière
de la tête par une aiguille. Quelquefois, con-
tinue-t-il, les cheveux des femmes font attachés
par derrière à une certaine diftance de la
tête , & defeendent en grofles touffes fous la
bandelette qui les raffemble. C’ eft a'mfi qu’on
les voit à la Pallas de la Villa -Alb ani, aux
cariatides de la Villa-Negroni & à la Diane
du cabinet d’Herculanum.
Les femmes affligées, les veuves fe coupoient
les cheveux. Dans la haute antiquité, les en-
fans qui avoient le malheur d’être' prives de
leur père, dépofoient leurs cheveux fur fa tombe.
C’eft ce que firent Orefie 8c Éleétre, comme
nous l’apprend Euripide, & comme on le voit
par leurs ftatues à la Villa-Ludovifi.
On voit des femmes & même des Déeiïes
coëffées d’un réfeau qui enveloppe leurs cheveux.
L’ ufage des boucles d’oreilles étoit commun,
& les artiftes antiques ont môme prêté
cet ornement à des divinités. Il ne re fte , il
eft v ra i, que deux figures antiques qui aient
des boucles d’oreilles; mais on en voit un
grand nombre qui ont les oreilles percées: les
boucles le font perdues, parce qu’elles étoient
d’o r , " ^ peut-être même enrichies de pierreries.
Les filles de Niobé, la Vénus de Médi*.
c is , pour ne pas parler de ftatues moins célèbres,
ont les oreilles percées. Buonarrotti s’eft
trompé quand il a fourenu qu’on ne trou voit
des oreilles percées qu’à des têtes rèpréfentanc
des Déeffes : on en voit à des têtes qui font
des portraits, & à des cariatides qui apparam-
ment ne repréfentent pas des divinités. On fait
quechez les Romains les femmes & les jeunes
hommes portoient des boucles d’oreilles qui
étoient fouvent d’un, grand prix. Platon , Xé-
nophon ne nous permettent pas de douter qu’il
en étoit de même "dan s la Grèce : & quand les
écrivains auroient gardé Je filence fur cet obje
t , on voit Achille avec des boucles d’oreilles,
fur un vafeantique de terre cuite de la bibliothèque
du- Vatican.
Winckelmann parle aufii d’un ornement que
les femmes portoient au defius du front, &
qui refiembîoit beaucoup aux aigrettes des
femmes modernes. On voit cette parure à la
tête de Marciana, nièce de Trajan, dans
jardin du palais Faraefe. Une autre t£te de