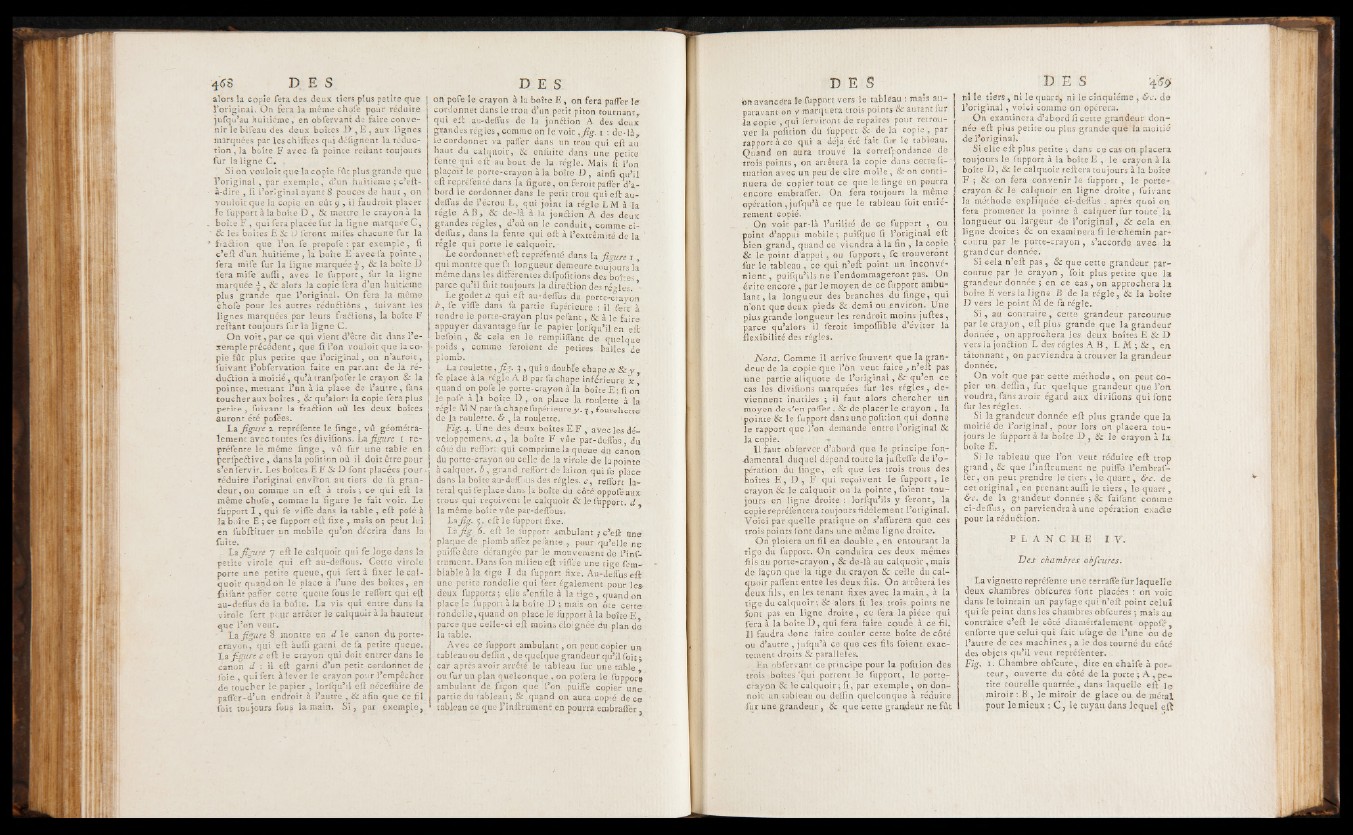
alors la copie fera des deux tiers plus petite que
l ’original. On fera la même chqfe pour réduire
jufqu’au huitième, en obfervant de faire convenir
le bifeau des deux boîtes D , E , aux lignes
marquées par les chiffres qui défignent la réduction
, 1a boîte F avec fa pointe reliant toujours
fur la ligne C . .
Si on vouloit que la copie fût plus grande que
l ’original , par exemple, d’ un huitième ; c’eft-
à-dire , fi l’original ayant 8 pouces de hau t, on
■ vouloit que la copie en eût 9 , il faudroit placer
le fupport à la boîte D , & mettre le crayon à la
boîte F , qui fera placée fur la ligne marquée C ,
& les boîtes E & L) feront miles chacune fur la
fraélion que l’on fe propofe : par exemple, fi
c ’efr d’un huitième , la boîte E avec la pointe ,
fera mile fur la ligne marquée y , & la boîte D
fera mi fe aufli, avec le fupport, fur la ligne
marquée f , & alors la copie fera d’un huitième
plus grande que l’original. On fera la même
chofe pour les autres réductions , luivant les
lignes marquées par leurs fraéliens, la boîte F
reliant toujours fur la ligne C.
On v o it , par ce qui vient d’être dit dans l’exemple
précédent, que fi Fon vouloit que la copie
fût plus petite q-ue l ’original, on n’auroit,
luivant l’obfervation faite en par.ant de la réduction
a moitié, qu’ à tranfpofer le crayon 8c la
pointe, mettant l’ un à la place de l’autre, fans
toucher aux boîtes , 8c qu’alors la copie fera plus
petite , fuivant la fraction orf les deux boîtes
auront été pofees.
La figure 2, repréfente le linge, vû géométra-
lement avec toutes fes divifions. La. figure 1 repréfente
le même lin g e , vû fur une table en
perfpeélive , dans la polit ion où il doit être pour
s’en fervir. Les boîtes E F & D font placées pour.
réduire l’original environ au tiers de fa grandeur
, ou connue un eft à trois , ce q'ui eft la
même chofe , comme la figure le fait voir. Le
fupport I , qui fe vifie dans la table , eft pofé à
la boîte E ; ce fupport eft fixe , mais on peut lui.
en fubftituer un mobile qu’on décrira dans la
fuite.
„ La figure 7 eft le çalquoir qui fe loge dans îa
petite virole qui eft au-deffous. Cette virole
porte une petite queue, qui fert à fixer le cal-
quoir quapdon le place à l’une des boîtes, en
faifant pafier. cette queue fous le reffort qui eft
au-deflus de la boîte. La vis qui entre dans la
virole fert peur arrêter le calquuir à la hauteur
que l’ on veut.
La figure 8 montre en d le canon du porte-
crayon, qui èft àulîi garni de fa petite queue.
La figure c eft le crayon qui doit entrer dans le
canon d : il eft garni d’ un petit cordonnet de
joie , qui fert à lever le crayon pour l’empêcher
de toucher le papier , lorfqu’ il eft neceflaire de
palFer-d’ un endroit à l’autre , & afin que ce fil
foit toujours fous la main. S i , par exemple,
on pofe le crayon à la boîte E , on fera palfer le
cordonnet dans le trou d’ un petit piton tournant,,
qui eft au-delfus de la jonction A des deux
grandes régies, comme on le voit ,fig. 1 : de-là,
le cordonnet va paffer dans un trou qui eft au
haut du çalquoir, 8c enfuite dans une petite
fentequi eft au bout de la régie. Mais li l’on
plaçoit le porte-crayon à la boîte D , ainfi qu’ il
eft repréfenté dans la figure, on feroic palfer Id’abord
le cordonnet dans le petit trou qui eft au-
delfus de l’ écrou L, qui joint la régie LM à la
régie A B , & de-îà à la joadion A des deux
grandes régies, d’où on le conduit, comme ci-
delfus, dans la fente qui eft à l’extrémité de la
réglé qui porte le çalquoir.
Le cordonnet'eft repréfenté dans la figure 1
qui montre que fa longueur demeure toujours la
même dans les différentes difpofttions des boîtes
parce qu’il fuit toujours la dire&ion des régies. 5
Le godet 11 qui eft au-delfus du porte-crayon
b , fe viffe dans fa partie fupérieure : il fert à
rendre le porte-crayon plus pelant, & à le faire
appuyer davantage fur le papier lorfqu’ il en eft
befoin , & cela en le rem pli (Tant de quelaue
s poids , comme feroient de petites balles’ de
plomb.
La roulette, fig. 3 , qui a double chape se 8c y r
fe place à la régie A B par fa chape inferieure x *
quand on pofe le porte-crayon à la boîte E : fi on
le. pofe à la boîte D , on place la roulette à la
régie M N par fa chape fupérieure y . ? , fourchette
de la roulette. & , la roulette.
Fig. 4. Une des deux boîtes E F , avec les dé-
veloppemens. a , la boîte F vûe par-deflus du
côté du reffort qui comprimera quene dti canon
du porte-crayon ou celle de la virole de la pointe
à calquer, b , grand reffort de laiton qui fe place
dans la boîte au-deff )us des régies..*;, reffort latéral
qui feplace dans la Boîte du côté oppofé aux
trous qui reçoivent le çalquoir & le fupport. d
la même boîte vûe par-defïous.
La fig. 5. eft le fupport fixe.
La fig. 6. eft le lupport ambulant ; c’eft «jne
plaque de plomb affez pefance pour qu’elle ne
puiffe être dérangée par le mouvement de l’ inf-
trument. Dans Ion milieu eft viffée une tige fém-
b la bleàla -tige I du fupport fixe. Au-delfus eft
une petite rondelle qui fert également pour les-
deux fupports ; elle s’enfile_ à la tige , quand on
place le fupport à la boîte D ; mais on ôte cette
• rondelle, quand on place fe fupport à la boîte E
parce que celle-ci eft moins éloignée du plan de
la table ..
Avec ce fupport ambulant ,on peut copier un-
tableau ou defïin , de quelque grandeur qu’il foit *
car après avoir arrêté le tableau fur une table
ou fur un plan quelconque , on pofera le fupport»
ambulant de façon que l’ on puiffe copier une
partie du tableau ; & quand on, aura copié de ce
tableau ce que l’inftrument en pourra embraffer
on avancéra le fupport vers lé tabléau : maïs auparavant
on y marquera trois points & autant fur
la copie , qui fer virole de repaires pour retrouver
la pofition du fupport & de la copie , par
rapport à ce qui a déjà été fait fur le tableau.
Quand on aura trouvé la c'orrefpondance de
trois points, on arrêtera la copie dans cette, fi- *
tuation avec un peu de cire molle, & on continuera
de copier tout ce que le finge en pourra
encore embraffer. On fera toujours la même ,
opération , jufqu’à ce que le tableau l’oit entièrement
copié.
On voit par-là l’utilité de ce fupport , ou
point d’appui mobile ■, puifque fi l’original eft
bien grand, quand ce viendra à la fin , la copie
& le point d’appui, ou fupport, fe trouveront
fur le tableau, ce qui n’eft point un inconvénient
, puifqu’ ils ne l’endommageront pas. On
évite encore , par le moyen de ce fupport ambulant,
la longueur des branches du finge, qui
n’ont que deux pieds &. demi ou .environ. Une
plus grande longueur les rendroit moins juftes ,
parce qu’alors il feroic impofïiblé d’éyiter la
flexibilité dès régies.
Nota. Comme il arrivelouvent que la grandeur
de la copie que l’on veut faire , n’eft pas
une partie aliquote de l’original, 8c qu’ en ce
cas les divifions marquées fur les régies, deviennent
inutiles ; il faut alors chercher un
moyen de s’ en paffer , & de placer le crayon , la
pointe & le fupport dans une pofition qui donne
le rapport que l’on demande encre l’original &
la copie. •••• ^ : '
Il faut obferver d’abord que le principe fondamental
duquel dépend toute la jufteffe de l’opération
du finge, eft que les trois trous des
boîtes E , D , F qui reçoivent le fupport, le
crayon & le çalquoir ou la pointe, foient toujours
en ligne droite : lorsqu’ils y feront, la
copierepréfentera toujours fidèlement l’original.
Voici par quelle pratique on s’affurera que ces
trois points font dans une même ligne droite.
On ploiera un fil en double , en entourant la
tige du fupport. On conduira ces deux mêmes
fils au porte-crayon , & de-Ià au çalquoir , mais
de façon que la tige du crayon & celle du cal-
quoir partent entre les deux fils. On arrêtera les
deux fils, en les tenant fixes avec la main, à la
tige du çalquoir; & 'alors fi les trois points ne
font pas en ligne droite , ce fera la pièce qui
fera à ia boîte D , qui fera faire coude à ce fil.
Il faudra donc faire couler cette boîte de côté
ou d’autre , jufqu’ à ce que ces fils foient exactement
droits & parallèles.
. En oblervant ce principe pour la pofition des
trois boîtes‘qui portent le fupport, le porte-
crayon 8c le çalquoir ; fi, par exemple, on don-
noic un tableau ou defïin quelconque à réduire
fur une grandeur, & que cette grandeur ne fût
ni le tiérs , ni le quart«, ni le cinquième , ù c . de
l ’or ig in al, voici comme on opérera.
On examinera d’abord fi cette grandeur donnée
eft plus petite ou plus grande qué la moitié
de i’ original*
Si elle eft plus petite ; dans ce cas on placera
toujours le fupport à la boîte E , le crayon à la
boîte D , & le çalquoir reliera toujours à la boîte
F ; & on fera convenir le fupport , le porte-
crayon & le çalquoir en ligne droite, fuivant
la méthode expliquée ci-défi us . après quoi on
fera promener la pointe à calquer fur toute'la
longueur ou largeur de l’original, & cela en.
ligne droite j & on examinera fi le ’chemin parcouru
par le porte-crayon, s’accorde avec la
grandeur donnée.
Si cela n’eft pas , & que cette grandeur parcourue
par le crayon , foit plus petite que la
grandeur donnée ; en ce cas , on approchera la
boire E vers la ligne B de la régie , & la boîte
D vers lé .point M de fa régie.
S i , au contraire , cette grandeur parcourue
par le crayon , eft plus grand© que la grandeur
donnée , on approchera les deux boîtes E & D
vers la jonction L des régies A B , L M ; & , en
tâtonnant, on parviendra à trouver la grandeur
donnée.
On voit que par cette méthode, on peut copier
un defïin, fur quelque grandeur que l’on
voudra, fans avoir égard aux divifions qui font
fur les régies. -
Si la grandeur donnée eft plus grande que la
moitié de l ’original, pour lors on placera toujours
le fupport à la boîte D , 8c le crayon à la
boîte E.
Si le tableau que l’on veut réduire eft trop
grand, & que l’ inftrument ne puiffe l’ embraffer,
on peut prendre le tiers , le quart, &c. de
cet original, en prenant aufïi le tiers, le quart,
&c. de la grandeur donnée ; & faifant comme
ci-deffus, on parviendra à une opération exacte
pour la rédu&ion.
P L A N C H E I V .
Des chambres obfcures.
La vignette repréfente une terrafiefur laquelle
deux chambres obfcures font placées : on voie
dans le lointain un" payfage qui n’eft point celui
qui fe peint dans les chambres obfcures -, mais au
contraire c’eft le côté diamétralement oppofé,
enforte que celui qui fait uiage de l’une ou de
l ’autre de ces machines , a le dos tourné du côté
des objets qu’il veut repréfenter.
Fig. 1. Chambre obfcure, dite en chaife à porteur
, ouverte du côté de la porte ; A , petite
tourelle quarrée , dans laquelle eft
miroir : B , le miroir de glace ou de métal
pour le mieux ; C , le tuyau dans lequel eft