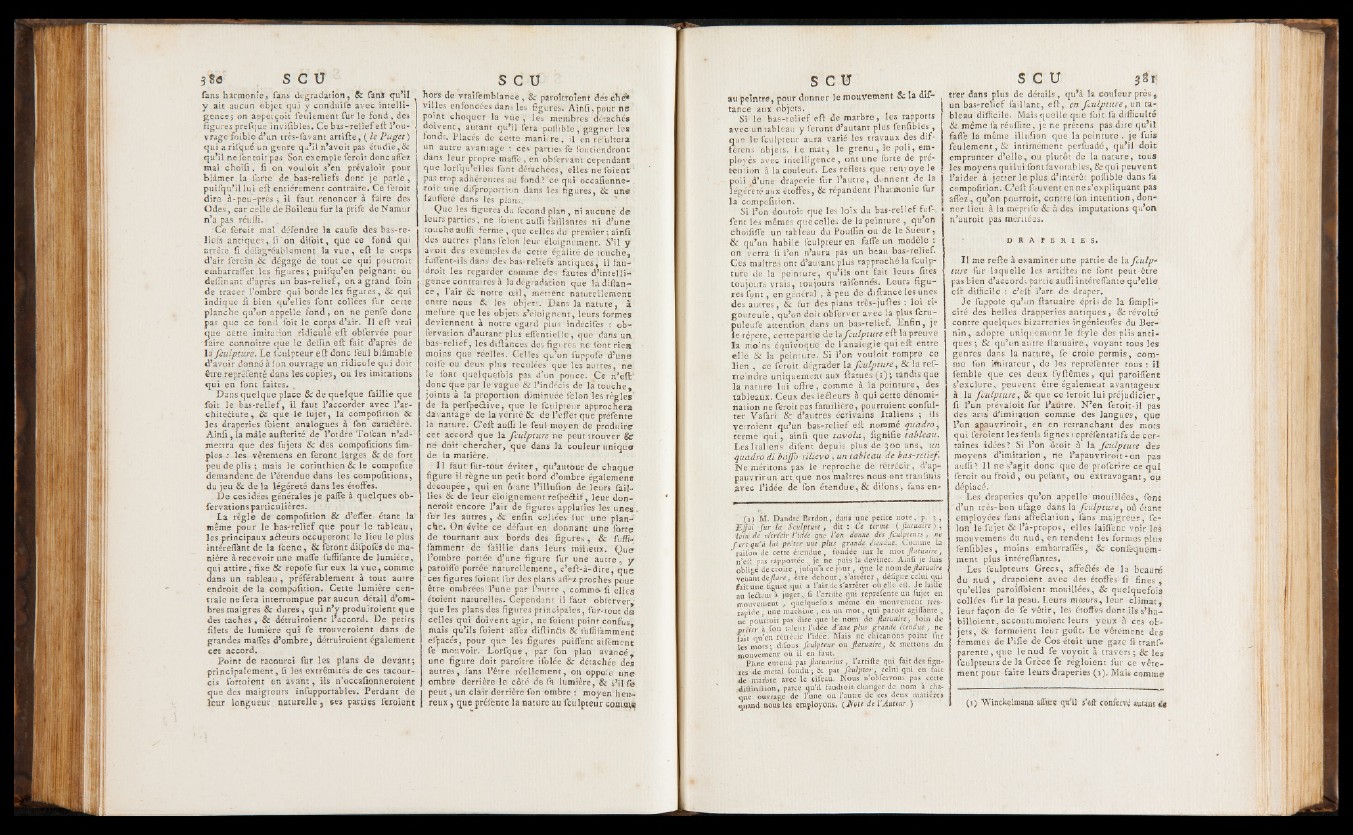
fans harmonie, fans dégradation, & fans qu’ il
y ait aucun objet qui y conduire avec intelligence
5 on apperçoit feulement fur le fond, des
figures prefque invifibles. Ce bas-relief eft l’ouvrage
foibled’un très-lavant artifte, ( le Puget)
qui arilqué un genre qu’ il n’avoit pas étudié,&
qu’il ne fentoit pas Son exemple feroit doncaffez
mal choifi, fi on vouloit s’ en prévaloir pour
blâmer la forte de bas-reliefs dont je parle ,
puifqu’ il lui eft entièrement contraire. Ce feroit
dire à-peu-près; il faut renoncer à faire des
Odes, car celle de Boileau fur la prife de Namur
n’a pas réulli. ’
Ce feroit mal défendre la caufe des bas-reliefs
antiques, fi on difoit, que ce fond qui
arrête fi défagréablement la v u e , eft le corps
d’air ferein & dégagé de tout-ce qui pourroit
embarralfer les figures; puifqu’en peignant ou
delfinant d’après.un bas-relief, on a grand foin
de tracer l’ombre qui borde les figures, & qui
indique fi bien qu’elles font collées fur cette
planche qu’on appelle fond ; on ne penfe donc
pas que ce fond foit le. corps d’air. I l eft vrai
que cette imitation ridicule eft obfervée pour
faire connoître que le defTin eft fait d’après de
la fculpture. Le fculpteur eft donc feul blâmable
d’avoir donné à Ion ouvrage un ridicule qui doit
être repréfenté dans les.copies, ou les imitations
qui en font faites.
Dans quelque place & de quelque faillie que
foit le. bas-relief, il faut l’accorder avec l’ar-
cjiiteélure, & que le fujet, la compofirion &
les draperies foient analogues à fon caradèrë.
A in fi, la mâle aufterité de l’otdré Tofcan n’ad-
niettra que des fujets & des compofitions {impies
: les vêtemens en feront , larges & de fort
peu de plis ; mais le corinthien & le compofite
demandent de l ’étendue dans les compofitions,
du jeu & de la légèreté dans les étoffes.
De ces idées générales je pàffe à quelques ob-
fervations particulières.
La règle de compofitîon & d’ effet étant la"
même pour le bas-relief que pour le tableau ,
les principaux a&eurs occuperont;le lieu le plus
intéreffant de la lc en e , & feront difpofés de manière
à recevoir une maffe fuffifante de lumière,
qui attire, fixe & repofe fur eux la vu e , comme
dans un tableau, préférablement à tout autre
endroit de la compofitîon. Cette lumière centrale
ne fera interrompue par aucun détail d’ombres
maigres & dures , qui n’y produirpient que
des taches, & détruiroient l’ accord. De petits
filets de lumière qui fe trouveroient dans de
grandes maffes d’ombre, détruiroient également
cet accord.
Point de racourci fur les plans de devant;
principalement, fi les extrémités de cès tacour-
cis fortoient en avant, ils ri’occafiqnneroient
que des maigreurs infupportable*. Perdant de
leur longueur naturelle, ces parties feroient
hors de vraifemblance, 8c paroîtroïent des ehëV
villes enfoncées dans les figurés. Ainfi, pour ne
point choquer la vue ,; les membres détachés
doivent, autant qu’ il fera pollible, gagner les
fonds. Places de cette manicre, il en réfultera
un autre avantage : ces parties fe Contiendront
dans leur propre maffe , en obfervant cependant
que lorfqù’eiles font détachées, elles ne foient '
pas trop adhérentes au fond.? ce qui occafionne-
roic une difproportion dans les figures, & une
fauffeté dans les plans.1,
Que les figures du fécond plan , ni aucune de
leurs parties, ne foient suffi. Caillantes ni d’une
touche' suffi ferme , que celles du premier ; ainfi
des autres plans félon leur éloignement. S’ il y
avoir des exemples de cette égalité de touche,
fiiffent-iîs dans' des bas-reliefs antiques, il fau—
•droit les regarder comme des fautes d’intelli-
..gence contraires à la dégradation que la difian—
c e , l’air Sc notre oeil, mettent naturellement
entre nous & les objets. Dans la nature, à
mefure que les objets s’éloignent, leurs formes
deviennent à notre égard plus indécifes ; ob-,
fervation d’autanrplus effentielle, que dans un
bas-relief, les diftances des figures ne font rien
moins que réelles. Celles qu’on luppofe d’une
toile ou deux plus reculées que les autres, ne
le font quelquefois pas d’un pouce. Ce n’effc'
donc que par le vague & l’ indécis de la touthe,
joints à la proportion diminuée félon les règles'
de la perfpeftive, que le fculpteur approchera
dav antage de la vérité & de l’effet que préfente
la nature. C’eft auffi le feul moyen de produire
cet accord que la fculpture ne peut trouver Sc
ne doit1 chercher, que dans la couleur unique
de la matière.
I l faut fur-tout éviter, qu’autour de chaque
figure il règne un petit bord d’ombre également
1 découpée, qui en ôtant l ’ illufion de leurs faillies
& de leur éloignement refpe&if, leur donneront
encore l’air de figuresâpplaties les unes-,
fur les autres , & enfin collées fur une plan-’
che. On évite ce défaut en donnant une forte
de tournant aux bords des figures , & fuffiu
famment de faillie dans leurs milieux. Que
l ’ombre portée d’une figure fur unè autre, y
paroiffe portée naturellement, c’eft-à-dire, que
ces figures foient fur des plans afl>z proches pour
être ombrées l’une par l’autre , comme, fi elles
étoient naturelles. Cependant il faut obferver1
que les plans des figures principales, fur-tout de
celles qui doivent agir, ne foient point confus
mais qu’ils foient affez diftinds & l'uffifammenc
efpacés, pour que les figures puiffenr aifément
fe mouvoir.- Lorfque, par fon plan avancé -
une figure doit paroatre ifolée & détachée des
autres, fans l’être réellement, on oppofe une
ombre derrière le côté de fa lumière, & s’ il fe
peut, un clair derrière fon ombre : moyen:heu-;
reu x , que préfente la nature au fculpteur cornait
au peintre, pour donner le mouvement Sc la dif-
tance aux objets.
Si le bas-relief eft de marbre, les rapports
avec un tableau y feront d’autant plus fenfibles ,
que le fculpteur aura varié les travaux des dif-
férens objets. Le mat, le grenu, le poli, employés
avec intelligence, ont une forte de prétention
à la couleur. Les reflets que renvoyé le
poli d’une draperie fur l’autre, donnent de la
légèreté aux étoffes, & répandent l’harmonie fur
la compofition.
Si l’on doutoit que les loix du bas-relief fuf-
fent les mêmes que celles de la peinture , qu’on
choififfe un tableau du Pouflin ou dë le Sueur ,
& qu’ un habile fculpteur en faffe un modèle : j
on verra fi l’on n’aura pas un beau bas-relief.
Ces maîtres ont d’-autant plus rapproche la fculpture
de la peinture', qu’ ils ont fait leurs- fites
toujours vrais, toujours raifonnés. Leurs figures
fon t, en général , à peu de diftance les unes
des autres, Sc fur des plans très-juftes : loi ri-
goureufe, qu’on doit obferver avec la plus fcru-
puleufe attention dans un bas-relief. Enfin, je
le répète, cette partie de la fculpture eft la preuve
la moins équivoque de 1 analogie qui eft entre
elle oé la peinture. Si l’on vouloit rompre ce
lien , ce feroit dégrader la fculpture, & la ref-
treindre uniquement aux ftatues (x) ; tandis que
la nature lui offre, comme à la peinture, des
tableaux. Ceux des leéieurs à qui cette dénomination
ne feroit pas familière, pourroient conful-
ter Vafari & d’autres écrivains Italiens ; ils
verroient qu’ un bas-relief eft nommé quàdro,
ternie q u i, ainfi que tavola, fignifie tableau*
Les Italiens difent depuis plus de 300 ans, un
quadro di bajfo-rilievo , untableau de bas-relief.
Ne.méritons pas le reproche de rétrécir, d’appauvrir
un art que nos maîtres nous ont tranlmis
^vec l’idée de fon étendue, & difons, ians en-
(1) M. Dandré Bsrdon, dans une petite n o te , p. 3 ,
EJJai fu r la Sculpture, d i t : Ce terme ( jîatuaire ) ,
loin de rétrécir Vidée que Von donne des fculpteurs, ne
f e r t qu'à lui prêter une plus grande étendue. Comme la
raifon de cette étendue , fondée fur le mot Jîatuaire,
n’eft pas rapportée, je ne puis la deviner. Ainfi je fuis
obligé de croire , julqu’â ce jo u r , que le nom de Jîatuaire
venant dejlare, erre debout, s’arrêter , défigne celui qui
fa it une figure qui a l’air de s'arrêter ou elle eft. Je laiflè
au leftcur à juger, fi l’artifte qui repréfente un fujet en
mouvement , quelquefois même en mouvement très-
lap id e , une machine , en un m o t, qui paroit agiifante ,
ne pourroit pas dire que le nom de Jîatuaire, loin de
■ prêter a.fon talent l’idée d'une plus grande étendue , ne
fait qu’en rétrécir l’ idée. Mais ne chicanons point fur
les mots- difons. fculpteur ou Jîatuaire, ôc mettons du
mouvement ou il en faut.
Pline entend par Jlatuarius , l’artifte qui fait des figur
e s de métal fondu ; ôc par fculptor, celui qui en fait
de marbre avec le cifeau. Nous n’obfervons pas cette
diftin&ion, parce qu’il faudroit changer de nom à chaque
ouvrage de l’une ou l’autre de ces deux matières
quand nous les employons, {Note de l'Auteur.)
tfer dans plus de détails, qu’ à la couleur près,
un bas-relief faillant, e ft, en fculpture, un tableau
difficile. Mais quelle que foit fa difficulté
Sc même fa réullite, je ne prétens pas dire qu’ il
fafle la même illufion que la peinture . je fuis
feulement, & intimement perfuadé, qu’ il doit
emprunter d’ e lle , ou plutôt de la nature, tous
les moyens qui lui font favorables, & q u i peuvent
l’aider à jetter le plus d’ intérêt poffible dans fa
compofition. C’eft fouvent en ne s’expliquant pas
affez , qu’on pourroit, contre fon intention, donner
lieu à la méprife & à des imputations qu’on
n’auroit pas méritées.
DR A P E R I E S .
Il me refte à examiner une partie de la fculp-
ture fur laquelle les artiftes ne font peut-être
pas bien d’accord; partie auffi intéreffante qu’elle
eft difficile : c’eft l’art de draper.
Je fuppole qu’ un ftatuairë épris de la {implicite
des belles drapperies antiques, Sc révolté
contre quelques bizarreries ingénieufes du Ber-»
nin, adopte uniquement le ftyle des plis antiques
; & qu’ un autre ftatuairë, voyant tous les
genres dans la nature, fe croie permis, comme
fon ifiiirateur, de les repréfenter tous: i l
i femble que ces deux fyftêmes, qui paroiffene
s’ exclure, peuvent être également avantageux
à la fculpture, Sc que ce feroit lui préjudicier,
fi l’ un prévaloir fur l’aütre. N’en feroit-il pas
des arts d’imitation comme des langues, que
l ’on agauvriroit, en en retranchant des mots
qui feroient les feul s fignes 1 epréfentatifs de certaines
idées? Si l’on ôcoit à la fculpture des
moyens d’ imitation, lie l’apauvriroit-on pas
Iaum ? Il ne s’agit donc que de proferire ce qui
feroit ou froid, ou pefant, ou extravagant, ou
déplacé.
Les. draperies qu’on appelle mouillées, font
d’ un très-bon ufage dans la fculpture, où étans
employées- fans affeélation , fans maigréur-, félon
le fujet & l’à-propos, elles laiffent voir les
mouvemens du nud, en rendent les formes plus
fenfibles, moins embarraffés, & conféquem-
ment plus intéreffantes.
Les fculpteurs Grecs, affeélés de la beauté
du nud , drapoient avec des étoffes fi fines ,
qu’elles paroiffoient mouillées, & quelquefois
collées fur la peau. Leurs moeurs, leur climat-
leur façon de fe vêtir, les étoffes dont ils s’ ha-*
billoient, accoutumoient leurs yeux à ces objets,
& formoient leur goût. Le vêtement des
femmes de l ’ ifle de Cos étoit une gaze fi tranf-
parente, que le nud fe voyoit à travers ; & les
fculpteurs de la Grèce fe régloient lur ce vêtement
pour faire leurs draperies (1). Mais comme
(1) Winckelmanii afiurc qu’il s’ôft confervé autant de