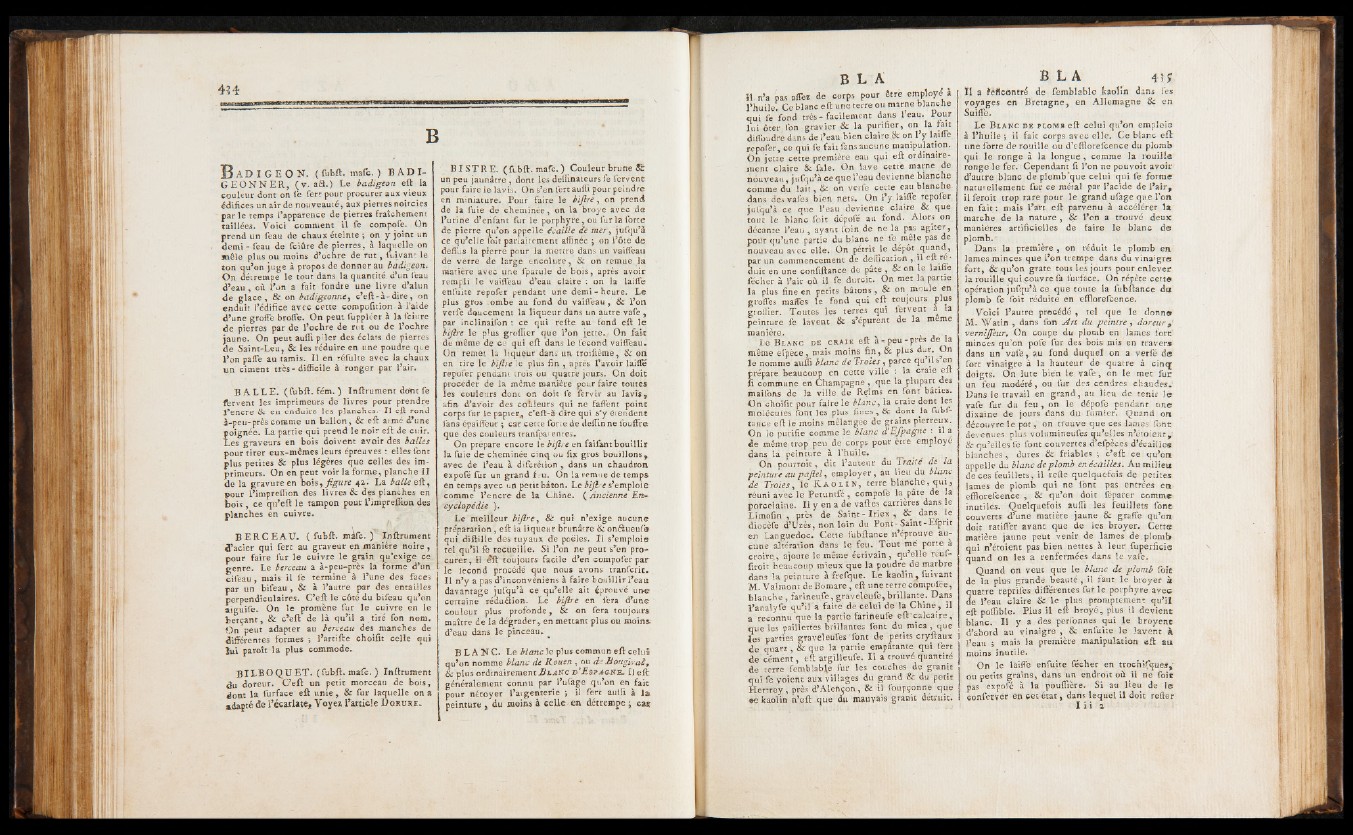
B a d i g e o n , (fubft. mate.) b a d i g
e o n n e r , ( v . a a .) Le badigeon, eft la
couleur dont on le ferr pour procurer aux vieux
édifices un air de nouveauté, aux pierres noircies
par le temps l’apparence de pierres fraîchement
taillées. Voici comment il fe compofe. On
prend un feau de chaux éteinte ; on y joint un
demi-feau de fciûre de pierres, à laquelle on
mêle plus ou moins d’ochre de ru t , fuivant le
ton qu’on juge à propos de donner au badigeon.
On détrempe le tout dans la quantité, d’un (eau
d’eau, où l’on a fait fondre une livre d’alun
de g la c e , & on badigeonne, c’ eft - à •= dire, on
enduit l’édifice avec cette compofition à l’aidé
d’une groffe broffe. On peut luppléer à la fciure
de pierres par de l’ochre de rut ou de l’ochre
jaune. On peut aufli piler des éclats de pierres
de Saint-Leu, & les réduire en une poudre que
l ’on paffe au tamis. Il en réfulte avec la chaux
un ciment très-difficile à ronger par l’air.
B A L L E , ( fu b ft.fém .) Inftrument dotat fe
fervent les imprimeurs de livres pour prendre
l ’encre & en enduire les planches.' Il eft rond
à-peu-près comme un ballon, & éft armé d’ une
poignée. La partie qui prend le noir eft de cuir.
Les graveurs en bois doivent avoir des balles
pour tirer eux-mêmes leurs épreuves r elles font
plus petites & plus légères que celles des imprimeurs.
On en peut voir la forme, planche II
de la gravure en bois, figure 42. La balle e ft,
jpour l’impreflion des livres & des planches en
bois , ce qu’eft le tampon pour l’imprefîLon des
planches en cuivre.
B E R C E A U . ( fubft. male, p Inftrument
d’acier qui ferc au graveur en manière noire,
pour faire fur le cuivre le grain qu’exige ce.
genre. Le berceau a à-peu-près là forme d’un
cifeau, mais il lé termine à l’une des faces
par un bifeau , & à l’autre par des entailles
perpendiculaires. C’ eft le côté du bifeau qu’on
aiguife. On le promène fur le cuivre en le
berçant, & c’eft de là qu’ il a tiré fon nom.
On peut adapter au berceau des manches de
différentes formes ; l’artifte choifit celle qui
lu i paroît la plus commode.
B I L B O Q U E T . (fubft. mafe. ) Inftrument
du doreur. C’eft un petit morceau de bois,
dont la furface eft u n ie , & fur laquelle on a
adapté d e l’écarlate* Voyez Tarncle D o r u r e .
B I S T R E . (fLbft.mafc.) Couleur brune St
un peu jaunâtre , dont les dellinateurs fe fervent
pour faire le lavis. On s’en lért aufli pour peindre
en miniature. Pour faire le bijlre, on prend
de la fuie de cheminée, on la broyé avec de
l’urine d’ enfant fur le porphyre, ou fur la forte
de pierre qu’on appelle écaille de mer, jufqu’à
ce qu’ elie toit parlaitement affinée ; on l’ôte de
deffus la pierre pour la mettre dans uni vaiffeau
de verre de large encolure, & on remue la
matière avec une Ipatule de bois, après avoir
rempli le vaiffeau d’eau claire : on la laiffe
enfuite repofer pendant une demi - heure. Le
plus gros .ombe au fond du vaiffeau, & l’on
verfe doucement la liqueur dans un autre vafe ,
par inclination : ce qui refte au fond eft le
bijlre le plus grolfier que l’on jette./ On fait
de même de ce qui eft dans le fécond vaiffeau.
On remet la liquçur dans un troifième, 8c on
en tire le bijlre le plus fin , après l’ avoir laiffé
repofer pendant trois ou quatre jours. On doit
procéder de la même manière pour faire toutes
les couleurs dont on doit fe lérvir au lavis,
afin d’avoir des couleurs qui ne faffent point
corps fur le papier., c’eft-à dîre qui s’y étendent
fans épaiffeur ; car cette forte de deflin ne fouffret
que des couleurs tranfparentes.
On prépare encore le bijlre en faifant bouillir
la fuie de cheminée cinq ou fix gros bouillons,
avec de l’eau à diferétion , dans un chaudron
expofé fur un grand f-u. On la remue de temps
en temps avec un petit bâton. Le bijlre s’emploie
comme l’encre de la Chine. ( Ancienne Et*-
cyclopédie ).
Le meilleur bijlre, & qui n’exige aucune
préparation, eft la liqueur brunâtre & on&ueufo
qui diftille des tuyaux de poêles. Il s’emploie
tel qu’ il fe recueille. Si l’on ne peut s’ en procurer
, il £ft itou jours facile d’en compofer par
‘ le lècond procédé que nous avons tranferit. .
Il n’y a pas d’ inconvéniens à faire bouillir l’eauc
davantage jufqu’ à ce qu’elle ait éprouvé une
certaine rédu&ion. Le bijlre en fera drune
couleur plus profonde, 8c en fera toujours
maître de la dégrader, en mettant plus ou moins-
d’ eau dans le pinceau. ^
B L A N C . Le blanc le plus commun eft celui
qu’on nomme blanc de Rouen, ou de üougival,
' 8c plus ordinairement Ælanc d ’E&pag.ne. Il eft
généralement connu par l’ufage qu’on en fait
pour nétoyer l’argenterie y il fert aulfi à la
peinture * du moins à celle en détrempe y cast
èttpr
B L A
il n’ a pas affez de corps pour être employé à
l ’huile. Ce blanc eft une terre ou marne blanche
qui fe fond très - facilement dans l’eau. Pour
lui ôter. Ion gravier & la purifier, on la rait
diffoudre dans de l’ eau bien c la i r e t on 1 y lame
repofer, ce qui fe fait fans aucune manipulation.
On jette cette première eau qui eft ordinairement
claire & fale. On lave cette marne de
nouveau, jufqu’ à ce que l’ eau devienne blanche
comme du la it , & on verfe cette eau blanche
dans des vafes bien nets. On l’ y laiffe repofer
jufqu’ à ce que l’eau devienne claire & que
tout le blanc foit dépofé au fond. Alors on
décante l’eau , ayant foin de ne la pas agiter,
poiir qu’une partie du blanc ne fe mêle pas de
nouveau avec elle. On pétrit le dépôt quand,
par un commencement de déification , il eft réduit
en une confiftance de pâte , & on le, laifle
fécher à l’air où il fe durcit. On met la partie
la plus fine en petits bâtons, & on moule en
groffes maffes le fond qui eft toujours plus
greffier. Toutes les terres qui fervent a là
peinture fe lavent & s’épurent de la même
manière. ,
Le B l a n c d e c r a ie eft a--peu-près de la
même efpèce, mais moins fin, & plus dur. On
le nomme aufli blanc de Troies, parce qu’ il s’ en
prépare beaucoup en cette v ille : la craie elt
fi commune en Champagne , que la plupart des
maifons de la ville de Reims en font bâties.
On choifit pour faire le blanc, la craie dont les
molécules font les plus fines, & dont la fubftance
eft le moins mélangée de grains pierreux.
On le purifie comme le blanc d’Efpagne : il a
de même trop peu de corps pour être employé
dans là peinture à l’huile.
Oh pourroit, dit l’auteur du Traité de la
peinture au pajlel, employer , au lieu du blanc
de Troies, le K a o l i n , terre blanchè, q u i,
réuni avec le Petuntfé, compofe la pâte de la
porcelaine. I l y en a de vaftes carrières dans le
Limofin , près de Saint - Iriex , & dans le
diocèfe d’Uzès, non loin du Pont-Saint-Efprit
en Languedoc. Cette fubftance n’éprouve aucune
altération dans le feu. Tout me porte a
croire., ajoute le même écrivain, qu’ elle réuf-
firoit beaucoup mieux que la poudre de marbre
dans la peinture à frefque. Le kaolin^ fuivant
M. Val mont de Bomare, eft une terre compolëe,
blanche , farineufe, gravejèufe, brillante. Dans
l ’ analyfe qu’ il a faite de celui de la Chine, il
a reconnu que la partie farineufe eft'calca ire,
que les paillettes brillantes font du mica, que
les parties graveleuses font de petits cryftaux
de quàrz, & que la partie empâtante^ qui lert
de cément, eft argilleufe. Il a trouvé quantité
de terre femblabje fur les couches de granit
qui fe voient aux villages du grand & du petit
Hertrey, près d’Alehçon, & il foupçonne que
ee kaolin n’eft que du mauvais granit détruit.
B L A 4!?
I l a féfleontré de femblable kaolin dans Tes
voyages en Bretagne, en Allemagne 8c en
Suiffe.
Le Blanc de plomb eft celui qu’on emplois
à l ’huile il fait corps avec elle. Ce blanc eft
une forte de rouille ou d’efflorefcence du plomb
qui le ronge à la longue, comme la rouille
ronge le fer. Cependant fi l ’on ne pouvoit avoir
d’autre blanc de plomb‘que celui qui fe forme
naturellement fur ce métal par l’acide de l’a ir ,
il feroit trop rare pour le grand ufage que l’on
en fait : mais l’art eft parvenu à accélérer la
marche de la nature , 8c l ’on a trouvé deux
manières artificielles de faire le blanc de
plomb.'
Dans la première, on réduit le plomb en
lames minces que l’on trempe dans du vinaigre
fort, 8c qu’on grate tous les jours pour enlever
la rouille qui couvre fa furface. On répète cette
opération jufqu’à ce que toute la fubftance du
plomb fe foit réduite en efflorefcence.
Voici l’autre précédé , tel que le donne
M. Watin , dans fon A r t du peintre , doreur 9’
vernijjeur, On coupe du plomb en lames fort
minces qu’on pofe fur des bois mis en travers
dans un v afe , au fond duquel on a verfé de
fort vinaigre à la hauteur de quatre à cincj
doigts. On lute bien le v afe , on le met fur
un feu modéré, ou fur des cendres chaudes.'
Dans le travail en grand, au lieu de tenir le
vafe fur du feu , on le dépofe pendant une
dixaine de jours dans du fumier. Quand on
découvre le pot, on trouve que ces lames font
devenues plus volumineufes qu’elles n’étoient,-
& qu’elles le font couvertes d efpèces d’écailles
blanches , dures & friables -, c’ eft ce qu’on
appelle du blanc de plomb enécailles. Au milieu
de ces feuillets, il refte quelquefois de petites
lames de plomb qui ne lont pas entrées en
efflorelcence , & qu’on doit féparer comme
inutiles. Quelquefois aufli les feuillets font
couverts d’ une matière jaune & grafle qu’on
doit ratifier avant que de les broyer. Cette
matière jaune peut venir de lames de plomb
qui n’étoient pas bien nettes à leur fuperficie
quand on les a renfermées dans le vafe.
Quand on veut que le blanc de plomb Coït
de la plus grande beauté, il faut le broyer à
quatre reprifes différentes fuir le porphyre avec
de l’ eau claire & le plus promptement qu’ il
eft poflible. Plus il eft broyé, plus il devient
blanc. I l y a des perfonnes qui le broyenc
j d’abord au vinaigre ,j & enfuite le lavent à
l’eau 5 mais la première manipulation eft au
moins inutile.
On le laiffe enfuite fécher en trocnifques,'
oü petits grains, dans un endroit où il ne foit
pas expofé à la poufiière. Si au lieu de le
confetver en çet état, dans lequel il doit refter
I i i 2