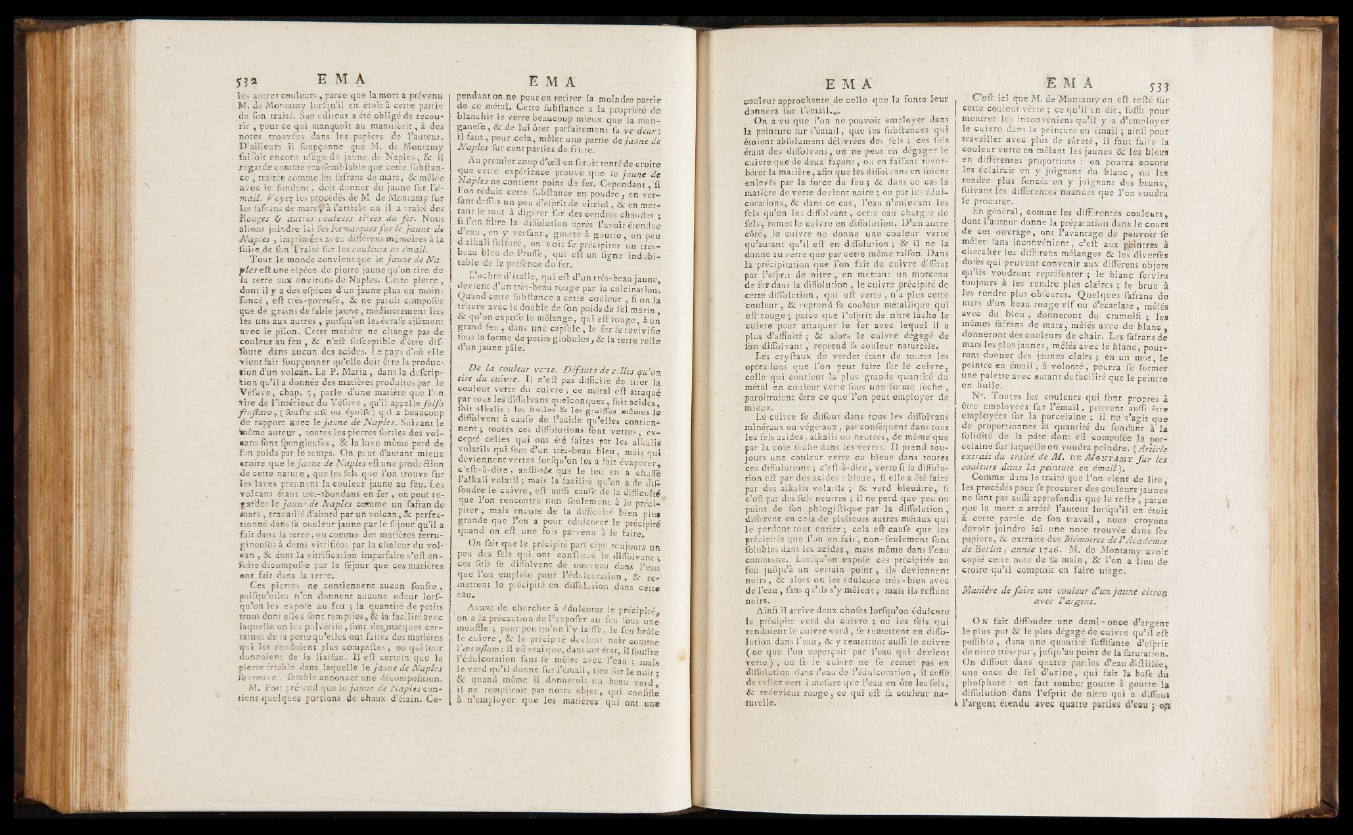
Il
les autres couleurs , parce que la more a prévenu
M. de Mon ta m y lorlqu’il en’ étoît à cette partie
de fon traité. San éditeur a été,obligé de recourir
, pour ce qui tnanqiioit au manui'crit, à des
notes trouvées dans les papiers de l'auteur.
D’ailleurs il foupçonne que M. de .IVlontamy
faifoit encore ufage du jaune de Naples, & il
regarde comme vraifemblable que cette Tubftan-
ce , traitée comme les fafrans de mars, & mêlée
avec le fondant, doit donner du jaune fur IV-
ina.il. Voye\ les procédés de M de Montamy fur
les fafrans de marsf1-à l’article où il a traité des
Rouges & autres couleurs tre'es du fer. Nous
allons joindre ici les Remarques fu r le jaune de
Naples y imprimées avec differens mémoires à fa
lùite.de fon Traité fur les couleurs en émail.
Tout le monde convient que le jaune de Na
pies eft une el’péce de pierre jaune qu’on tire de
la terre aux environs de Naples. Cette pierre ,
dont il y a des elpéces d’un jaune plus ou moins
foncé , eft très-poreufe, 8c ne paroît compofée
que de grains de fable jaune, médiocrement liés
les uns aux autres , puifqu’on lesécrafe ailëment
avec le pilon. Cette matière ne change pas de
couleur au feu , & n’eft fufc.eptible d’être dif-
ïoute dans aucun des acides. Le pays d’où elle
Tient fait foupçonner qu’elle doit être la production
d’un volcan. Le P. Maria , dans Ja deferip-
fcion qu’il a donnée des matières produites par le
Véfu ve, chao. 5, parle d’une matière que l’on
tire de l ’intérieur du Véfuve , qu’il appelle folfo
frujlato, ( foufre ufé ou épuife) qui a beaucoup
de rapport avec 1 e jaune de Naples, Suivant le
^»nême auteur , toutes les pierres forties des volcans
font fpongieufes, & la lave même perd de
fon poids par le temps. On peut d’autant mieux
croire que lé jaune de Naples eft une production
de cette nature , que les.lèls que l’on trouve fur
les laves prennent la couleur jaune au feu. Les
volcans étant très-abondans en fe r , on peut regarder
le jaune de Naples comme un fafran de
mars , travaillé d’abord par un volcan, Sc perfectionné
dans là couleur jaune par le féjour qu’il a
fait dans la terne ; ou comme des matières ferru-
gineufes à demi vitrifiées par la chaleur du volcan
, & dont la vitrification imparfaite s’eft en-
fuite décompofée par le féjour que ces matières
®nt fait dans la terre.
Ces pierres ne contiennent aucun foufre ,
puifqu’ eiles n’ en donnent aucune odeur lorf-
qu’on les expofe au feu ;• la quantité de petits
trous dont elles font remplies, & la facilité avec
laquelle on les pulvérife, font des^marques certaines
de la perte qu’elles ont faites des matières
qui les rendaient plus compaéles, ou qui leur
oonnoient de la liaifon. I l eft certain que la
pierre friable dans laquelle \e jaune de Naples
le trouve , femblê annoncer une décomposition.
M. Pott prétend que le jaune de Naples contient
quelques portions de chaux d’étain. Cependant
on ne peut en retirer la moindre partie
de ce métal. Cette fubftance a la propriété de
blanchir le verre beaucoup mieux que la man-
ganefe , & de lui ôter parfaitement fa verdeur :
il faut ,'pour cela,mêler une partie de jaune de
Naples fur cent parties de fritte.
Au premier coup d’oeil on feroit tenté de croire
que cette expérience prouvé que le jaune de
Naples ne contient point de fer. Cependant, fi
Ion réduit cette fubftance en poudre, en ver-»
fant deffus un peu d’ efprit de vitriol, & en met-
tant le tout à digérer fur des cendres chaudes ;
h l on filtre la diffolution après l’avoir étendue
“ “ V“ K vr rlant> Soutte à goutte,,un peu
0 alitait iulruré, on voit le précipiter un très-
beau bleu de Prude, qui eft un figne indubi-
table de la prélençe du fer.
E’ochre d’ Italie, qui eft d’ un très-beau jaune
devient d’ un très-beau rouge par la calcination!
Quand cette fubftance a cette couleur , fi on Ja
triture avec le double de fon poids de fiel marin
& qu’on expofe le mélange, qui eftbouge, à tin
grand feu , dans une capliile , le fer le revivifie
fous la forme de petits globules, & la terre relie
d’ un jaune pâlefi
De la couleur verte. Défauts de celles qu’on
tire du cuivre. II n’eft pas difficile de tirer la
couleur verte du cuivre ;.ce métal eft attaqué
par tous les diffolvans quelconques, ioit acides
foit alhalis ; les huiles & les grailles mêmes le
diffolvent à caufe de l’acide qu’elles conticn-
tient ; toutes ces diflolutions font vertes ex—
cepté celles qui ont été faites par les alhalis
volatils qui Pont d’ un tici-beau bleu, mais, qui
deviennent vertes lorfqu’on les a fait évaporai-,
c'eft-à-dire , aufli-tôt que le feu en a chaffé
l’altali volatil ^ mais la facilité qu’on a de diP
foudre le cuivre, eft aufii caufe de la difficulté
que l’on rencontre non-feulement à le préci-'
piter , mais encore de la difficulté bien plu.
grande que l’ on a pour édulcorer le précipité
quand on eft. une fois parvenu à le faire /
On fait que le précipité part'cipe toujours un
peu des fels qui ont confticué le diffolvant v
ces fels fe diffolvent de nouveau dans l’eau
que l’on emploie.pour l’édulcoration, & remettent
le précipité en diffolution .dans cette
eau.
Avant de chercher à édulcorer le précipité,
on a la précaution de l’ expofer au feu fous une
mouffle ; pour peu qu’on l’y laiffe, le feu brûle
le cuivre , & le précipite devient noir comme
\‘oes ujlum. : il eft vrai que, dans cet état, il fouffre
l’édulcoration fans fe mêler avec l’eau ; .mais
le verd qu’ il donne fur l’émail, tire fur le noir -
& quand même il donnerait un beau verd *
il ne remplirait pas notre objet, qui confiftè
à n’employer que les matières qui ont une
couleur approchantejie celle que la fonte leur
donnera fur l’émail.,*.
On a vu que l’on ne pouvoir employer dans
la peinture fur l’émail, que les.. fubftance s qui
étoient ablblumenc délivrées des fels ; ces lels
étant des diffolvans, on ne peut en dégager le
cuivre que de deux façons, ou en faifant réverbérer
la madère, afin que les diffolvans en foient
enlevés par la force du feu ; & dans ce cas la
matière de verre devient noire ; ou par les édulcorations,
& dans ce cas, l’eau n’enlevant les
fels cju’en les diffolvant, cette eau chargée de
fels , remet le cuivre en diffolution. D’un autre
côté^ le cuivre ne donne une couleur verte
qu’auta-pt qu’ il eft en diffolution ; & il ne la
donne au verre que par cette même raifon. Dans
la précipitation que l’on fait du cuivre d'.ffout
par l’ efpnt dé nitre , en mettant un morceau
de fer dans la diffolution , le cuivre précipité de
cette diffolution , qui eft verte , n’a plus cette
'couleur, & reprend fa couleur métallique qui
eft rouge ; parce que Tefprit de nitre lâche le
cuivre pour attaquer le fer avec lequel il a
plus d’affinité ; & alors le cuivre dégagé de
fon d iffolvantreprend fa couleur naturelle.
Les cryftaux de verdet étant de toutes les
opéra:ionç que l’on peut faire fur le cuivre,
celle qui contient la plus grande quantité du
métal en couleur verte feus une forme lè ch e ,
paroîtroient être ce que l ’on peut employer de
mieux.
Le cuivre fe diffout dans tous les diffolvans
minéraux ou végétaux , par conlec*tient dans tous
les fels acides, alkalis ou neutres, de mêmeque
par la voie lèche dans les verres. I l prend toujours
une couleur verte ou bleue dans toutes
ces diffolutions ; c ’eft-a-dire, verte fi la diffolution
eft par des^acides : bleue, fi elle a été faite
par des alkalis volatils ; & verd bleuâtre, fi
c’eft par des fois neutres ; il ne perd que peu ou
point de fon phlogiftique par la diffolution ,
différent en cela de plufieurs autres métaux qui
le perdent tout entier; cela eft caufe que les
précipités que l’on en fait, non-feulement font
lolublesdans les acides, mais même dans l’eau
commune. Lorfqu’on expofe ces précipités au
feu jufqu’à un certain point ils deviennent
noirs., & alors on. les édulcore très-bien avec
dç l’eau, fans qu’ ils s’y mêlent ,• mais ils reftent
noirs.
Ainfi il arrive deux chôfes lorfqu’ on édulcore
le précipité verd du cuivre ; ou les fels qui
rendoientle cuivre ve rd , fe remettent en diflb-
lution dans l’ eau , & y remettent aulli le cuivre
( c e que l ’on apperçoit par l’ eau qui devient
Verte ) ; ou. fi' le cuivre ne fe remet pas en
diffolution dans l’eau de l’édulcoration , il ceffe.
de relier vert à mefure que l’eau en ôte les fels,
& redevient rouge, ce qui eft fa couleur naturelle.
C ’eft ici que M. de Montamy en eft refté fur
cette couleur vcTtè ; ce qu’ il en dit, fuffit pour
montrer les inconvéniens qu’ il y-a d’employer
le cuivre dans la peinture en émail ; ainfi pouf
travailler avec plus de sûreté, il faut faire la
couleur verte en mêlant les jaunes & les bleus
en différentes proportions : on pourra encore
les éclaircir en y joignant du blanc, ou les
rendre plus foncés en y joignant des bruns,
fui van t les differentes nuances que l ’on voudra
le procurer.
Ln général, comme les différentes couleurs,
dont l ’auteur donne la préparation dans le cours
de cet ouvrage, ont l ’avantage de pouvoir fe
mêler fans inconvénient, c’eft aux peintres à
chercher les differens mélanges & lesdiverfes
do les qui peuvent convenir aux differens objets
qu’ ils voudront repréfenter ; le blanc fervïra
toujours à les rendre plus claires le brun à
les rendre plus obfcures. Quelques fafrans de
mars d’un beau rouge v i f ou d’écarlate , mêlés
avec du bleu , donneront du cramoifi • les
mêmes iàfràns de mars, mêlés avec du blanc
donneront des couleurs de chair. Les fafrans de
mars les plus jaunes, mêlés avec le blanc, pourront
donner des jaunes clairs ; en un mot, le
peintre en émail , à- volonté,' pourra fe former
une palette avec autant defacilité que le peintre
en huile.
N a. Toutes les couleurs qui font propres z
être employées fur l ’émail, peuvent auffi être
employées fur la porcelaine ; il ne s’agit que
de proportionner la quantité du fondant à la
folidité de la pâte dont eft compofëe la porcelaine
fur laquelle on voudra peindre. ( Article
extrait du traité de M, d e M ontamy fu r les
couleurs dans là peinture en émail).
Comme dans le traité que Ton vient de lire '
les procédés pour fe procurer des couleurs jaunes
ne font pas auffi approfondis que le refte , parce
que la mort a arrêté l’auteur lorfqu’ il en étoic
à cette partie de fon travail, nous croyons
devoir joindre ic i une note trouvée dans fes
papiers, .& extraite des Mémoires de VAcadémie
de Berlin, année 1746. M. de Montamy avoir
copié cette note de fa main, & Ton a lieu de
croire qu’ il comptait en faire ufage.
Manière de faire une couleur <Pun jaune citron
avec l ’argent.
O n fait drffoudre une demi-once d’argent
le plus pur & le plus dégagé de cuivre qu’ il eft
poflible , dans une quantité fuffifante d’efprit
de nitre très-pur, jufqu’au point de la faturatiôn.
On diffout dans quatre parties d’ eau diftillée,
une once de fel d’urine, qui fait la bafe du
phofphore : on fait tomber goutte à goutte
diffolution dans l ’efprit de nitre qui a diffout
l ’argent étendu ayec quatre parties d’eau j ofi