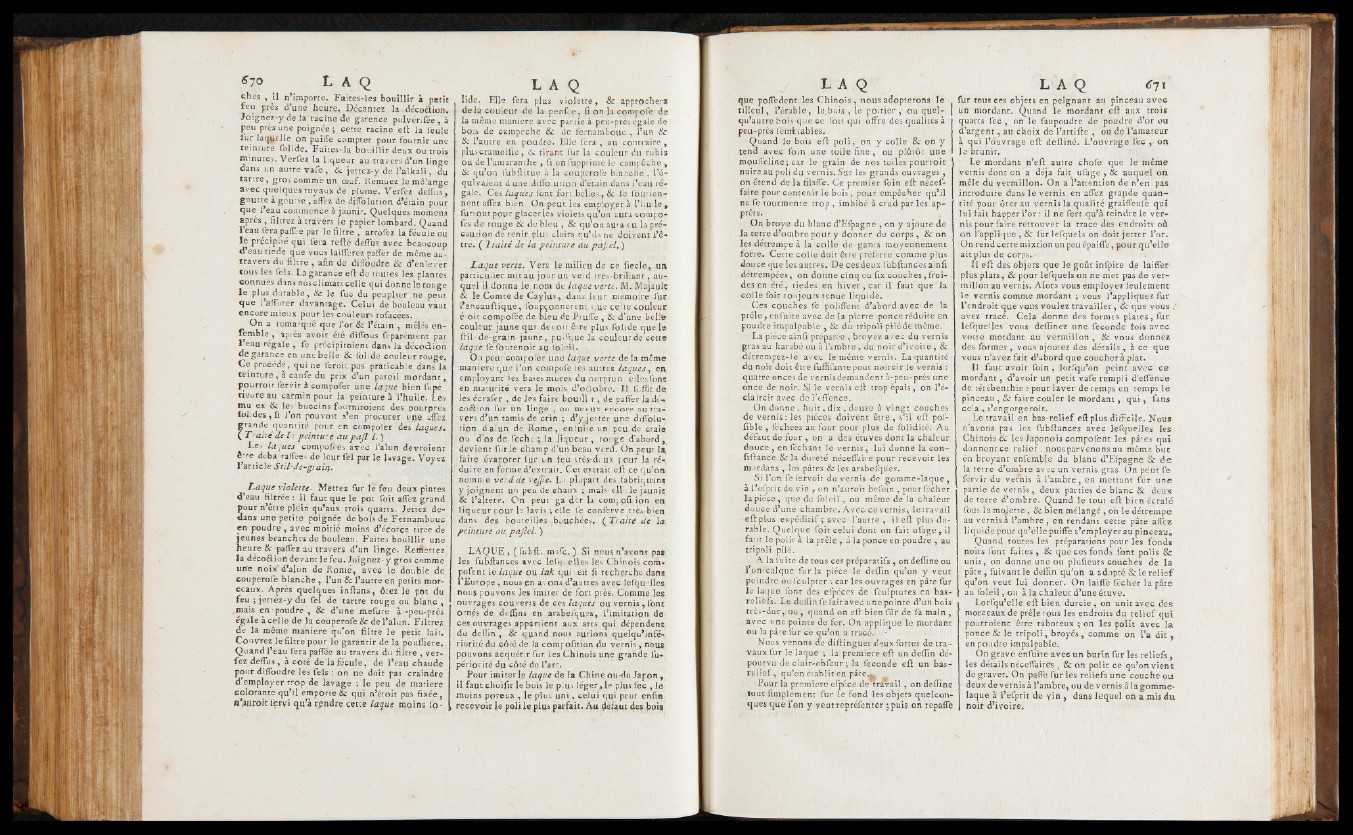
ches , il n’ importe. Faites-les bouillir à petit
feu près d’une heure. Décantez la déco&ion.
Joignez-y de la racine de garence pulvérifée, à
peu près une poignée; cette racine eft la l'eule
iur laquelle on puiffe compter pour fournir une
teinture folide. Faites-la bouillir deux ou trois
minutes. Verfez la liqueur au travers d’ un linge
dans un autre vafe , 8c jettez-y de l ’a lk a li, du
tartre, gros comme un oeuf. Remuez lemê’ange
avec quelques tuyaux de plume. Verfez delfus,
goutte a goune , allez de diffolution d’étain pour
que l’eau commence à jaunir. Quelques momens
après , filtrez à travérs le papier lombard. Quand
le au fera paffee par le filtre , arrofez la fécule ou
le précipité qui fera refté deffus avec beaucoup
d’ eau tiede que vous laiffcrez paffer de même au-
travers du filtre , afin de diffoudre & d’enlever
tous les fels. La garance eft de toutes les plantes
connues dans nos climats celle qui donne le rouge
le plus durable, & le fuc du peuplier ne peut
que l’affurer davantage. Celui de bouleau vaut
encore mieux pour les couleurs rofacées.
On a remarqué que l’or & l’étain , mêlés en-
femble , apres avoir été diffous feparérnent par
l ’eau régale , fe précipitoient dans la déco&ion
de garance en une belle & loi de couleur rouge.
C e procédé, qui ne feroit pas praticable dans la
teinture, a caufe du prix d’un pareil mordant,
pourroit fervir à compofer une laque bien fupé
rieure au carmin pour la peinture à l’huile. Les
mu ex 8c les buccins fburniroient des pourpres
Ibhdes, fi l’on pouvoir s’ en procurer cpe affez
grande quantité pour en compofer des laques»
C Traité de h peinture au p a ß L. )
Le* laques compofees avec l’alun devroient
être deba raffees de le y r fe l par le lavage. Voyez
l ’article Stil-de-grain.
Laque violette. Mettez fur lé feu deux pintes
d’eau filtrée : il faut que le pot foit allez grand
pour n’etre plein qu’aux trois quarts. Jettez dedans
une petite poignée de bois de Fernambouc
en poudre , avec moitié moins d’écorce tirée de
jeunes branches de bouleau. Faites bouillir une
heure & paffez au travers d’ un linge. ReiAettez
la decoélioft devant le feu. Joignez - y gros comme
ufife noix*d’alun de Rome, avec le double de
couperofe blanche , l’ un & l’autre en petits morceaux.
Après quelques inftans, ôtez le pot du
feu ; jettez-y du fel de tartre rouge ou blanc ,
.mais en'poudre, & d’une mefure à--peu-près
égale à celle de couperofe & de l’alun. Filtrez
de la même maniéré qu’on filtre le petit lait.
Couvrez le filtre pour le garantir de la pouffïere.
Quand l’ eau fera paffée au travers du filtre , verfez
deffus, à coté de lafecule, de l’eau chaude
pour diffoudre les fels : on ne doit pas craindre
d employer trop de lavage ; le peu de matière
colorante qu’ il emporte & qui n’étoit pas fixée,
a d r o i t lçryi qu’à rpndrç cette laoue mpins fplide.
Elle fera plus v iolette, & approchera
delà couleur de la penfee, fi on la compofe de
la même maniéré avec partie à peu-près égale de
bois de czmpeche & de fernambouc , l’ un &
8c l’autre en poudre. Elle fera , au contraire,
pluscramoifie, & tirant fur la couleur du rubis
ou de l’amaranthe , fi on fupprime le campêche ,
8c qu’qn fubftitue à la couperofe blanche , i ’é-
quivalent d une .diffolution d’étain dans l’eau régale.
Ces laques font fort belles, & le fourien-
nent affez bien. On peut les employer à l’huile,
funoutpour glacerles violets qu’on aura compo-
fés de rouge 8c de bleu , & qu'on aura eu la précaution
de tenir plus clairs qu’ ils ne doivent l’être.
( 1 raité de la peinture au paftel, )
Laque verte. Vers le milieu de ce fiecle, un
particulier mit au jour un verd très-brillant, auquel
il donna le nom de laque verte. M. Majauic
6c le Comte de Caylus, dans leur mémoire fur
i’ encauftique, foupçonnerent que cecte'couleuï
é oie compofée de bleu de Pruffe , & d’une belle
couleur jaune qui devoir être plus folide que, le
ftil-de-grairr jaune, puîfque la couleur de cette
laque fe foutenoit au l.oloil.
On peut compofer une laque verte de la même
maniéré que l’on compofejes autres laques, en
employant les baies mures du nerprun : elles font
en maturité vers le mois d’oétobre. Il fLfïàt de
les écrafer , de les faire bouill r , de paffer la do-
coâion fur un linge , ou mieux encore au travers
d’ un tamis de crin ; d’yje tte r une diffolu-!
tion d aiun de Rome, enfuite un peu de craie
Ou d’os de feche ; la liqueur, rouge d’abord,
devient furie champ d’un beau vèrd. On-peut la,
faire évaporer fur un feu irès-dt ux pour la ré-,
duire en forme d’extrair. Cet extrait eil ce qu’on
nomme verd de vejfie> £4 plupart des fabriquant
y joignent un peu de chaux ; mais elb le jaunit
8c l’altere. On peut ga der la conqofiion en
liqueur pour le lavis ; elle fe conferve très-bien
dans des bouteilles ,bouchées. ( Traité de la
peinture du pajlel. )
LAQ U E , ( fubft. mafe. ) Si nou;ç n’avons pa*
les fubftances avec lesquelles les Chinois coin*
pofent le laque ou lak qui eil fi recherché dans
l ’Europe, nous en avons d’autres avec lefqueiles
nous pouvons les imiter de fort près. Comme les
ouvrages couverts de ces laques ou vernis, font
ornçs de deffins en arabeiques, l’imitation de
ces ouvrages appartient aux arts qui dépendent
du defïin , 8c quand nous aurions quelqu’ infér
riorité du côté de la compofition du vernis , nous
pouvons acquérir fur les Chinois une grande fu-,
périorité du côté de l’arr.
Pour imiter le laque de la Chine ou-du Japon ,
il faut choifir le bois le plus léger, le plus fec , le
moins poreux , le plus u n i, ce^ui qui peut enfin
rççeyoir le poli iç plua parfait. Au défaut des boit?
que poffedent les Chinois , nous adopterons le
tilleul, l’érable, le,bujs , le poirier, ou quel-
qu’autre bois que ce foit qui offre des qualités à
peu-près fetnfclables.
Quand le bois eft poli, on y colle & on y
tend avec foin une toile fine, ou plûtôt une
mouffeline; car le grain de nos toiles pourroit
nuire au poli du vernis. Sur les grands ouvrages ,
on étend de la fiiaffe. Ce premier foin eft nécef-
faire pour contenir le bois, pour empêcher qu’ il
ne fe tourmente trop , imbibé à crud par les apprêts.
On broyé du blanc d’Efpagne , on y ajoute de
la terre d’ombre pour y donner du corps , & on
les détrempe à la colle de gants moyennement
forte. Cette colle doit être préférée comme plus
douce que les autres. De ces deux fubftances ainfi
détrempées, on donne cinq oü fix couches, froides
en été, tiedes en h iv e r , car il faut que la
colle foit toujours tenue liquide.
Ces couches fe poliffenc d’abord avec* de la
prêle , enfuite avec de la pierre -ponce réduite en
poudre impalpable , & du tripoli piléde même.
La pièce ainfi préparée , broyez avec du vernis
gras au karabé ou à l’ambre , du noir d’ ivoirè , &
détrempez-îe avec le même vernis. La quantité-
du noir doit être fuffifantepour noircir le vernis :
quatre onces de vernis demandent à-peu-près une
once de noir, le vernis eft trop épais, on l’é-
claireir avec de l’effence.
On donne, huit, dix , douze à vingt couches
de vernis: les pièces doivent être , s’ il eft pof-
fiblé , féchees au four pour plus de folidité. Au
défaut de four , on a des étuves dont la chaleur
douce , en féchant le vernis, lui donne la con-
fiftanrefev&: la dureté néceffaire pour recevoir les
itiordans , les pâtes & les arabefqti'es.
Si l ’on, fe fervoit du vernis de gomme-laque,
- a l'elprit de,Vin , on n’auroit befoin , pour fécher
la pièce, que du foleil , ou même de la chaleur
douce d’une chambre. Avec, ce vernis, le travail
eft plus expéditif ; avec l’autre , il eft plus du- '
rable. Quelque foit celui dont on fait ufage, il
. faut le polir à la prêle , à la ponce en poudre , au
tripoli pilé.
A la fuite de tous ces préparatifs , on defline ou
l’ on calque fur la pièce le deflin qu’on y veut
peindre ou fculpter ; car les ouvrages en pâte fur
le laque font des efpéces de fculptures en bas-
relièfs. Le deflin fe fait avec une.pointe d’ un bois
très-dur, o u , quand on eft bien fûï de fa main ,
avec une pointe de fer. On applique le mordant
ou la pâte fur ce qu’on a tracé. -
Nous venons dexliftinguer deux fortes de travaux
fur le laque ; la première eft un deflin dépourvu
de ciair-obfcur ; la fécondé eft un bas-
re lie f, qu’on établit en pâte.*. '
Pour la première elpéce de trav a il, on defline
tout Amplement fur le fond les objets quelconques
que l’on y yeutrepréfenter ;puis on repaffe
fur tous ces objets en peignant au pinceau avec
un mordant. Quand le mordant eft aux trois
quarts fec , on le faupoudre de poudre d’or ou
d’argent, au choix de l’artifte , ou de l'amateur
à qui l’ouvrage eft deftiné. L’ouvrage fec , on
le brunir.
Le mordant n’eft autre chofe que le même
vernis dont on a déjà fait ufage , & auquel on
mêle du vermillon. On a l’attention de n’en pas
introduire dans le vernis en affez grande quantité
pour ôter au vernis la qualité graiffeufe qui
lui fait happer l’or : il ne fert qu’à teindre le vernis
pour faire retrouver la trace des endroits où
on l’applique , 8c fur lefquels on doit jetter l’or.
On rend cette mixtion unpeuépaiffe, pour qu’elle
ait plus de coYps.x
Il eft des objers que le goût infpire de laiffer
plus plats, & pour lefquels on ne met pas de vermillon
au vernis. Alors vous employez lèulement
le vernis comme mordant ; vous l’appliquez fur
l’endroit que vous voulez travailler, 8c que vous
avez tracé. Cela donne des formes plates, fur
lefque'les vous deflinez une fécondé fois avec
votre mordant au vermillon , & vous donnez
des formes, vous ajoutez des détails, à ce que
vous n’avez fait d’abord que couchera plat.
II fau-t avoir foin , lorfqu’on peint avec ce
mordant, d’avoir un petit vafé rempli d’eflence
de térébenthine pour laver de temps en temps le
pinceau , &c faire couler le mordant, q u i, fans
cela , s’ engorgeroît.
Le.travail en bas-relief eft plus difficile. Nous
n’avons pas les ftibftances avec lefquelles les
Chinois 8c les Japonois compofent les pâtes quL
donnent ce- relief . nous parvenons au même but
en broyant enfemble du blanc d’Efpagne & de
la terre d’ombré avec un vernis gras. On peut fe
lervir du vernis à l’ambre, en mettant fur une
partie de vernis, deux parties de blanc & deux
de terre d’ombre. Quand le tour eft bien écrafé
fous la mojette, &-bien mélangé, on le détrempe
au vernis à l’ambre , en rendant cette pâte affez
liquide pour qu’élle puiffe s’employer au pinceau.
Quand toutes les préparations pour les fonds
noirs font faites , 8c que ces fonds font polis &
unis, on donne une ou plufieurs couches de la
pâte , fuivant le deflin qu'on a adopté & le relief
qu’on veut lui donner. On laiffe fécher la pâte
au fo le il, ou à la chaleur d’une étuve.
Lorfqu’elle eft bien durcie , on unit avec des
morceaux de prêle tous les endroits du re lie f qui
pourroienc être raboteux ; on les polit avec la
ponce & le tripoli, broyés, comme on l ’a d i t ,
en poudre impalpable.
On gravé enfuite avec un burin fur les reliefs ,
les détails néceffairès t & on polit ce qu’on vient
de graver. On paffe fur les reliefs une couche ou
deux de vernis à l’ambre, ou de vernis à la gomme-
laque à l’efprit de yin , dans lequel on a mis du
noir d’iyoire.